Locarno 2017 – rencontre avec Todd Haynes
Pour sa 70e édition, le Festival de Locarno a eu la bonne idée de décerner un Léopard d’honneur à l’un des cinéastes les plus préoccupés par les films qui l’ont […]
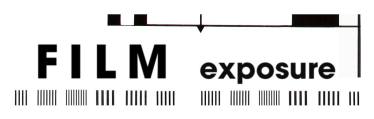 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Pour sa 70e édition, le Festival de Locarno a eu la bonne idée de décerner un Léopard d’honneur à l’un des cinéastes les plus préoccupés par les films qui l’ont […]
Pour sa 70e édition, le Festival de Locarno a eu la bonne idée de décerner un Léopard d’honneur à l’un des cinéastes les plus préoccupés par les films qui l’ont précédé. L’occasion rêvée pour le rencontrer, de parler de son nouveau film qui arrivera sur nos écrans en novembre (notre critique à lire ici), de son projet de documentaire sur le Velvet Underground et de l’évolution de sa filmographie.
Jusqu’à I’m Not There, vous aviez l’habitude d’écrire vos propres scénarios. Pour Carol et Wonderstruck vous avez adapté successivement deux livres sans en signer l’adaptation. Qu’est-ce qui vous a convaincu de vous contenter de la réalisation ?
C’est effectivement relativement nouveau pour moi d’ouvrir la porte aux choses qui sont là, disponibles dans le monde et que je n’ai pas générées moi-même. Pendant plusieurs années, c’est vraiment ce que j’ai fait, j’ai écrit et développé mes propres projets. Mon agent disait tout le temps : « Non, il ne lit pas les scénarios, allez-vous-en ! » Ça a toujours été une excellente expérience de travailler comme ça, de prendre beaucoup de temps pour produire, faire des recherches, écrire et financer ses propres projets, les uns après les autres. J’étais très tenace et focalisé sur une seule chose à la fois alors que beaucoup de réalisateurs jonglent toujours entre plusieurs projets à des stades de développement très différents. Et c’est très récemment que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de travailler plus, d’avoir davantage de projets qui arriveraient dans ma vie plus rapidement. Je pense que ça remonte à Mildred Pierce, où le processus était déjà différent ; je ne l’ai pas créé de toutes pièces, j’ai adapté le roman avec un ami. Et ensuite, effectivement, j’ai réalisé deux films qui n’étaient pas basés sur mes propres scripts.
Aviez-vous envie de faire une pause concernant l’écriture ? Vous en êtes-vous lassé ?
Je ne sais pas si je me suis lassé de l’écriture mais ça me convient de m’engager différemment dans le processus créatif. Vous savez, j’ai quand même été impliqué dans l’écriture des scripts que j’ai acceptés, comme Carol et Wonderstruck. J’ai travaillé avec les auteurs afin de pouvoir proposer quelque chose qui me corresponde. Mais c’est drôle, parce que même quand vous signez le scénario, le projet devient « autre » dès que vous vous lancez. Vous avez le devoir de donner de votre personne et ensuite de vous écarter un peu du script. Dès que vous tournez, le scénario c’est de l’histoire ancienne. Le script n’est finalement que le plan de ce que vous allez faire avec votre caméra, vos acteurs et vos lieux de tournage. Quand vous terminez le tournage, il s’agit de monter et vous devez alors être capables de prendre de la distance avec votre plan et vos attentes. Je pense que c’est le seul moyen de voir ce que vous avez devant les yeux et de laisser le film devenir ce qu’il est vraiment. Vous pouvez tout faire pour essayer de gérer et de dominer ce processus mais à la fin, le résultat c’est toujours ce que vous avez devant vous.

Qu’est-ce qui vous a motivé à réaliser Wonderstruck ? Était-ce la perspective de faire un film qui puisse être destiné aux enfants ?
Oui, à la base c’était vraiment ça. De manière évidente, avec toutes ses références historiques, ce script avait un langage et un potentiel très cinématographiques. Rien qu’en le lisant, vous pouviez sentir le rythme du montage. C’était très stimulant de voir toutes ces perspectives cinématographiques. Je tenais à sentir que je pouvais créer quelque chose de très proche du conte et des personnages, et en ce sens-là je me suis effectivement éloigné de mes drames pour adultes pour finalement proposer quelque chose auquel les enfants pourraient être sensibles.
J’ai revu beaucoup de films qui ont compté pour moi quand j’étais enfant. J’ai trouvé qu’ils étaient tous des films très matures. Par exemple, le film Sounder que je n’avais pas revu depuis mes 12 ans (ce qui correspond à l’âge des enfants dans Wonderstruck) ; avant de le revoir je me disais qu’il devait s’agir d’un de ces films très manipulateurs, un de ces tire-larmes à propos d’un chien. En fait, il est extrêmement raffiné, si subtil. J’ai été surpris de voir à quel point il était modéré et mature, à tel point que je ne pense pas qu’on puisse l’étiqueter de « film familial », et pourtant nous y sommes tous allés en famille. C’est vraiment un film merveilleux, en le revoyant j’ai compris qu’on pouvait traiter les enfants comme n’importe quels autres personnages, en assumant qu’ils possèdent leurs expériences, leurs émotions et qu’ils peuvent comprendre et gérer la complexité.
Avec Velvet Goldmine et I’m Not There vous avez proposé des films qui s’apparentent à des biopics tout en jouant sur la frontière entre la fiction et la réalité pour finalement aboutir à quelque chose de très original. Dans quelle mesure cette porosité entre fiction et réalité s’est-elle imposée ?
Dans ces deux films, qui sont des drames basés sur la musique, j’ai essayé de trouver une stratégie de forme et de style pour atteindre le cœur de ce que ces deux artistes ont fait dans leur musique. La seule question que vous avez à vous poser quand vous vous attaquez à n’importe quel sujet, et en particulier les sujets historiques, est : pourquoi devrait-on en faire un film ? Est-ce réellement un besoin ? Ce sujet suggère-t-il un langage visuel ? Le travail de cette personne a-t-il un héritage visuel qui justifie qu’on en fasse un film ? La majeure partie des grandes biographies ne sont pas faites pour être adaptées au cinéma. Donc dans ces deux cas j’ai vraiment essayé de rendre compte des caractéristiques uniques du sujet.
Il s’agit de deux films très différents, c’est donc difficile pour moi de généraliser mais il y a effectivement un sens théâtral et de l’artifice dans Velvet Goldmine, ainsi qu’une sorte de narration parallèle créée par des évènements qui sont tous tirés de l’ère Bowie, Lou Reed, Iggy Pop et des liaisons amoureuses entre ces artistes, mais ces évènements sont traités par la fiction. On aboutit effectivement à une « vérité fictive ». La raison pour laquelle j’ai travaillé dans ce sens c’est parce qu’eux-mêmes se transformaient en fictions, créant des hybrides et des icônes de fiction.
Pour Dylan, je continue de le voir comme quelqu’un qui crée et tue en série ses différentes personnalités. Il plonge tellement profondément dans un intérêt particulier qu’il a ensuite la nécessité de le détruire pour pouvoir passer à autre chose. Je pense que c’est comme ça qu’il gagne la liberté de résister au succès, aux attentes et au fardeau de sa propre gloire. En tant qu’être fondamentalement créatif, il doit sans cesse passer par des fractures qui nécessitent la mort de l’ère précédente.

Vous venez d’annoncer un documentaire consacré au Velvet Underground, peut-on s’attendre à un traitement aussi original ?
Je ne sais pas, c’est un tout nouveau projet pour lequel nous n’avons même pas encore décidé d’une structure de production. Je n’ai jamais fait de documentaire… Pour moi, les documentaires sont écrits dans la salle de montage. Il s’agit donc de compiler des informations, des interviews, mais dans ce cas il est impératif que les images racontent l’histoire. Il faudra donc trouver ce que signifient ces images, ce qu’elles sont, alors que le Velvet Underground est connu pour être un groupe particulièrement peu documenté. Par exemple, il n’existe pratiquement pas d’images du Velvet en train de jouer. On devra trouver d’autres moyens pour visualiser à quoi ressemblaient ces moments. Le truc intéressant c’est que le Velvet est vraiment issu du cinéma et de la musique d’avant-garde. Bien sûr John Cale et les films d’Andy Warhol ont leur rôle à jouer, mais il y a tellement d’éléments qui se sont croisés et qui ont pollinisé à cette époque. C’est un temps perdu, qui est de plus en plus éloigné de notre culture contemporaine… Ce sera génial d’être face à tout ça et de commencer à voir comment ces éléments communiquent. Je pense que la forme du documentaire va émerger de cette liberté créatrice sans forcément avoir un plan imposé de l’extérieur.
De Poison à Wonderstruck, on pourrait considérer que vous vous êtes assagi. Pensez-vous avoir suivi une évolution logique en fonction de votre âge ou vous imaginez-vous encore proposer un film comme Velvet Goldmine ?
C’est drôle parce que la dernière fois que j’ai vu Poison, ça m’a choqué ! Le film m’a fait prendre conscience d’une autre partie de moi-même, de mon histoire, de notre histoire culturelle. J’y ai vu une approche pratiquement terroriste du langage cinématographique et je pense que nous évoluons en grandissant, en vieillissant. Effectivement, je ne suis plus cet enfant radical qui avait fait ce film.
Cet enfant radical vous manque-t-il parfois ?
Oui. Et bien sûr l’époque où la culture queer ne consistait pas à vouloir se marier et devenir « normal » me manque. Bien sûr que j’apprécie et que je soutiens les progrès entrepris par des homosexuels et des trans. pour nous faire comprendre que nous avons le choix de mener la vie qu’on veut. Mais quand vous vous battez pour être en vie, pour ne pas être seul et être accepté à la table, je pense que vous avez un sens critique particulier, un regard plus affuté et que vous êtes mieux armé pour changer le monde. Je ne sais pas si ça peut durer une vie entière, mais il y a des victoires : aujourd’hui les gens ne meurent plus du SIDA. C’est une victoire incontestable, j’ai perdu tellement de proches de cette manière. Mais je pense qu’on a également perdu des choses en gagnant cette bataille. Je pense que le fait d’être exclu de la société vous apprend des choses que vous ne pouvez pas apprendre quand vous êtes intégrés. Aujourd’hui, on s’interroge sur ce que signifie « être à l’extérieur de la société ». On se demande où est la contreculture. On se demande ce qu’est la critique. Où est la critique ? Où est l’activisme ? C’est beaucoup trop facile de cibler Donald Trump. C’est décevant et enrageant de devoir être focalisé sur ce sujet, qui est essentiel par sa dimension. L’autre jour, je parlais à un gamin qui sortait de son cours de philosophie et qui s’exclamait : « Oui ! Je suis maintenant prêt à affronter le monde ! ». Ça m’a rappelé qui j’étais et je pense que pour retrouver ça on peut s’inspirer de nos aînés, des gens qui nous ont précédé, comme je l’ai fait.

Les Velvet Underground n’est pas forcément un sujet moins radical que le glam rock.
Je ne suis pas sûr, les Velvet Underground ayant désormais été canonisés. Raison pour laquelle le groupe Universal Music m’a approché après que Laurie Anderson ait dit qu’elle aimerait que je fasse ce documentaire. Cette dernière va d’ailleurs m’ouvrir les archives de Lou Reed, ce qui est un immense honneur. Cette invitation est pour moi l’occasion de remonter à cette période et d’en tirer un enseignement, comme j’ai fait avec Velvet Goldmine. Ce n’est pas sans raison que Velvet Goldmine est décrit comme un « moment perdu », dans un temps qui n’est déjà plus là. D’une certaine manière, je pense que la seule manière de raconter cette histoire est de ne pas vous faire croire que je peux vous transmettre l’essence de cette période mais de vous dire que c’est à vous de trouver votre propre « Velvet Goldmine ».
En parlant de « se trouver soi-même », beaucoup de vos projets semblent avoir germé à partir d’une influence précise : Douglas Sirk pour Far From Heaven, la photographie de Saul Leiter pour Carol, etc. Quel rôle ces influences jouent-elles dans votre processus de création ?
Je suis avant tout quelqu’un qui est inspiré et touché par l’histoire de ce média. Chaque film que j’entreprends me confie la tâche de regarder en arrière et d’apprendre le plus possible de mes prédécesseurs. C’est également valable pour Wonderstruck pour lequel je remonte au cinéma de 1927. Se plonger dans cette époque-là revient à s’intéresser à un cinéma qu’on écarte souvent et qu’on considère comme étant naïf, comme si on était passé à quelque chose de complétement différent. Et en fait, il s’agit peut-être d’un des moments les plus raffinés de l’histoire du cinéma. C’est juste avant que le son n’arrive, à l’apogée de l’ère du muet. C’est donc une opportunité de se montrer humble par rapport à ce qui me précède. Il y a de la radicalité dans cette démarche, en s’intéressant à des choses qu’on considère comme naïves, dépassées et qu’on regarde cyniquement.
Le triomphe de Moonlight aux Oscars est perçu par certains comme une victoire pour la cause homosexuelle, qui serait enfin acceptée par Hollywood. Qu’en pensez-vous ?
J’espère… Mais je ne sais pas à quel point j’ai envie de considérer les Oscars comme un témoin valable. On peut parler du monde des Oscars, mais c’est un domaine très limité qui est en plus replié sur lui-même, plus qu’à une certaine époque certainement. Donc je ne pense pas que les Oscars définissent où en est notre culture. Ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas regarder ces désignateurs comme des acteurs qui occupent une place importante dans l’évolution de notre culture et dans ce qui y est toléré, permis, louable… Mais, comme on le sait tous, les Oscars ne définissent en rien quels sont les films géniaux, il y a beaucoup trop d’exemples de films qui n’étaient pas pertinents pour recevoir un quelconque prix. C’est la même chose avec le Velvet Underground : c’est un groupe qui a eu tellement d’influence mais qui n’a pratiquement eu aucune visibilité commerciale à l’époque. Pourtant, son influence a été énorme.
Vous savez, Carol n’a pas été sélectionné dans la catégorie « meilleur film ». Mais, je déteste vraiment la démarche qui consiste à faire campagne pour son film. Je sais que ça peut aider la commercialisation d’un film, mais mon but était essentiellement de faire tout mon possible pour que les gens aillent voir Carol sur grand écran, parce que c’est ce qui définit ma pratique du cinéma. Comme pour tous les films que je respecte, je veux les voir sur grand écran avant qu’ils s’en aillent. Je suis d’accord de faire la promotion d’un film pour que les gens le voient avant qu’il n’arrive sur leur téléphone. Mais bon… Je me souviens d’être allé à la fête de Miramax en 1998, parce qu’ils distribuaient Velvet Goldmine. C’était l’année de Shakespeare in Love et de La vie est belle ; des films qui ont remporté plus d’Oscars qu’on ne pourrait jamais en rêver. C’était la grande communion de la machine Weinstein en somme. Je me souviens donc d’être arrivé à cette fête, en pensant que je pourrais y ressentir une joie intense et le sentiment d’une victoire totale… (un temps) Je ne devrais pas dire ça ! (Rires) Mais je n’ai rien ressenti de tout ça ! Bien sûr, les Oscars que ces films ont remportés les ont aidés au box-office et ont encouragé les gens à aller les voir au cinéma… Mais je sentais que même la victoire était étrange pour ces gens, comme s’ils n’arrivaient pas à la savourer sainement.
Entretien conduit et retranscrit par Thomas Gerber.
Remerciements à Ursula Pfander pour avoir permis à cette interview d’avoir lieu.
Photos © Locarno Festival
beau blog. un plaisir de venir flâner sur vos pages. une belle découverte et un enchantement.N’hésitez pas à visiter mon blog (lien sur pseudo)
au plaisir
J’aimeJ’aime