Rencontre avec Gus Van Sant
Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018, le Musée de l’Elysée accueille une exposition consacrée à Gus Van Sant, tandis que la Cinémathèque de Lausanne rend en cette fin […]
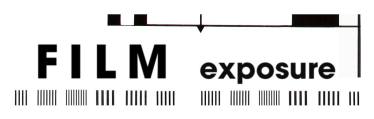 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018, le Musée de l’Elysée accueille une exposition consacrée à Gus Van Sant, tandis que la Cinémathèque de Lausanne rend en cette fin […]
Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018, le Musée de l’Elysée accueille une exposition consacrée à Gus Van Sant, tandis que la Cinémathèque de Lausanne rend en cette fin d’année hommage à sa carrière par une rétrospective. Sa venue en Suisse était l’occasion de le rencontrer. Gus Van Sant a le style (et l’éthique sous-jacente) de ses films : il parle lentement, en choisissant soigneusement ses mots, moins de lui-même que des autres – sources d’inspirations, collaborateurs, modèles… Retour sur un regard unique, formé à d’autres régimes esthétiques que le cinéma tel qu’il va, d’une attention particulière à la présence d’autrui. Les nuages épars laissaient méditatif ce jour-là.

Vous présentez au Musée de l’Elysée une série de photographies de personnalités, effectuées à travers les années. Que chérissez-vous dans l’art du portrait ?
C’est une question difficile. (un temps) Il est intéressant de voir les portraits de célébrités – ou d’autres – d’Irving Penn, ou ceux d’Avedon, pour mentionner deux personnes qui ont largement contribué à l’art du portrait. J’ai été photographié par Avedon (en 8×10), c’était très rapide, il a pris quatre photos. Il a déplacé l’éclairage en fonction de mon nez… il disait que la lumière m’embellissait selon un certain angle. J’ai donc appris quelque chose sur mon angularité que j’ignorais jusqu’alors. Je crois que les photos que j’ai moi-même prises émulaient le style d’Avedon : photos simples sur fond simple. J’utilisais la photographie comme moyen de me souvenir des acteurs, dans une situation de casting. J’avais besoin d’une image, pour avoir chacun « à l’œil », épinglé sur une paroi et ainsi créer un ensemble. Voir comment chacun fonctionnerait avec l’ensemble, dans une logique proche de la direction artistique… mais appliquée aux acteurs. J’avais ainsi toute une pile de comédiens considérés pour les différents rôles, avec l’image desquels je pouvais tenter des combinaisons, illustrées visuellement. Les photos polaroïds tendaient à être maniables, étant semblables à des cartes. Dans le même temps on pouvait en tirer des négatifs, splendides au demeurant. Elles fonctionnaient bien en grands formats, quasiment larges, alors qu’elles émanaient d’un petit appareil facile d’usage. Le tirage papier du polaroïd était le seul élément pour ainsi dire compliqué dans cette pratique. À part cela, on était proche du 8×10, avec sa légèreté. Les portraits de ce fait n’étaient pas très précieux. Ils n’essayaient pas de capturer un sentiment véritable du personnage, mais ce qui arrivait exactement au moment de la prise au potentiel interprète. Je pouvais me permettre de rester là, me concentrer, prendre ma photo et quoi que fassent les personnes au moment du clic, ça n’avait pas grande importance. Je leur disais de fixer l’objectif et voilà. Souvent elles le regardaient avec une pointe d’étonnement, comme s’il y avait une forme de bizarrerie à l’appareil, en raison du soufflet, de sa couleur grise. Il en résulte que cette seconde où elles regardaient l’appareil, elles pensaient à celui-ci, et non à elles-mêmes.
Cela résonne d’une certaine manière avec votre approche non-interventionniste de la direction d’acteurs : vous ne voulez pas être dans le contrôle, mais que les acteurs apportent quelque chose d’eux-mêmes, qui va de leur présence dans l’instant à une vision qui leur soit propre de ce en quoi ils peuvent contribuer au projet…
C’est arrivé plus tard, mais ça venait de là. Ce n’est pas quelque chose que j’avais vraiment prévu au préalable, ça s’est décidé pour moi en une seconde. J’ai soudainement arrêté de les diriger. Et du fait de cette absence de direction, ils ont commencé à apporter, à contribuer. Se l’autoriser a pu découler de ce refus préalable de la pose. J’ai moi-même posé pour des photographes, en consentant à cet acte de prendre la pose. Mais le plus souvent ce n’est pas comme cela que j’ai moi-même travaillé en tant que photographe (bien qu’il reste parfois visible que certains modèles prenaient une pose). Les gens venaient généralement tel qu’en eux-mêmes, dans des habits quotidiens. La rencontre n’était normalement pas très formelle, le code vestimentaire détendu.

Comment le fait d’être photographe et d’avoir étudié les Beaux-Arts a influencé votre pratique de metteur en scène ?
Aux Beaux-Arts ils avaient une section film. J’ai également essayé la peinture, j’ai pris des cours de photographie. J’apprenais sous la conduite d’Aaron Siskind, un photographe qui, avec Harry Callahan, a contribué à me former au noir et blanc dans la tradition américaine, en tant que chefs de mon département à la Rhode Island School of Design. J’ai suivi un ou deux cours de Siskind, mais il y avait surtout une grande chambre noire mise à disposition, dont j’ai amplement profité. Un proche ami de la même formation, que je connaissais déjà de nos années lycées, y a été diplômé en photographie… Il prenait beaucoup de photos, avec un Leica qu’il avait reçu comme cadeau à sa remise de diplômes. Vraiment, vraiment, beaucoup. Je parle d’Eric Edwards, le chef-opérateur qui a depuis pas mal travaillé pour Judd Apatow. Il prend encore énormément de photos. Je ne suis pas sûr qu’il utilise encore un Leica, mais je présumerais que oui. Il a une incroyable collection d’images prises au fil des années. De mon côté, en revanche, je me promenais très rarement avec mon appareil, je ne prenais pas tant de photos que ça. De temps à autre, seulement. Il est incroyable à quel point, même en ne prenant pas tant de photos que ça, elles en viennent à s’emmagasiner. J’en ai encore plein en stocks, si je jette un coup d’œil à mes archives. Je ne me rappelle même pas les avoir prises. Pour quelqu’un comme Bruce Weber… ça doit se chiffrer en millions.
Étant donné qu’il s’agit également d’un sujet de l’exposition : comment voyez-vous l’évolution de Portland depuis que vous avez commencé à y filmer ?
Mala Noche a été filmé en 1983, puis Drugstore Cowboy en 89. Portland a évidemment bien changé depuis. Beaucoup de choses montrées dans ces films ne sont plus d’actualité. Des quartiers entiers se sont modifiés entre-temps. Au même titre qu’à New York. Tel district d’entrepôts qui se transforme en quartier grand luxe… Les entrepôts sont déplacés, de grands hôtels fleurissent à leur place. Ces bâtiments ne font que bouger d’un lieu à un autre.

Vous présentez demain (ndlr : le 25 octobre au Capitole) Drugstore Cowboy au public. Avez-vous choisi de projeter ce titre et si oui, pourquoi ?
Nous l’avons choisi ensemble avec ce cinéaste suisse, Lionel Baier. Je viens de finir un film : Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot. Je voulais présenter celui-ci, mais je crois que ça aurait été difficile sachant que le film ne sera pas diffusé ici cette saison. Nous nous sommes donc décidés pour Drugstore Cowboy, en présumant qu’il devait compter parmi les plus appréciés. On aurait pu montrer Sea of Trees, mais celui-ci mis de côté il était difficile de décider lequel présenter. Donc… va pour Drugstore Cowboy.
Vous avez collaboré, comme l’exposition en témoigne, avec des musiciens. Vous avez également réalisé un film sur un musicien célèbre (ndlr: Last Days). À quel point la musique vous nourrit-elle d’un point de vue créatif?
Je me souviens à l’école être entré dans une salle de projection. L’un d’entre nous venait de caler une musique, très belle, je ne me souviens pas laquelle, mais du répertoire classique, sur ses propres images. La qualité du son m’inspirait. L’image était en 16 millimètres, sur piste magnétique. Le transfert avait juste été exécuté. Cet étudiant, qui était plus âgé que je ne l’étais, prévoyais ce morceau pour son film et découvrait le mariage. D’assister à la synchronisation de la musique et des images… c’était une émotion primaire. Même en ayant vu bien des films sonorisés au préalable, d’assister à cet acte de création, sur le territoire où vous-même travailliez… Ça peut sonner naïf, mais c’était une indication puissante du pouvoir concret de la musique additionnée à des images. Ce principe auquel il a été fait recours depuis les années 1920, quand quelqu’un jouait de l’orgue Wurlitzer durant la projection. Ça a toujours été un élément fort du cinéma, quelque chose ayant trait à son âme même. J’ai dès le début de mon travail eu recours à des styles musicaux variés.

Vous avez écrit en 2001 un article théorique sur Béla Tarr. La manière dont son œuvre pointe à un état primal du cinéma, précédant ces années 1920. Non seulement pré-Hitchcock, mais pré-Griffith, précédant le montage dit désormais « traditionnel ». Qu’est-ce qui vous intéresse dans cet état primal du cinéma ?
J’avais l’impression que ce que faisait Béla précédait les années 1920, une direction prise depuis par le médium. Qu’il reprenait une potentialité laissée vacante au début des années 1910, avant que le cinéma ne se soit figé dans ses règles, une grammaire gelée. Qu’il avait trouvé une langue. Miklós Jancsó, autre cinéaste hongrois, l’a probablement influencé dans cette direction, avec ses longs travellings, mais je l’ai en ce qui me concerne découvert par après. J’ai vu les films de Béla avant ceux de Jancsó. Ils m’ont frappé en tant qu’ils traitaient de quelque chose qui m’a toujours préoccupé : la manière dont la plupart des films ont intégré un règlement d’où la caméra est censée être posée pour préparer la coupe. L’idée d’un cadre correct pour permettre le montage invisible. Je me suis toujours interrogé sur la manière dont ce langage cinématographique, aux règles très strictes, a été établi… et comment l’affecter ou le changer. Béla paraît avoir réglé ce problème en décidant simplement de ne pas couper du tout. Il évite le montage. Cette réponse simple m’a libérée. Regardez aujourd’hui les gens faisant chez eux des vidéos, les postant sur YouTube, Twitch ou Instagram. Ils défient également ce règlement, dans leur cas pour la simple raison qu’ils l’ignorent. Ils utilisent simplement leurs caméras pour enregistrer des choses qui leur arrivent, sans nécessairement se plier à cette loi de la coupe ajustée à un cadre approprié. Tant de gens font cela que notre grammaire collective ne s’inquiète plus des changements de direction d’écran. Les shows télévisés sont souvent filmés à deux caméras, en transition constante d’une face de l’action filmée à son envers. Je pense qu’une part de ce phénomène vient d’une habituation par YouTube. Nous ne sommes plus dérangés par ce qui était auparavant perçu comme la violation d’une règle.
Seriez-vous intéressé à expérimenter ces formes ?
C’est ce que j’ai toujours fait. Mais il a fallu Béla, et quelques autres, pour que je me sente moins seul dans cette expérimentation. Ils m’ont fait réaliser que la grammaire allait changer… pour des raisons probablement arbitraires, même pas intentionnellement. En raison de la popularité de certaines formes nouvelles…
En raison de la technologie elle-même…
Oui. Si beaucoup de gens regardent la même chose, cela devient la nouvelle grammaire. Et ils ne le regardent généralement pas en raison des techniques appliquées, mais des stars incluses dans ces vidéos. Qui que soient ces nouvelles célébrités. Ce qui est exactement la manière dont le cinéma des origines est passé d’un statut forain à un art de masses. Par l’identification massive à des personnalités connues. Dans le cas des nouvelles formes vidéo il peut bien s’agir de Cameron Dallas, de ces gamins qui se jettent des tartes à la figure… tant que des masses de personnes les regardent, c’est là que la grammaire s’écrit. Le lexique change en raison de la popularité, quand bien même on parle de celle qui irait aux chansons de Justin Bieber.

Quelle relation entretenez-vous vous-même à la notion de star, sachant que vous avez tourné et avec des célébrités et avec des inconnus ?
Je ne sais pas… La première star avec laquelle j’ai travaillé devait être Matt Dillon, dans Drugstore Cowboy. Travailler avec une star paraît impliquer un univers préalable, celui de la personne célèbre, que vous intégrez au vôtre. Une entité vous préexiste, que vous intégrez autant qu’elle vous intègre. Vous faites désormais partie de son évolution, en tant qu’artiste connu indépendant de votre travail. Je ne sais pas à quel point cela a affecté la fabrication de Drugstore Cowboy, mais j’étais conscient de ce processus. Que le film allait faire partie de sa propre collection, que nous faisions ensemble quelque chose qui serait une étape de la filmographie de chacun. Quand vous travaillez avec quelqu’un qui n’est pas, ou pas encore, célèbre, comme Matt Damon dans Will Hunting, sans pouvoir savoir s’il le deviendra ou non, les choses se font plus dans l’instant. Vous ne pouvez pas deviner à quoi elles vont mener, vous en êtes au point de départ. Il y a de l’excitation dans cette part d’inconnu.
Vous avez eu comme chef-opérateur feu Harris Savides. Étant un inconditionnel de son travail, je serais curieux de vous entendre à son sujet. Pourriez-vous revenir en quelques mots sur votre collaboration ?
C’était très amusant de travailler avec lui. Il était drôle. Il ne voulait pas s’engager dans quoi que ce soit de désagréable. Il faisait de la publicité pour cette raison. Le tournage d’une pub ne durant que quelques jours, si ça s’avérait une expérience désagréable, elle ne l’était que pour cette courte durée. Le tournage d’un film pouvant durer jusqu’à deux mois ou plus, il hésitait à s’engager, car cela pouvait signifier deux mois ou plus de difficultés, voire de douleur. Il se préoccupait beaucoup d’être sur un plateau harmonieux. Il recherchait l’harmonie en toutes choses. D’un point de vue stylistique, lui et moi ne faisions que partir de l’idée que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Commencer quelque part, construire à partir de là les règles de ce que nous ferions. Ce qui généralement se terminait par un traditionnel travail en 35 millimètres. Nous commencions ailleurs : par de la vidéo amateur, de la professionnelle, du 8 millimètres, du 70, du 16… Et nous finissions par nous fixer sur un bête format 35, informé par ces recherches. Cela restait pour nous l’outil ultime. Son décès coïncide avec la maturation de la haute définition, à laquelle nous pensions pour notre travail en commun. Nous voulions aller vers le digital, mais cette technologie était à nos yeux toujours un peu trop lente pour nous. Nous avons donc fini notre collaboration par du 35 millimètres.
Propos recueillis le 24 octobre à Lausanne. Remerciements à Anna Percival.