Pentagon Papers : contradictions virtuoses
La maîtrise formelle du cinéaste suffit-elle à pallier les contradictions inhérentes à son scénario ?
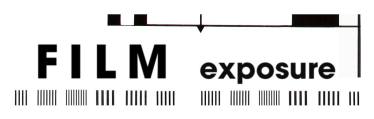 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
La maîtrise formelle du cinéaste suffit-elle à pallier les contradictions inhérentes à son scénario ?
 Il semblait essentiel pour Steven Spielberg de réaliser The Post (ou Pentagon Papers en VF) pendant la post-production de son prochain blockbuster, Ready Player One. En seulement neuf mois, le cinéaste a donc tourné et finalisé un film qu’il considère d’actualité et d’importance, faisant suite, par la même occasion, à son entreprise de glorification de la Constitution américaine entamée avec Lincoln et poursuivie dans Bridge of Spies. Le genre cinématographique dédié au journalisme d’investigation apparaît avant tout exister dans le paysage américain. Il est bien sûr possible de trouver des exemples internationaux, mais aucun autre pays n’a voué tant d’attention et d’énergie au sujet à travers le 7e art. Déjà à l’ère pré-code Hays, les films journalistiques s’étaient multipliés suite à la sortie de la comédie The Front Page (Lewis Milestone, 1931). Passés ensuite par la case film noir et complots, Spielberg va aujourd’hui s’attacher à cimenter leur portée politique. Évidemment motivé par l’atmosphère actuellement tendue aux États-Unis quant aux rapports de la presse avec le pouvoir, le réalisateur a décidé de mettre tout son talent (et il en a à revendre) au service d’un récit dévoré par ses contradictions idéologiques.
Il semblait essentiel pour Steven Spielberg de réaliser The Post (ou Pentagon Papers en VF) pendant la post-production de son prochain blockbuster, Ready Player One. En seulement neuf mois, le cinéaste a donc tourné et finalisé un film qu’il considère d’actualité et d’importance, faisant suite, par la même occasion, à son entreprise de glorification de la Constitution américaine entamée avec Lincoln et poursuivie dans Bridge of Spies. Le genre cinématographique dédié au journalisme d’investigation apparaît avant tout exister dans le paysage américain. Il est bien sûr possible de trouver des exemples internationaux, mais aucun autre pays n’a voué tant d’attention et d’énergie au sujet à travers le 7e art. Déjà à l’ère pré-code Hays, les films journalistiques s’étaient multipliés suite à la sortie de la comédie The Front Page (Lewis Milestone, 1931). Passés ensuite par la case film noir et complots, Spielberg va aujourd’hui s’attacher à cimenter leur portée politique. Évidemment motivé par l’atmosphère actuellement tendue aux États-Unis quant aux rapports de la presse avec le pouvoir, le réalisateur a décidé de mettre tout son talent (et il en a à revendre) au service d’un récit dévoré par ses contradictions idéologiques.
En 1951, Billy Wilder mettait en boîte Ace in the Hole, un fascinant portrait du journaliste opportuniste, ambitieux, malhonnête et talentueux. « Bad news sell best » (« rien de mieux que les mauvaises nouvelles pour vendre »), apprenait-on, alors que son protagoniste, à la fois répugnant et captivant, transformait un fait divers en événement cataclysmique afin d’obtenir l’article juteux qu’il avait tant espéré. Avance rapide jusqu’en 2017 : Steven Spielberg, metteur en scène tout aussi doué sinon plus, propose un film d’apparence en contre-point, dédié à la lutte acharnée de journalistes intègres pour la publication d’informations secret défense révélant la machine géopolitique destructrice et incontrôlable ayant entraîné et alimenté la guerre du Vietnam dans toute sa laideur. Sur leur chemin, Kay Graham, propriétaire du Washington Post, et Ben Bradlee, son rédacteur en chef, vont devoir s’opposer aux tentatives de sabotage provenant à la fois du gouvernement et des actionnaires du journal, dont les intérêts financiers ne s’alignent pas avec leur mission. Un enjeu double, visant à aborder à la fois l’importance de la liberté de la presse et son rôle dans le contrôle qu’elle s’imagine exercer sur les représentants du pouvoir.
Au cours de son projet cependant, Spielberg oublie (ou choisit d’oublier) que le monde n’est pas noir et blanc : dans The Post, absolument tous les agents gouvernementaux sont des ordures manipulatrices, tous les hommes d’affaires sont des arrivistes amoraux, et tous les journalistes sont des chevaliers irréprochables de la vérité par-dessus tout. La forme définit elle-même cette approche : dans le placement de ses personnages, Spielberg décide de faire évoluer Graham et Bradlee, les forçant progressivement à conquérir leurs plans, repoussant les autres forces du récit à la périphérie de l’image. Nixon, mimé de dos à travers une fenêtre, est réduit à une figure de pantomime grotesque, tandis que les autres saboteurs potentiels sont vaincus un à un par le cadrage calculé du réalisateur. Soit. Mais alors le film bascule de l’anecdote historique à la mythologisation journalistique.
Il ne s’agit pas nécessairement d’un mal en soi, seulement ici, son histoire renferme des contradictions frappantes. Si la recherche et la divulgation de la vérité sont au centre du récit, l’obsession mégalomaniaque des reporters à vouloir imposer leur journal comme étant le premier à publier un scoop est confondante. Recevant les fameux Pentagon Papers, Bradlee et son équipe travaillent d’arrache-pied pendant dix heures pour publier le lendemain même. Cette intégrité si chère au cinéaste ne devrait-elle pas les enjoindre à faire preuve de sang-froid, à étudier patiemment les milliers de pages reçues, et à en tirer des conclusions analytiques ? Le film ne fait pas totalement la sourde oreille et aborde le paradoxe l’espace de quelques dialogues. Seulement le doute ne nait jamais chez le rédacteur en chef, et celui représenté chez Graham est beaucoup plus économique qu’éthique. En d’autres termes, la problématique est balayée d’un revers de la main : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, nous affirme le cinéaste, et parfois la recherche de la vérité s’apparente bien étrangement à celle de la postérité. La transformation d’une histoire vraie en film amène obligatoirement son lot de fiction, et en héroïsant à outrance ses reporters, en les rendant incapables d’autocritique réelle face à leur névrose pour la course aux nouvelles, le réalisateur risque constamment de les dépeindre comme des « newsmongers », ces divertisseurs intéressés par la publication de titres juteux avant tout (ce qui, remarquons-le, représente un danger vers lequel les médias américains s’approchent aujourd’hui de plus en plus). Le problème inhérent à l’approche adoptée par Spielberg réside dans le danger de basculement de son récit vers une apologie du système logistique des médias américains. Dans la façon qu’il a d’ignorer les problématiques satellites pourtant tangibles (mise en danger des employés du journal, ou salissure indélébile de la réputation des politiciens et de leur famille), le film rappelle l’impitoyabilité dont sont capables les journalistes pour arriver à leurs fins, à tel point qu’un film aussi antithétique que Five Star Final (Mervyn LeRoy, 1931) et sa dénonciation des méthodes des tabloïds viennent à l’esprit.
La mythification de la Constitution à laquelle s’adonne Spielberg depuis Lincoln prend en outre un tournant ironique ici, The Post se voulant être une apologie du 1er amendement bien que celui-ci soit malmené au quotidien sur l’ensemble du spectre politique actuel. Mais le paradoxe le plus singulier tient de l’essence même du genre dans sa variante élogieuse telle que présentée ici : le film journalistique tente sans relâche de perpétrer le culte de la vérité comme valeur suprême dans la conscience collective américaine, alors même que le pays a fondé son hégémonie mondiale sur un tissu de mensonges inextricables et qu’il n’a eu de cesse, depuis les années 1950, de s’inviter dans les affaires des autres sous de faux prétextes. À se demander qui aurait des leçons à recevoir de la part de la culture américaine sur les vertus de la vérité.
Surtout, l’accumulation de ces incompatibilités amène à se poser une autre question : tout aussi louable l’objectif de ces personnes eut-il été (la guerre du Vietnam était, après tout, une mystification odieuse servant des intérêts indéfendables), qu’a apporté leur travail en faveur de la place de la vérité dans la société américaine ? Tout le monde s’accordera à dire que la situation n’a pas vraiment évolué dans le sens escompté. Alors certes, « bad news sell best », c’est vrai. L’avenir nous dira sur quoi leurs remplaçantes, les « fake news », déboucheront. Un personnage de The Post rappelle évidemment le rôle des journalistes tel qu’envisagé par les Pères fondateurs : « La presse est au service des gouvernés, pas des gouvernants ». Tout souci de nuance aurait également conduit à la conclusion que les gouvernants sont également au service des gouvernés, et que la presse comme ces derniers sont en position d’abuser de leur pouvoir. Les ennemis absolus, ces super-vilains filmés de dos et de loin dans l’encadrure d’une fenêtre de la Maison Blanche, n’existent que dans les mythes, pas dans l’Histoire. Le film est truffé de compromis intellectuels douteux de la sorte, qui affaiblissent sa légitimité en tant qu’examen pertinent de la presse moderne. Par exemple, une scène prometteuse voit les deux protagonistes commencer à remettre en question leurs rapports respectifs avec les présidents ayant servis lors de la guerre du Vietnam, Kennedy compris, pour finalement se terminer en queue de poisson, sans oser mettre les personnages face à leurs contradictions. The Post refuse ainsi d’aborder les aspects les plus épineux de son sujet (quelles retombées réelles pour les informateurs et les inculpés – aucune, en ce qui concerne ceux-ci –, quelles ramifications à l’entrée en bourse des journaux, qui tombent alors sous l’influence de multiples hommes d’affaires, etc.). Chez Spielberg, la justice est une extension de la vérité, et l’insoumission la garante de la démocratie. Et ce n’est pas négociable.
Le cinéaste est donc trop focalisé sur les enjeux du monde réel pour nuancer sa fiction. Si sa vision est trop monochrome, ses plans, eux ne le sont pas, bien au contraire. L’usage que fait le réalisateur des couleurs s’avère être d’une efficacité remarquable en termes de narration visuelle. Cela se révèle être particulièrement frappant dans les plans filmés à l’intérieur du bureau de Ben Bradlee, dans lesquels la scénographie véhicule à elle seule les rapports de force entre personnages (évoluant dans son monde, ce dernier occupe les cadres et plie l’identité visuelle du bâtiment à la sienne, forçant un environnement naturellement neutre à adopter des teintes grises bleutées), mais pas seulement. Lors de la première scène entre Graham et Bradlee, celle-ci est dépeinte comme l’outsider, l’élément perturbateur. Bradlee, dont les vêtements sont à nouveau assortis aux couleurs de l’arrière-plan, tire sans cesse vers lui la caméra, même lorsque Graham tente de s’exprimer. Plus tard, alors que la décision fatidique de publier ou non les révélations approche, Bradlee rend visite à sa patronne chez elle. Les positions sont alors inversées, à la fois physiquement et chromatiquement, donnant ainsi l’ascendant à Graham.
Le cheminement de cette dernière constitue par ailleurs l’un des aspects les plus réussi du métrage, spécifiquement parce que Spielberg narre son évolution d’héritière indécise à femme de tête de façon visuelle avant tout. Lors de sa première réunion de groupe, Graham est donc décentrée, filmée à l’oblique, et constamment encadrée par des hommes. Au moment où elle s’affirme définitivement et ordonne de publier les Pentagon Papers, Spielberg fait exploser le cocon dans lequel elle était prisonnière en éparpillant les hommes, habillés achromatiquement à la pièce, autour d’elle, et en la faisant sujet-maître du cadre. Il s’agit là de stratégies narratives discrètes d’une logique implacable et d’une efficacité redoutable. Bien que bavard, le film pourrait être regardé sans ses dialogues et ne perdrait pas de son impact, tout simplement parce que chaque séquence importante est construite en actes clairement démarqués par la mise en scène. En bref, le cinéaste signe, une fois de plus, une leçon de réalisation magistrale.
L’urgence ressentie à terminer le film ressort toutefois en cela qu’aucune émotion ne peut naître d’un script et d’une réalisation aussi fonctionnels. Les personnages ne semblent pas tellement avoir de vie en dehors de l’intrigue, et le rythme est si effréné qu’il ne laisse jamais le temps au spectateur de développer une relation avec ces individus. Tout dans The Post est pensé pour contribuer à l’expression d’une position idéologique, jusqu’à la façon qu’a Spielberg de filmer l’impression des journaux comme il filmerait une fusillade dans la jungle vietnamienne (accélération des plans, montage frénétique, énergie cinétique renforcée, etc.).
Le film se termine sur un appel au célèbre thriller d’Alan J. Pakula, All the President’s Men, œuvre normative qui traitait de l’enquête ayant mené au scandale du Watergate. Spielberg s’approprie avec une virtuosité structurelle confondante les codes du genre pour appliquer, métaphoriquement, la problématique à la société contemporaine, sans pour autant parvenir à s’extraire des contradictions inhérentes à l’entreprise. L’ombre qui plane au-dessus de ce récit est bien entendu celle de Donald Trump, l’homme qui a – peut-être pour longtemps – détruit les fondamentaux du pouvoir de la presse en réduisant à néant la validité des interviews (chaque entretien contenant des informations contradictoires), en instaurant une ligne de communication directe avec ses partisans (notamment Twitter), et en survivant encore et toujours à des scandales qui auraient suffi à pulvériser plusieurs fois de suite la carrière politique de n’importe lequel de ses prédécesseurs. La transformation de la vie politique en récit à rebondissements inépuisables (prédite, en outre, par un autre grand film des années 1970), tend désormais à rendre caduque le pouvoir des journalistes d’investigation, les forçant à adopter une immédiateté qui en fait des rapporteurs de ragots inintéressants. Spielberg l’a parfaitement compris et, se trouvant à l’opposé de l’échiquier politique, a fait de The Post l’extension de ses convictions idéologiques. Reste à savoir si le film deviendra une lettre d’amour salvatrice pour le métier, ou un cri désespoir sans portée dans l’océan des hurlements de ceux qui ne veulent pas accepter la nouvelle Amérique.
Pentagon Papers
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Tom Hanks, Meryl Streep, Bob Odenkirk
Sorti en francophonie le 24 janvier 2018
1 commentaire »