DAAAAAALÌ! – Le Surréalisme du Cool
C’est presque devenu une habitude. Chaque année, depuis 2018, Quentin Dupieux nous livre, sans jamais faillir, son nouveau film. Drôle, absurde, court et libre. Une recette qui ne change pas […]
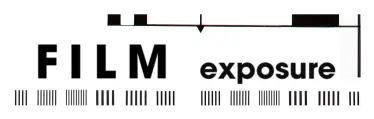 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
C’est presque devenu une habitude. Chaque année, depuis 2018, Quentin Dupieux nous livre, sans jamais faillir, son nouveau film. Drôle, absurde, court et libre. Une recette qui ne change pas […]
C’est presque devenu une habitude. Chaque année, depuis 2018, Quentin Dupieux nous livre, sans jamais faillir, son nouveau film. Drôle, absurde, court et libre. Une recette qui ne change pas vraiment, mais dont on ne se lasse apparemment pas. Pourtant cette année, quelque chose a peut-être changé. Une étape a peut-être été franchie. Daaaaaalì, son cru 2024, serait son film miroir, celui où il rend aux surréalistes ce qu’il leur avait emprunté.
Judith, pharmacienne plus ou moins reconvertie au journalisme, est passionnée par le peintre Salvador Dalì. Au point qu’elle lui propose un projet de film-portrait aux moyens financiers illimités, à la hauteur de la grandiloquence de sa personnalité. Malheureusement, à chaque tentative de tournage, ce dernier est arrêté. En parallèle, Dalì est invité à dîner par son jardinier. Lors du repas, un prêtre raconte à l’artiste un rêve étrange qu’il a eu et qui à chaque fois qu’on le croit fini ne l’est pas. Alors que le tournage du film ne semble jamais pouvoir commencer, le rêve lui ne semble jamais pouvoir se terminer.
 Loufoque, barré, cinglé, timbré, burlesque, absurde, décousu, sans queue ni tête. Les épithètes et les expressions ne manquent pas pour qualifier le cinéma de Quentin Dupieux. Ils éclosent dans la presse et les commentaires à chaque nouvelle entrée dans la filmographie du Frenchie, devenu aujourd’hui l’unique porte-étendard du cinéma bête mais cool. Pourtant, au delà de cette lecture simpliste, se dissimule un procédé artistique complexe qui a depuis longtemps fait ses preuves, puisqu’il a été pour la première fois décrit il y a tout juste un siècle, en 1924 (une date que Dupieux n’ignore sûrement pas), par André Breton dans son célèbre Manifeste du Surréalisme :
Loufoque, barré, cinglé, timbré, burlesque, absurde, décousu, sans queue ni tête. Les épithètes et les expressions ne manquent pas pour qualifier le cinéma de Quentin Dupieux. Ils éclosent dans la presse et les commentaires à chaque nouvelle entrée dans la filmographie du Frenchie, devenu aujourd’hui l’unique porte-étendard du cinéma bête mais cool. Pourtant, au delà de cette lecture simpliste, se dissimule un procédé artistique complexe qui a depuis longtemps fait ses preuves, puisqu’il a été pour la première fois décrit il y a tout juste un siècle, en 1924 (une date que Dupieux n’ignore sûrement pas), par André Breton dans son célèbre Manifeste du Surréalisme :
« Le surréalisme est un automatisme psychique pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit par toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. »
Une affirmation que Dupieux reprend à son compte dans la scène d’ouverture de son deuxième long-métrage Rubber, où le personnage de Chad (Stephen Spinella) monologue sur le manque de sens de beaucoup d’aspects narratifs et parfois visuels de la plupart des films américains. Ce qu’on pourrait appeler l’effet « No reason ». Dupieux serait donc un surréaliste tardif. En effet. Et il n’y a rien de plus simple à démontrer, puisque tous ses films en font leurs fondations. Du conduit rajeunissant d’Incroyable mais vrai au blouson en daim du Daim, en passant par la mouche géante de Mandibules. Chaque élément déclencheur est absurde et donne suite à une progression scénaristique de surenchère surréaliste.
Cependant, Dupieux ne s’était jusque là jamais vraiment regardé dans le miroir. Il avait continué à faire ses films à un rythme effréné sans questionner ses inspirations, sans les analyser et sans s’analyser, ce que son aspiration surréaliste lui interdisait justement de faire. Avec Daaaaaalì!, il le fait pour la première fois et livre son film le plus méta (comme on dit de nos jours). Loin des Inception ou autre Spider-man: No Way Home, auxquels il a pauvrement pu être comparé, Daaaaaalì! revient aux sources et convoque le représentant le plus ampoulé et médiatisé de ce mouvement artistique. Salvador Dalì donc, peintre et personnage hors-normes lui-même. Du pain d’autant plus béni pour Dupieux, qui n’a alors pas besoin d’inventer de protagoniste farfelu, mais de s’appuyer sur celui réel de l’artiste espagnol. Mais ce dernier n’est pas seul. Car si l’image lui appartient, la caméra est bien celle d’un autre surréaliste bien connu des cinéphiles, Luis Buñuel. On notera d’ailleurs au passage que le son premier film, Un Chien Andalou, en 1929, a été co-écrit par Dalì. Et on notera également que son dernier film, Le Charme discret de la bourgeoisie, en 1972, est l’une des influences majeures du cinéma de Dupieux, qu’il cite plusieurs fois dans sa filmographie, mais auquel il rend enfin un hommage direct dans Daaaaaalì!, avec une fameuse scène de repas et l’utilisation à outrance de rêves ou d’éléments narratifs imbriqués dans d’autres rêves ou dans d’autres éléments narratifs. Gimmick comique que Dupieux sait parfaitement réemployer à son avantage.
Salvador Dalì est ainsi l’objet protéiforme du film qui porte son nom (avec l’accent) et se présente sous les traits de quatre comédiens : Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï et Gilles Lellouche (choisissez votre préféré). Autant d’alter-egos que Dupieux utilise non pas pour montrer les diverses facettes de Dalì, le personnage étant cohérent d’un comédien à l’autre, mais pour brouiller les pistes quant à une quelconque identification du spectateur et pour répondre à l’idée surréaliste du « pourquoi pas ? ».
C’est surtout l’occasion pour Dupieux de se refléter, consciemment ou inconsciemment, dans l’image du peintre qui a fait de sa propre personne une œuvre d’art. Contrairement à la plupart de ses contemporains, Dalì avait compris que pour vendre il fallait se mettre en scène et être partout. Le talent, le génie même, ne suffisent pas. Il s’autoproclamait ainsi, sans hésitation, plus grand peintre du XXe siècle et inventa un personnage burlesque et extraverti qui fit sans cesse parler de lui dans le monde l’art et dans les médias. Si Quentin Dupieux, lui, n’est pas comme son modèle, dans l’outrance vestimentaire, verbale ou maniériste, force est de constater que depuis son retour des États-Unis, il fait preuve d’une omniprésence cinématographique dont personne en France ne peut se targuer. Un film par an. Un rythme qu’il tenait d’ailleurs aussi en Amérique, avec quatre films en cinq ans, de 2010 à 2014. La durée de ses films, qui dépasse rarement les 80 minutes, lui permet également une présence étendue dans les salles, en terme de nombres de projections possibles par jour, et qui rend ses œuvres plus accessibles car moins chronophages pour les spectateurs que la plupart des autres films proposés, productions hollywoodiennes en tête.
Et s’il y a quelque chose qui le démarque encore plus du reste des cinéastes actuels, c’est bien sa tendance au cool, à la bêtise acceptable, au dilettantisme politiquement correct. Dans l’essence de ses films d’abord, qui survendent leur aspect « sans prise de tête », leur dimension comique, leur casting quatre étoiles, leur impression d’être conçu à l’instinct, sans trop de réflexion, et leur réalisation système D (le fameux argument du premier film réalisé entièrement avec un appareil-photo, pour Rubber). Ce qui n’est qu’esbroufe. Dupieux est intelligent et travailleur. Si ses idées naissent d’un procédé surréaliste, leur mise en application, elle, est tout sauf laissée au hasard de la pensée. Il sait exactement ce qu’il veut lors du tournage, il sait accorder ses budgets à ses ambitions et il a su se construire un réseau d’amitiés qu’il utilise souvent (la musique de Daaaaaalì! est par exemple signée par Thomas Bangalter, ex-Daft Punk). Puis dans sa personne en elle-même. Mal coiffé, barbe proéminente approximativement taillée, casquettes trucker inesthétiques, chemises bleu claires aux trois premiers boutons toujours ouverts, etc. Dupieux s’en fout, Dupieux est cool, nonchalant, Dupieux s’accorde à ses films et vice versa. Il est un peu hipster, un peu bobo, un peu intello, mais toujours relax et rigolard. Dans l’air du temps, reflet d’une certaine intelligentsia parisienne plutôt de gauche, qui aime s’autoriser l’approche enfantine et la bêtise populaire de ce cinéma. Que cela soit volontaire ou non, ces parallèles entre Dupieux et Dalì ne font que renforcer cette impression de ressemblance, dans la méthode et dans le paraître.
Autre aspect d’identification entre les deux artistes de Daaaaaalì! : la transformation en cinéaste. En effet, dans l’intrigue, Judith (Anaïs Desmoustier) finit par laisser le projet de film-portrait lui échapper et être repris par Dalì lui-même, qui se met alors en tête de réaliser un documentaire sur Judith, sans que cette dernière ne s’en rende vraiment compte. Comme l’affiche du film l’annonce, le peintre devient donc réalisateur. On le sait, Dupieux est devenu célèbre malgré lui en tant que musicien, sous le pseudonyme de Mr. Oizo et avec le titre Flat Beat en 1999. Une image qui lui colle encore aujourd’hui à la peau, alors que son ambition première était de faire des films. Il avait d’ailleurs, dès 1995, déjà réalisé plusieurs courts-métrages et vidéo-clips (notamment pour Laurent Garnier) avant de commencer, un peu par hasard, la musique. Le réalisateur devenu musicien aimerait n’être plus que réalisateur.
Ainsi, s’il est étonnant de voir Quentin Dupieux s’arrêter pour la première fois, le temps d’un film, sur ses inspirations et sur la personnalité de son cinéma, il est rassurant de voir que cela est loin de suffir à l’assagir, qu’il restera encore longtemps un grand enfant à la créativité effrénée (Braces et À notre beau métier, ses deux projets sont déjà dans les tuyaux), avec pour seul guide et mot d’ordre une paraphrase surréaliste : « Il n’y a rien de plus beau dans l’art que de ne pas réfléchir ».
DAAAAAALÌ!
Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï, Gilles Lellouche
Sortie en Suisse encore inconnue. Sortie en France le 7 février 2024.