Hereditary : affres et volupté de l’afféterie stylistique
Le zèle dont fait preuve Aster dans la fabrication de son film ne risque-t-il pas de distraire des émotions recherchées ?
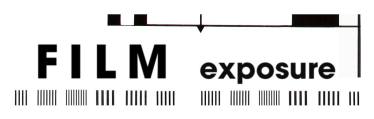 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Le zèle dont fait preuve Aster dans la fabrication de son film ne risque-t-il pas de distraire des émotions recherchées ?
 Vous connaissez le refrain : un petit nouveau aux dents longues souhaite se faire sa place dans l’industrie, réalise un film d’horreur sortant du lot, crée la sensation en festival, puis bénéficie d’un énorme entrain dans les quelques semaines précédant sa sortie réelle. Parfois, les œuvres en question s’avèrent marquer assez durablement le milieu pour que l’on en parle encore quelques années plus tard (It Follows, The Witch) ; d’autres deviennent plus effacées presque aussi rapidement (It Comes at Night). Pour toutes, une seule question semble primer sur le reste : le film est-il terrifiant ? L’on pourrait penser qu’il s’agit d’une question légitime, mais comme on ne mesure pas le succès d’une comédie à sa simple capacité à faire rire, la propension d’un film d’horreur à effrayer n’est finalement pas très importante d’un point de vue critique. Cela décidera certes de son succès public, mais pas tellement de sa pérennité artistique. Hereditary fait-il peur ? Ce n’est pas la bonne question…
Vous connaissez le refrain : un petit nouveau aux dents longues souhaite se faire sa place dans l’industrie, réalise un film d’horreur sortant du lot, crée la sensation en festival, puis bénéficie d’un énorme entrain dans les quelques semaines précédant sa sortie réelle. Parfois, les œuvres en question s’avèrent marquer assez durablement le milieu pour que l’on en parle encore quelques années plus tard (It Follows, The Witch) ; d’autres deviennent plus effacées presque aussi rapidement (It Comes at Night). Pour toutes, une seule question semble primer sur le reste : le film est-il terrifiant ? L’on pourrait penser qu’il s’agit d’une question légitime, mais comme on ne mesure pas le succès d’une comédie à sa simple capacité à faire rire, la propension d’un film d’horreur à effrayer n’est finalement pas très importante d’un point de vue critique. Cela décidera certes de son succès public, mais pas tellement de sa pérennité artistique. Hereditary fait-il peur ? Ce n’est pas la bonne question…
Le plan d’ouverture du premier film d’Ari Aster donne le ton : un lent travelling avant sur une maison miniature reconstituant la demeure de la famille Graham nous entraîne dans la chambre du fils aîné. L’univers factice laisse place aux décors réels et aux personnages de chair et de sang dans une transition invisible, et voilà que l’intrigue démarre : Annie, son mari Steve et leurs enfants Peter et Charlie se rendent aux obsèques de la grand-mère, Ellen. Figure mystérieuse, son décès met en route une série d’événements tragiques qui risquent de les livrer aux mains de forces ténébreuses insaisissables.
Le cinéaste, qui n’en n’est pas à sa première fiction dédiée à une famille dysfonctionnelle, ne pourrait être plus clair dans ses intentions : nous allons assister à la manipulation de marionnettes par des forces supérieures, à savoir lui-même, bien sûr, mais également celles qui se révéleront finalement dans la diégèse. Sa réalisation embrasse donc son précepte conceptuel à travers de malignes techniques narratives. On compte par exemple parmi elles les plans en steadycam qui suivent brièvement les personnages d’une pièce à l’autre, comme si le marionnettiste se déplaçait en même temps que ses figurines, créant ainsi la sensation que le point de vue appartient à une entité existant par-delà le champ sensoriel des Graham. Autre idée remarquable : les transitions immédiates, qui transportent un personnage d’un lieu à l’autre dans la même position (comme on le ferait avec une statuette), ou passent de la nuit au jour comme si on allumait soudainement la lumière de la pièce occupée.
L’approche réfléchie et appliquée d’Aster implique sans surprise une dépendance parfois outrancière aux symboliques annonciatrices. Il jonche ainsi son récit de symboles reconnaissables, de situations récurrentes, d’appels répétés au spectateur à effectuer des connexions avec ce qu’il aurait vu précédemment. Impossible, alors, de ne pas se dire que la décapitation se transforme finalement en stratagème métaphorique, ou de ne pas voir en certains échos visuels une volonté trop appuyée de rationaliser un récit qui aurait gagné en mystère. On compte notamment l’emblème porté autour du cou par la grand-mère, revu sur un poteau en bord de route ou sur un plafond ; le coup de ciseaux que Charlie donne à un oiseau mort, préfigurant l’évolution de plusieurs personnages ; la contorsion physique grotesque du fils possédé, qui revient lors du dénouement ; les références explicites à La Folie d’Héraclès par Euripide et au mythe d’Iphigénie formulées pendant les scènes en salle de classe, et qui concernent l’infanticide ; les jouets à l’apparence de mannequin que construit la petite Charlie, qui présagent de l’iconographie finale ; ou encore le plan renversé à 180° de Toni Colette qui semble la faire marcher au plafond.
Dans ses stratégies purement formelles, le film se distingue également par ses efforts à créer (avec une rapidité déconcertante) des moments de tension et d’effroi potentiels peu vus au cinéma dernièrement, notamment à travers un jeu d’aguichage maîtrisé avec les attentes du spectateur, l’emploi d’un leitmotiv sonore particulièrement évocateur, ainsi que des compositions chromatiques et de lumière travaillées, qui tirent parfois profit du temps d’adaptation de l’œil humain à un certain niveau d’obscurité.
Que l’on soit clair : tous ces éléments contribuent à épaissir la densité et la richesse du métrage, mais revêtent également un incontrôlable effet de distraction, susceptible de sortir du récit les spectateurs souhaitant relever lesdits signes, lesdites propositions. C’est là toute la fragilité d’une réalisation par ailleurs exemplaire : il est compliqué de parler à la fois au cœur et à l’esprit, de travailler à l’implication émotionnelle du spectateur tout en le nourrissant à d’autres niveaux, en tout cas avec un degré d’ambition tel qu’exposé ici. L’histoire de Hereditary conte une tragédie familiale déchirante, sincère, puissamment interprétée par des acteurs formidables, tandis que son appareil narratif sophistiqué sollicite constamment une réflexion portant sur les mécanismes, les thèmes et l’imagerie. Pour autant que l’on soit prêt à abandonner l’un de ces deux aspects lors du visionnage (et de revenir à l’autre lors du suivant), le film est à même de transcender son anecdotique réputation sundancienne afin de proposer une expérience de cinéma globalement gratifiante.
Attention : le texte qui suit révèle des éléments clés de l’intrigue. Il est conseillé d’avoir vu le film avant d’en poursuivre la lecture.
On le sait bien : le fond d’un film n’est autre que sa forme, et les menaces structurelles liées au foisonnement des sophistications formelles évoquées se retrouvent en substance dans sa résolution. Difficile donc de ne pas s’arrêter sur le dernier tiers du récit, une conclusion rationnellement et thématiquement satisfaisante, mais qui, là encore, met en péril l’implication du spectateur en imposant une sérieuse dissonance tonale par rapport au reste de l’histoire. On pourrait sans doute s’en accommoder si la bifurcation avait été moins brutale, mais en l’état, l’immensément efficace sobriété du film est trop abruptement sacrifiée sur l’autel du paranormal. Dès lors qu’Annie consulte les ouvrages ésotériques de sa défunte mère, le script enquille les explications et révélations parfois un peu poussiéreuses (la nouvelle amie en réalité au centre d’un complot de sectateurs en tête) qui viennent trancher avec la volonté d’innovation jusque-là observée. Ce troisième acte transforme un récit potentiellement universel en conte démoniaque détaché du réel, il élimine l’immense potentiel allégorique cumulé avec patience et le déverse sans broncher dans la dimension du fantastique grand-guignolesque qui ne signifie finalement pas grand’ chose (genre tout à fait louable en lui-même lorsque pleinement invoqué, l’auteur de ces lignes appréciant par exemple le généreux Insidious). La diégèse de Hereditary, que l’on pensait accessible à quasiment tout le monde, se resserre brusquement au risque de laisser derrière lui les spectateurs imperméables au détournement vaguement iconoclaste de l’imagerie chrétienne : le Christ pantocrator baisse les doigts, son auréole devient un amas de tiges menaçantes (voir le Christ pendu par les pieds dans Ashes and Diamonds d’Andrzej Wajda, ou encore Pinhead en Messie dans Hellraiser 3), les corps vivent sans leur tête et les âmes changent de vaisseau corporel, tandis que le démon goétique Paimon s’impose comme manipulateur suprême de cette petite secte.
Encore une fois, le problème ne se trouve pas tant dans le fond, et voir Toni Colette léviter ou marcher au plafond aurait paru moins saugrenu ou déplacé si le film avait plus ouvertement adopté ses éléments surnaturels en amont. En l’état, la fin du métrage semble dans sa forme presque indépendante du reste, assez efficace en elle-même dans ce qu’elle se destine à accomplir mais moins lorsque raccordée au déroulement tendu et maîtrisé l’ayant précédé. The Witch se terminait également avec une élévation de son aura surnaturelle, mais restait plus réservé et avait surtout construit un environnement dans lequel ces éléments paraissaient organiques. The Babadook, moins exceptionnel dans sa fabrication, jouissait cependant de thèmes et d’une portée émotionnelle plus immédiatement accessibles. The Exorcist, auquel le film a été comparé sans doute précocement, alliait ces deux qualités, tissant un récit instantanément abordable (tout le monde connaît et comprend la notion de diable), continuellement teinté de paranormal. Le film d’Ari Aster attrape son public à la gorge grâce à une dramaturgie renversante renforcée par des interprétations incomparables, s’approchant ainsi de manière évidente aux réussites qu’avaient été Rosemary’s Baby de Polanski (pour la problématique maternelle) et Don’t Look Now de Nicolas Roeg (pour l’exploration du chagrin déchirant), avant de soudain relâcher son emprise en s’engageant les yeux fermés dans un registre en rupture brutale avec son traitement initial, comme si le cinéma et le public actuels exigeaient que l’horreur s’accompagne d’images éphémèrement perturbantes au détriment de la tenace impression de malaise qui aurait pu persister bien après le générique de fin. Reste tout de même une intéressante thématique sur la peur de l’héritage génétique, sur l’angoisse créée par la connaissance d’un passé familial traumatisant, et le désir de comprendre ses parents sans leur ressembler ; le tout porté à son interprétation extrême par le dénouement qui refuse d’accorder leur souhait aux personnages.
Dans son journal, l’écrivain André Gide avait décrit l’intérieur de la Chapelle des Espagnols comme des « fresques affétées », dans lesquelles « la difficulté n’y a été vaincue qu’en sacrifiant la beauté ». Aujourd’hui, Hereditary ne parvient à vaincre la plupart des poncifs éculés et à densifier son récit qu’en sacrifiant son immédiateté émotionnelle. D’une maîtrise technique incontestable, porté par une envie certaine de renouveler l’excitation pour le genre, et surtout d’une sincérité qui semble absolue (rien ne donne jamais l’impression d’avoir affaire à un film se regardant le nombril), Aster repose au final la question de l’épanchement substantiel. Si It Comes at Night, par exemple, refusait catégoriquement de donner la moindre réponse, Hereditary en offre peut-être un peu trop. Il est possible que le film vous fasse peur, mais cela ne regarde que vous. En attendant de savoir si son inconsistance tonale lui portera préjudice sur la durée, il serait quand même dommage de se priver d’une telle démonstration de talent.
Hérédité – Sortie le 18 juillet 2018 en Suisse
Écrit et réalisé par Ari Aster
Avec Toni Colette, Gabriel Byrne, Alex Wolff
J’ai l’avis précisément inverse sur le dernier tiers du film.
Sur le papier, Hereditary aurait pu dérouler son propos de film d’horreur psychologisante jusqu’à sa conclusion. Le script était d’ailleurs à l’origine un pur drame familial que Aster a transformé en film d’horreur pour avoir plus de chances de trouver un financement.
Ce faisant, il aurait très bien pu satisfaire les attentes d’un public client de films d’horreur « intelligents » où fantômes, sorcières ou démons sont des signifiants pour les angoisses qui étreignent tout un chacun face aux aléas de la vie (le deuil, la maladie, la maternité, les relations familiales, un environnement inconnu, etc.) Après tout, le genre a récemment connu quelques beaux succès aussi bien publics (même si ce public est une relative niche) qu’artistiques. Tu évoques It Follows et The Babadook. On peut aussi rajouter The Haunting of Hill House…
… sauf que, malgré les qualités de chacune de ces oeuvres, se pose toujours un peu la question : dans quelle mesure l’aspect psychologisant n’est-il pas une béquille sur laquelle les cinéastes peuvent s’appuyer et ainsi éviter de ne compter que sur la seule puissance brute et directe de leurs images ? Et, réciproquement, pourquoi le spectateur qui va voir les productions horrifiques estampillées A24 a-t-il besoin d’une forme de caution intellectuelle pour apprécier le film ?
Là où il aurait pu donner à son public ce qu’il attendait, à savoir l’aboutissement d’une accumulation allégorique, Aster vient soudain rappeler à ce même public que les figures folkloriques (démons, sorcières, fantômes) qu’il se complaît désormais à considérer comme littéralement insignifiantes, et donc comme de simples véhicules à allégories, ont une puissance évocatrice et horrifique propre, qu’elles n’ont pas besoin de « signifier » quelque chose pour marquer les esprits.
D’ailleurs, je ne suis pas d’accord sur la nature grand-guignolesque de son final. Contrairement au grand-guignol, Aster n’a aucune complaisance vis-à-vis des morts pleines d’hémoglobine. Même lorsque le personnage de Toni Colette se tranche la gorge avec une corde de piano, Aster met bien plus l’accent sur son visage et sur le bruit sec de la corde qui râpe que sur sa chair en train de se déchirer. En cela, il témoigne d’un profond respect pour l’imagerie qu’il convoque.
Du coup, quitte à oser cette tarte à la crème qu’est l’analyse « méta », je trouve que, si on veut trouver une allégorie poussée jusqu’à sa conclusion dans le film, elle se trouve chez le personnage de Tony Colette. Cette artiste qui règle ses traumatismes en les mettant en scène apparaît comme un reflet du public et des auteurs d’un certain cinéma d’horreur « cathartique » qui se retrouvent soudain dépasser par l’apparition soudain de puissances archétypales qui rendent dérisoires leurs petites névroses personnelles.
J’aimeJ’aime
Le Grand-guignol ferait-il donc preuve de moins de respect ?
Deux choses me dérangent : la transition est trop soudaine et telephonée pour être convaincante ; et surtout, Aster fait finalement marche arrière pour moi. C’est qui, les gens qui s’attendent à aller voir un film d’horreur intelligent sans imagerie codifiée ? Pas moi. Moi je veux juste voir un bon film. Si le film s’applique avec tant d’énergie à construire quelque chose en amont, le retournement final ne peut pas se contenter de faire volte-face pour articuler un commentaire sur les attentes du public. Ça marche peut-être à ce niveau pour toi, mais la cohérence diégétique est brisée. Mon implication aussi du coup.
J’aimeJ’aime
Si je trouve au film certaines faiblesses, c’est effectivement plus dans la transition, et en particulier les deux scènes de séance que je trouve pas très bien amenées et pas très convaincantes, que dans le final lui-même. D’ailleurs, pour préciser mon propos, je ne pense pas que le but premier du final soit d’articuler un commentaire sur les attentes du public. Pour moi, le but d’Aster, c’est de confronter les spectateurs avec des images à la puissance horrifique immédiate, des images qu’il ne puisse pas immédiatement mettre à distance en les analysant comme des allégories.
L’éventuel commentaire métatextuel sur les attentes du public est un propos secondaire qui apparaît lorsque l’impact visuel du final s’atténue mais ce n’est pas une « justification » de ce final.
À côté de ça, je ne suis pas tout à fait d’accord pour dire que la cohérence diégétique est brisée. À mon sens, elle ne l’est pas beaucoup plus que dans Rosemary’s Baby. Dans les deux cas, on a une diégèse semblable à notre réalité mais on apprend en cours de film que les sorcières et les démons y existent. La rupture qu’opère Hereditary est donc à mon sens moins diégétique qu’extra-diégétique. Aster brise moins la logique de sa diégèse qu’une convention de l’horreur psychologique qui veut qu’on évite de représenter trop frontalement des éléments fantastiques, soit pour préserver une sorte d’ambigüité sur la réalité de ces éléments, soit pour renforcer leur impact sur le spectateur.
Polanski pensait que son film marquerait plus durablement les spectateurs s’il ne montrait pas les yeux du bébé, et il avait évidemment raison. Aster pensait que son film marquerait plus durablement les spectateurs s’il montrait ses fantômes et ses démons… en ce qui me concerne, il avait raison aussi.
J’aimeJ’aime
Et Toni Colette est formidable dans le film. C’est fou ce qu’elle est restée jeune. Je me souviens l’avoir vu dans The Hours de Daldry, il y a une quinzaine d’année. Elle n’a pas pris une ride depuis.
J’aimeJ’aime
Ta critique donne envie de le revoir cependant.
J’ai été très intrigué par l’activité de maquettiste de la mère qui donne vraiment au film un côté « mise en abyme » très malaisant et fascinant. D’autant plus que la première scène commence par une immersion dans la maquette, comme si d’emblée on voulait nous faire « lire » et « voir » le film à un autre niveau qu’au premier degré, invitant justement à la distance interprétative.
J’aimeJ’aime
Un connaisseur en film de genre qui fait des références à la tragédie antique (entre autre) et qui écrit super bien, ça fait toujours plaisir (même si je n’ai pas été convaincu par Hérédité).
J’aimeAimé par 1 personne