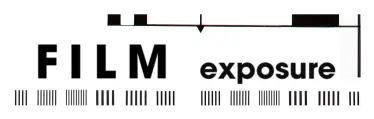Resté longtemps pour ses courts-métrages un secret bien gardé du circuit festivalier, Dustin Guy Defa, pour son second long-métrage, reprend l’un d’entre eux, resserré sur un nombre restreint de personnages, en une heure et demie. Le résultat, correctement dirigé, déçoit cependant. Le problème n’est pas tant ce qu’il y a mis que ce qu’y est éludé par une exécution impersonnelle.
Resté longtemps pour ses courts-métrages un secret bien gardé du circuit festivalier, Dustin Guy Defa, pour son second long-métrage, reprend l’un d’entre eux, resserré sur un nombre restreint de personnages, en une heure et demie. Le résultat, correctement dirigé, déçoit cependant. Le problème n’est pas tant ce qu’il y a mis que ce qu’y est éludé par une exécution impersonnelle.
La majeure (et approximativement seule) réussite de Person to Person ne tient pas à Dustin Guy Defa mais Ashley Connor. Une exquise photographie automnale, un 16 millimètres griffé au rendu onctueux, captant la lumière basse et chaude servant désormais de signature à un cinéma indépendant new-yorkais dont le film paraît malheureusement plutôt être la parodie. Lumière comme empruntée à un – fort meilleur – film, également projeté à Locarno, en 2014 : Listen Up Philip. Si Defa se montre réticent à se revendiquer de Woody Allen (bien qu’une partie de son intrigue évoque vaguement Meurtre Mystérieux à Manhattan), plus inspiré qu’il est au fond par la comédie chorale d’un Wayne Wang ou la branche Tomine/Clowes de l’indie-comics, ce peut être du fait que la filiation ne soit pas directe. L’esthétique que sa chef-opératrice continue dans un sillon contemporain, devait initialement à Allen (un titre en particulier : Maris et Femmes, d’une férocité à l’opposé du désir, en fait assez antipathique, de récolter la sympathie du film ici critiqué), mais s’est depuis ramifiée dans la production alternative de la Grosse Pomme. Elle est un acquis dépassant désormais qui l’a initié, dont faire un usage inspiré ou non. Person to Person manque de la pugnacité émotive qui contrasterait avec ce rendu doux, tandis que son amabilité apparente tient plus au désir, maladie de l’époque, d’être désespérément apprécié. Ce manquement est d’autant plus déconcertant que le film ne manque pas, sur le papier, de comportements répréhensibles ou de situations compromettantes… mais qui semblent lissés, détachés d’enjeux réels.
Sur quelques heures, plusieurs histoires s’entrecroisent. Pour son entrée dans un journal local, Claire (Abbi Jacobson) doit accompagner Phil (Michael Cera) couvrir un fait-divers, ce qui les amènera à suivre la veuve (Michaela Watkins) de l’homme assassiné, impliquant au passage un commerçant solitaire (Philip Baker Hall) auquel celle-ci a fait réparer une montre à l’importance décisive. L’essentiel du temps de Claire et Phil est passé dans la voiture de ce dernier, amateur de métal faisant subir son environnement sonore à la jeune intimidée (rare moment véritablement drôle, après qu’il lui ait fait répéter ad nauseam avec lui le refrain SUCK! SUCK! SUCK ON GREED!, elle hasardant : « Is the title of the song SUCK ON GREED ? »). Claire, se découvrant gênée par l’absence de décence impliquée par leur « reportage » voyeuriste, décide en fin de journée de changer d’orientation, au grand dam de son récent co-équipier, désespéré de gagner sa sympathie. Le craquage de Cera implorant sa compagnie (sur le mode : « pourquoi personne ne m’apprécie ? ») est à la fois une critique que le film adresse au personnage (incarné par un comédien devenu l’emblème, partiellement consentant, d’une forme de popularité douteuse et quémandeuse) et une situation pointant à l’exact problème du long-métrage en son métier.
À ce premier fil narratif se mêlent trois autres (quatre à compter les échanges du boutiquier avec un ami du quartier). Wendi (Tavi Gevinson) et Melanie (Olivia Luccardi) sèchent chez la seconde, qui s’apprête à faire venir son petit-ami et un quatrième larron contre les désirs de la première, qui ne pense rien de bien du prétendant convié. Laissée en compagnie de la quatrième roue du carrosse elle se surprend, en dépit d’une orientation habituellement différente, à ne pas être insensible à son égard. Deux colocataires, Bene (Bene Copersmith) et Ray (George Sample III) vivent chacun une journée chargée. Bene, collectionneur de vinyles, affublé ce jour d’une chemise neuve trop criarde pour qu’il l’assume sans insécurité, part à la conquête d’une rareté de Charlie Parker pour se voir roulé dans la farine, Ray doit assumer les conséquences d’avoir balancé sur le net des photos compromettantes d’une fréquentation lors d’une crise. Pris ensemble ces arcs impliquent vol, coups, espionnage, destruction de biens d’autrui, atteinte à la vie privée… et un meurtre comme prémisse à une aventure. Bon an mal an, tout se résout toutefois pour les principaux intéressés – ceux dont le point de vue était initialement adopté.

Il n’y a rien de trop désagréable dans Person to Person et c’est en un sens bien là le problème. Le film, loin d’être mal foutu, est à l’évidence l’œuvre d’un cinéphile, d’un mélomane flatteur aux oreilles, muni du savoir-faire requis. Peu de choses pourtant transparaissent d’un point de vue personnel sur les situations montrées. Au-delà d’un spectre de goûts avouables, d’une technique valide, le même aurait pu être réalisé, avec les mêmes acteurs et équipe, par un large éventail de cinéastes ayant ces références (de Paul Mazursky aux Safdie) et le métier exigé. Il reste générique, question de savoir-faire sans personnalité décisive. Il flotte de plus, avec une aisance déplacée, à la surface de problèmes qu’il convoque sans vraiment pouvoir les affronter. Soucieux d’une bonne réception, il rend parfaitement comestible ce qui devrait rester dur à digérer. Rien ne saurait ici porter finalement à conséquence. Ce caractère irrémédiablement plaisant est à l’opposé des grands films également implantés à NYC dont il souhaiterait émuler la formule – qui au contraire, refusent cette facilité et, osant se montrer déplaisants, regardent les moments vils, les actes déplacés comme ce qu’ils sont et resteront. L’ironie prévisible étant qu’ils s’attireront ainsi un éventuel opprobre concernant les propos et comportements filmés, qu’un film calculant plus son capital-sympathie évitera souvent de son côté.
C’est à cet égard, pour un budget plus modeste, un cousin en écueils de The Big Sick (également présenté à Locarno), où les personnages paraissent de même trop conçus pour récolter la sympathie, ce jusque dans leurs travers, trop génériques jusque dans des spécificités calculées, trop écrits pour être honnêtes. Bien qu’il n’y ait qu’un auteur, le cinéaste, au scénario de Person to Person, le film produit la même impression que chaque réplique, jusqu’à la plus quotidienne, a été composée par une armada de seize scénaristes, que chaque interaction se doit de produire un effet proche du numéro de stand-up. Les deux films, dans leur échec parallèle, révèlent la difficulté à réussir ce qu’accomplissent les cinémas du verbe qu’ils imitent respectivement. Produire une langue vivante, exprimant l’intériorité de qui la profère autant que l’ancrage dans un milieu plausible (et non strictement conçu pour parler à un groupe démographique en lui projetant son reflet conventionnellement idéalisé). Des films dont la sur-écriture même les empêchent de communiquer une expérience réelle, une humanité tangible, qui ne s’adressent de personne (d’incarné dans la fiction) à personne (d’autre qu’un marché cible). Qui ont, selon une mentalité typique de l’ère où ils s’inscrivent, leur propre promotion comme premier principe actif. Le genre de « produits » tristement appropriés pour ce qu’un algorithme en recommande le visionnage de la bande-annonce après celle d’un autre correspondant génériquement.
 Person to Person évite, à son corps défendant, de traiter sérieusement ses forces perturbatrices invitées en prémisses. Un assassinat en est au centre, mais cet événement, le deuil qu’il inflige ou les raisons qui y ont pu y pousser, brille par son absence de traitement. La mort, bien que constitutive d’un récit, est la grande absente, le scandale élagué au long de celui-ci. Cette présence, la mort à l’œuvre, a trouvé à Locarno cette année 86 minutes où exposer son inéluctable choquant, jusque dans des plans rapprochés auxquels Wang Bing n’avait pas jusqu’ici habitué. Mrs. Fang, ayant reçu un Léopard d’Or très mérité, filme les derniers jours d’une mourante de soixante-huit ans, affligée d’Alzheimer, tandis qu’autour d’elle la vie continue – pêche aux environs, conciliabules des proches, commentaires plus ou moins pertinents de chacun, révélation du désarroi de sa fille (perdre un proche sur une durée progressive étant, d’un certain point de vue, la plus douloureuse des manières), occasionnelles tensions familiales et resserrement du groupe. Et, bien au centre, l’anéantissement d’une personne. Wang ne détourne pas le regard de son sujet central. Prendrait-il des chemins de traverse qu’il garde ce Nord inéluctable. C’est, au propre comme au figuré, une agonie d’y assister. Cette frontalité est celle d’une mise en scène qui, ayant abandonné le souci de se faire apprécier (l’expérience n’en étant, par principe, pas complètement appréciable) atteint à une vérité de ce qu’elle filme. Pour en revenir à Defa, il entrevoit une vie sauvage, une dissonance existentielle, qui auraient demandé à être pleinement pris à bras le corps par sa fiction. Quelque chose doit gronder, se perçoit occasionnellement ici sans trouver sa pleine expression, chez un cinéaste œuvrant depuis maintenant plus d’une décennie à sa propre implantation. En l’état, la personnalité du cinéaste ne s’inscrit au mieux que dans le rythme de son écriture. Laisserait-il de côté les enjeux d’appréciation trop calculés qu’il y a fort à parier sur d’autres films autrement plus fracassants. Probablement pas Mrs. Fang mais, pourquoi pas, quelque chose comme son Maris et Femmes?
Person to Person évite, à son corps défendant, de traiter sérieusement ses forces perturbatrices invitées en prémisses. Un assassinat en est au centre, mais cet événement, le deuil qu’il inflige ou les raisons qui y ont pu y pousser, brille par son absence de traitement. La mort, bien que constitutive d’un récit, est la grande absente, le scandale élagué au long de celui-ci. Cette présence, la mort à l’œuvre, a trouvé à Locarno cette année 86 minutes où exposer son inéluctable choquant, jusque dans des plans rapprochés auxquels Wang Bing n’avait pas jusqu’ici habitué. Mrs. Fang, ayant reçu un Léopard d’Or très mérité, filme les derniers jours d’une mourante de soixante-huit ans, affligée d’Alzheimer, tandis qu’autour d’elle la vie continue – pêche aux environs, conciliabules des proches, commentaires plus ou moins pertinents de chacun, révélation du désarroi de sa fille (perdre un proche sur une durée progressive étant, d’un certain point de vue, la plus douloureuse des manières), occasionnelles tensions familiales et resserrement du groupe. Et, bien au centre, l’anéantissement d’une personne. Wang ne détourne pas le regard de son sujet central. Prendrait-il des chemins de traverse qu’il garde ce Nord inéluctable. C’est, au propre comme au figuré, une agonie d’y assister. Cette frontalité est celle d’une mise en scène qui, ayant abandonné le souci de se faire apprécier (l’expérience n’en étant, par principe, pas complètement appréciable) atteint à une vérité de ce qu’elle filme. Pour en revenir à Defa, il entrevoit une vie sauvage, une dissonance existentielle, qui auraient demandé à être pleinement pris à bras le corps par sa fiction. Quelque chose doit gronder, se perçoit occasionnellement ici sans trouver sa pleine expression, chez un cinéaste œuvrant depuis maintenant plus d’une décennie à sa propre implantation. En l’état, la personnalité du cinéaste ne s’inscrit au mieux que dans le rythme de son écriture. Laisserait-il de côté les enjeux d’appréciation trop calculés qu’il y a fort à parier sur d’autres films autrement plus fracassants. Probablement pas Mrs. Fang mais, pourquoi pas, quelque chose comme son Maris et Femmes?
PERSON TO PERSON
Réalisé par Dustin Guy Defa
Avec Abbi Jacobson, Michael Cera, Bene Copersmith, Michaela Watkins, Tavi Gevinson
Date de sortie inconnue