 Pour sa 19e édition, le Festival International du Film Fantastic de Neuchâtel (NIFFF) consacre une rétrospective à l’initiative New Danish Screens, un programme de la cinémathèque danoise ayant pour objectif d’encourager la création de films à budgets modérés novateurs. Comme avec toutes les entreprises de la sorte, les résultats se révèlent de qualité variée, mais celle-ci fascine en cela qu’elle peint un portrait très en contraste avec le cinéma danois tel qu’il a pu exister auparavant. À la fois recentrés dans leur diégèse et ouverts dans leur portée thématique, ces nouveaux films semblent s’efforcer d’exorciser une claustrophobie nationale à tous les niveaux : physique (Cutterhead), situationnel (The Guilty), corporel (Shelley), voire même existentiel (Bridgend).
Pour sa 19e édition, le Festival International du Film Fantastic de Neuchâtel (NIFFF) consacre une rétrospective à l’initiative New Danish Screens, un programme de la cinémathèque danoise ayant pour objectif d’encourager la création de films à budgets modérés novateurs. Comme avec toutes les entreprises de la sorte, les résultats se révèlent de qualité variée, mais celle-ci fascine en cela qu’elle peint un portrait très en contraste avec le cinéma danois tel qu’il a pu exister auparavant. À la fois recentrés dans leur diégèse et ouverts dans leur portée thématique, ces nouveaux films semblent s’efforcer d’exorciser une claustrophobie nationale à tous les niveaux : physique (Cutterhead), situationnel (The Guilty), corporel (Shelley), voire même existentiel (Bridgend).
Le cinéma danois, après un âge d’or historique au début du XXe siècle sous l’étendard de Carl Theodor Dreyer, avait semblé sombrer dans une impasse socialo-réaliste au cours des années 1960, dont il ne sortira qu’à la fin des années 1980 grâce à quelques franches réussites (Le Festin de Babette, Pelle le Conquérant), et de façon plus marquée dans les années 1990 avec le mouvement Dogme95 mené par Lars von Trier et Thomas Vinterberg. Uniquement opposés par l’hyperbole stylistique d’un Nicolas Winding Refn, ces cinéastes obsédés par la performance d’acteur, la Nouvelle Vague et la dimension tangible du 7e art auront un effet durable sur l’esthétique nationale.
Avec New Danish Screens, cependant, les années 2000 et 2010 ont donné l’opportunité à de jeunes réalisateurs aux influences hybrides de s’exprimer, comme Jeppe Rønde, documentariste passé à la fiction en 2015 avec Bridgend, vision pagano-onirique, presque éthérée, d’un phénomène sociétal concret (une vague de suicides parmi les adolescents d’une petite ville du Pays de Galle). En transformant un fait divers en songe cinématographique qui délaisse la psychologie et l’anecdote au profit d’une atmosphère oppressante (photo bleutée et dépressive, musique lancinante et inquiétante) et d’une immersion totale dans le quotidien errant et erratique d’un groupe d’adolescents, Rønde délaisse le naturalisme typiquement danois pour proposer une hybridation stylistique empruntant à Fabrice du Welz et Jonathan Glazer. La claustrophobie qui émerge progressivement est d’ordre métaphysique : libres de leurs mouvements et pourtant prisonniers (du destin ? de la pression de leurs pairs ? d’une force inexplicable ? Nous ne le saurons jamais), les personnages, et notamment la jeune protagoniste, se retrouvent de plus en plus renfermés, à la fois obligés et disposés à suivre les rails sur lesquels s’ouvre le film. Même dans ses moments les plus effervescents, Bridgend isole son héroïne malgré son environnement, soit par le cadre (les discussions sur messagerie instantanée superposant le texte sur son visage), soit par les sens (la scène de balancier à l’entrée d’un tunnel ferroviaire).

Les sens jouent également un rôle important dans Cutterhead (2018), premier long-métrage de Rasmus Kloster Bro, qui exploite quant à lui une expression plus littérale de la claustrophobie dans une histoire mettant en scène une journaliste danoise qui se retrouve coincée dans une minuscule pièce avec deux ouvriers immigrés d’un chantier de métro. Très loin sous terre, sans expertise aucune en termes de survie dans un tel environnement, elle doit composer avec ses compagnons de fortune comme avec ses propres incertitudes. Plongeant ses personnages dans une structure labyrinthique et oppressante faite de tunnels, de passages et de chambres fortes hermétiques, le cinéaste exprime l’imperméabilité des individus au sort de leurs semblables, et la sinuosité extrême qu’implique le chemin vers la compréhension de l’autre et même de soi. Nous montrant d’abord la porte vers une lecture mainstream et prévisible de l’ouverture (voire du désir) des Danois envers les immigrés, le film prend au final une tournure tout à fait inattendue dans son ultime acte, qui réduit les survivants à des archétypes primitifs et primaux, dénués de tout attribut culturel. Face à la mort, l’identité n’est rien. Cutterhead semble surtout s’intéresser au fait que les Danois vivent désormais des vies si confortables qu’ils en oublient les émotions fondamentales de la vie, celles qui motivent jour et nuit les autres personnages du film, du moins jusqu’à ce qu’ils soient mis face à la possibilité imminente de leur propre disparition.
La question de l’identité s’avère tout aussi importante dans le superbement maîtrisé The Guilty (Gustav Möller, 2018), un thriller dramatique haletant, qui crée la surprise en ne quittant jamais la pièce dans laquelle est posée la caméra. Relégué au service des urgences téléphoniques, un policier danois au passé tourmenté reçoit l’appel d’une femme qui a été kidnappée et a réussi à contacter la police à l’insu de son agresseur. Commence alors une chasse à l’homme que le spectateur ne vivra qu’à travers l’expérience de cet homme. Lors de celle-ci, la responsabilité de certains actes passera de main en main, défiant sur leur terrain les poncifs les plus éculés du police procedural, tout en testant avec intelligence les limites d’un protagoniste dont le combat intérieur va progressivement rejoindre (thématiquement) celui qu’il mène concrètement. L’enfermement est situationnel car le protagoniste n’a aucune influence directe ou physique sur une situation à laquelle il participe pourtant activement. Il s’agit d’une illustration parmi les plus puissantes du sentiment d’impuissance totale de tout un chacun face au déroulement irrépressible des événements au quotidien, et comment nous interprétons ces derniers à la lumière de nos propres obstacles.

L’influence de l’individu sur le monde et son rôle à jouer dans la société est au cœur de la problématique qui motive l’intrigue de Shelley (Ali Abbasi, 2016), film s’intéressant à Elena, une jeune Roumaine qui accepte de vivre avec Louise et Kasper, un couple de riches Danois installé au fond des bois, pour leur venir en aide pendant la convalescence de Louise. Plus tard, elle accepte de porter l’enfant du couple (incapable de procréer naturellement), sans se douter que cette grossesse s’accompagnera d’événements étranges et de défis physiques et psychologiques insurmontables. L’emprisonnement corporel exploré par le film se rapporte ici aux deux personnages féminins, l’une ne pouvant plus échapper au pouvoir d’un enfant qu’elle porte mais qui n’est pas le sien, l’autre n’ayant jamais pu s’affranchir d’une limitation innée qui, on en viendra à s’en douter, avait potentiellement une raison d’être. Si le naturalisme du Dogme95 refait sporadiquement surface, Shelley reste un film de genre qui répond de codes qui avaient disparu du cinéma danois quelques décennies auparavant. Non pas qu’il les ressuscite à proprement parler, le traitement du fantastique demeurant discret, mais il renoue avec une certaine tradition fantastique qui s’était faite plus rare. Traitant de l’isolation sur plusieurs niveaux, le film s’empare des codes liés à l’enfant démon pour y apposer une lecture possiblement acerbe d’une tendance sociétale et démographique.
Ces quatre films ne constituent ni la rétrospective du NIFFF dans son ensemble, ni une sélection définitive des meilleures productions ayant émergé du programme New Danish Screens, mais ils en représentent un échantillon intéressant, parcouru de thèmes communs traçant une nouvelle direction pour le cinéma de genre danois, qui semble obsédé par la question de sa pertinence identitaire et de son rôle en relation avec le reste du monde.
Le NIFFF aura lieu du 5 au 13 juillet 2019 à Neuchâtel.
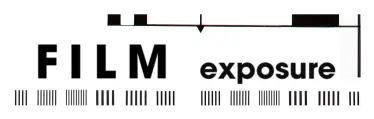
 Pour sa 19e édition, le Festival International du Film Fantastic de Neuchâtel (NIFFF) consacre
Pour sa 19e édition, le Festival International du Film Fantastic de Neuchâtel (NIFFF) consacre 
