Stray Cat Rock : Zeitgeist, bikeuses & rock n’ roll
Il y a une époque où les films d’exploitation qui arrivaient sur nos écrans n’étaient pas qu’hollywoodiens. Il y a une époque où ils étaient asiatiques. Il y a une […]
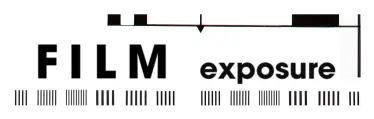 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Il y a une époque où les films d’exploitation qui arrivaient sur nos écrans n’étaient pas qu’hollywoodiens. Il y a une époque où ils étaient asiatiques. Il y a une […]
 Il y a une époque où les films d’exploitation qui arrivaient sur nos écrans n’étaient pas qu’hollywoodiens. Il y a une époque où ils étaient asiatiques. Il y a une époque où ils étaient japonais. Nikkatsu, Toho, Toei, autant de noms qui résonnaient avec délice aux oreilles des Occidentaux qui avaient la chance d’habiter une ville assez grande et assez curieuse pour y passer des films d’un autre genre, des diamants bruts. Des œuvres parfois radicales, souvent magistrales, mais aussi des films qui n’étaient projetés que pour une durée limitée, sans espoir de VHS, de DVD ou de Blu-ray. Des films que l’on ne reverrait sans doute plus jamais. Parmi eux bien-sûr, il y avait Stray Cat Rock, ensemble de cinq films, témoins irrévérencieux de la jeunesse nipponne du début des années 1970, mélange jouissif d’action, de rock psychédélique et de rébellion. Une série que l’on croyait disparue de nos terres francophones, mais qui grâce à Bach Films s’offre aujourd’hui une résurrection digne de ce nom.
Il y a une époque où les films d’exploitation qui arrivaient sur nos écrans n’étaient pas qu’hollywoodiens. Il y a une époque où ils étaient asiatiques. Il y a une époque où ils étaient japonais. Nikkatsu, Toho, Toei, autant de noms qui résonnaient avec délice aux oreilles des Occidentaux qui avaient la chance d’habiter une ville assez grande et assez curieuse pour y passer des films d’un autre genre, des diamants bruts. Des œuvres parfois radicales, souvent magistrales, mais aussi des films qui n’étaient projetés que pour une durée limitée, sans espoir de VHS, de DVD ou de Blu-ray. Des films que l’on ne reverrait sans doute plus jamais. Parmi eux bien-sûr, il y avait Stray Cat Rock, ensemble de cinq films, témoins irrévérencieux de la jeunesse nipponne du début des années 1970, mélange jouissif d’action, de rock psychédélique et de rébellion. Une série que l’on croyait disparue de nos terres francophones, mais qui grâce à Bach Films s’offre aujourd’hui une résurrection digne de ce nom.
En 1968, Delinquent Boss (Furyô Banchô) sort sur les écrans japonais. Mettant en scène des motards hors-la-loi, violents et arborant svastikas et totenkopf, ce film produit par la Toei s’inspire directement de The Wild Angels de Roger Corman, sorti à peine deux ans plus tôt. Le succès est immédiat. La série qui s’ensuivra affichera à son compteur un total de seize films, répartis sur quatre années, et sera la franchise la plus lucrative du studio. Ne voulant pas rater le coche de cette nouvelle tendance cinématographique, la Nikkatsu, concurrente de la Toei, lance un peu plus d’un an plus tard le premier opus de Stray Cat Rock, justement sous-titré Female Boss*1. Désirant cependant se démarquer de la série des Delinquent Boss, la Nikkatsu cible un public plus jeune et confie ce premier film à Yasuharu Hasebe, réalisateur maison ayant déjà fait ses preuves avec Black Tight Killers (également édité en DVD/Blu-ray chez Bach Films) et Slaughter Gun, avec l’acteur culte Jo Shishido. Le studio offre de plus une liberté quasi-totale à Hasebe, qui saura l’utiliser pleinement et à bon escient. Female Boss sort le 2 mai 1970 et se place d’emblée comme témoin d’une jeunesse japonaise aux prises avec les profonds changements sociétaux que traverse le Japon à cette époque, sans pour autant oublier d’être un actioner fébrile et pop à souhait.
L’originalité majeure de Stray Cat Rock est de faire du gang de motards un gang de motardes. En effet, le personnage principal de ce premier film se nomme Ako, une motarde androgyne, qui intègre le gang de Mei, les Stray Cats, et va les aider dans leur combat contre le groupe Seiyu, gang de motards aux idéaux nationalistes extrémistes, qui ne sont pas sans rappeler les Delinquent Boss de la Toei. Hasebe opère ainsi un pied-de-nez magistral aux stéréotypes du viril et violent motard japonais et se concentre sur une autre réalité, celle des clans de femmes bikeuses qui, dès la fin des années 1960, prennent une place de plus en plus importante dans le mouvement des Bôsôzoku, contre-culture de groupes de jeunes motards customisant leurs machines pour faire des courses clandestines et dangereuses.
Loin de s’arrêter là, Hasebe, assisté au scénario par Atsushi Yamatoya (scénariste du cultissime Branded To Kill de Seijun Suzuki), en profite aussi pour traiter d’autres sujets sensibles, comme celui des discriminations faites aux Japonais métissés, les Hâfus (du mot anglais half). En effet, en 1970, les enfants nés de femmes nipponnes et de soldats américains ou de réfugiés coréens ont entre vingt-cinq et trente ans et font partie de cette jeunesse qu’Hasebe veut dépeindre. Akiko Wada, qui tient le premier rôle du film, en est l’exemple parfait. Née Kim Bok-ja, elle naît à Osaka en 1950 et devient, à dix-neuf ans, une célèbre chanteuse de blues. Autre exemple, celui de Ken Sanders, acteur et musicien (de blues lui aussi), qui interprète ici un boxeur nippo-afro-américain. Considérés comme des impurs, ces métis sont souvent victimes d’agressions et de discriminations. La volonté d’Hasebe de les mettre en haut de l’affiche de Female Boss annonce donc d’emblée le positionnement du film.

La liberté sexuelle, arrivant au Japon avec le mouvement hippie, est une autre thématique forte de ce premier film. On assiste donc à l’apparition de vêtements plus dénudant chez les femmes, d’une volonté d’aimer comme elles l’entendent et d’un traitement plus courageux de leurs personnages (le sauvetage du petit-copain). S’ajoute à cela une subtile présentation de genres et de sexualités différentes, notamment avec un trio ménage-à-trois, composé d’une jeune fille et de deux garçons androgynes et bisexuels, que l’on rencontre à plusieurs reprises dans le club-rock que fréquentent Mei et son gang, mais aussi avec l’androgynie clairement assumée d’Akiko Wada, grande et s’habillant comme un homme.
Enfin, c’est le Traité de Sécurité Américano-japonais qui sera le véritable fil rouge contestataire de la série Stray Cat Rock. Adopté en 1952, cet accord permet aux États-Unis de garder plusieurs bases militaires sur le territoire japonais (plus de 31 000 soldats). Si cet accord permit de mettre fin à l’occupation, il permet aussi aux États-Unis de garder une main mise économique et militaire sur le pays. Pour une grande partie de la population japonaise, oublier les exactions des forces américaines durant l’occupation est impossible. La très forte censure, les multiples cas de viol (330 par jour dans les premières années), mais aussi de viol-meurtre et l’augmentation des maladies vénériennes sont quelques exemples indélébiles perpétrés par les forces américaines. Chaque film traitera de manière différente, et souvent en filigrane, des effets de ce traité, distillant dans son intrigue plusieurs éléments anti-américains.
Stray Cat Rock dépeint donc les multiples facettes du choc culturel, social et politique qui s’empare du pays dès 1969, entre un Japon traditionnel incarné par une génération vieillissante et les institutions gouvernementales et un Japon en quête de modernité, portée en étendard par la jeunesse engagée et libertaire.

Dès sa sortie, Female Boss remporte un succès fracassant. Un succès presque inattendu pour la Nikkatsu, qui s’attendait certes à rentrer facilement dans ses frais, mais non à créer un genre nouveau et à faire de ce film un des modèles d’inspiration d’une jeunesse en pleine rébellion et ébullition. Hasebe se rappelle avoir voulu infuser la culture du moment dans ses films, le fameux Zeitgeist. Il passait beaucoup de temps dans les endroits où les jeunes traînaient. « Je me souviens, un jour, j’avais remarqué un rassemblement bruyant à l’entrée Ouest de la gare de Shinjuku. Des activistes s’étaient rassemblés et protestaient contre le Traité de Sécurité Américano-japonais. Ils étaient un peu comme les hippies américains. Je les ai trouvés intéressants. Cinématiques. Je voulais que mes films soient aussi modernes qu’eux. »*2 Pari donc réussi pour Hasebe et la Nikkatsu qui s’empresse de mettre sur pied, non pas une, mais deux suites, qui seront tournées simultanément, l’une par Hasebe, l’autre par Toshiya Fujita (futur réalisateur des Lady Snowblood), avec le même casting, qui passera d’un tournage à l’autre, d’un rôle à l’autre.
Wild Jumbo et Sex Hunter sortent le 1er août et le 1er septembre 1970 (soit trois et quatre mois après Female Boss). Ces suites n’en sont pourtant pas de vraies. Aucune d’elle ne continue l’intrigue du premier film et chacune en débute une nouvelle, comme ce sera le cas des autres Stray Cat Rock. Une technique qui permet à la Nikkatsu de ne pas s’embarrasser de cohérence narrative et de changer de genre et de décors à volonté. Dotés de budgets très bas, Wild Jumbo et Sex Hunter profitent néanmoins des moyens limités dont ils disposent pour innover, être vite tournés, montés, et pour au final transmettre l’énergie brute de ce processus créatif à l’écran. Tous deux remportent, dès leur sortie, un triomphe tout aussi retentissant que le premier opus. Triomphe dû aux plusieurs raisons citées plus haut, mais aussi à la présence à l’affiche d’une actrice qui deviendra rapidement une icône : Meiko Kaji.
Ne tenant qu’un second rôle dans Female Boss, Kaji captive d’entrée les spectateurs et vole la vedette à Akiko Wada. La Nikkatsu voit très vite le potentiel de l’actrice et lui offre dans la foulée le rôle-titre de Blind Woman’s Curse (également édité en DVD/Blu-ray chez Bach Films) de Teruo Ishii, sorte de Zatoichi au féminin qui sortira le 20 juin 1970 (pile entre deux Stray Cat Rock), et lui confiera les rôles principaux des quatre Stray Cat Rock suivants. La fin de la série sera d’ailleurs marquée par son départ, en 1972, de la Nikkatsu pour la Toei, où elle incarnera un de ses rôles les plus marquants : la Femme-Scorpion, dans la série de films Sasori. Elle interprétera par la suite Yuki Kashima dans le diptyque Lady Snowblood (inspiration principale du Kill Bill de Quentin Tarantino), puis aura différents rôles chez des réalisateurs de premier plan, tels Kinji Fukasaku, Kaneto Shindo ou Yasuzo Masumura.

Le charisme naturel de Meiko Kaji, son magnétisme, son regard profond et glaçant, qui deviendront sa marque fabrique, se révèlent déjà dans les Stray Cat Rock. Qu’elle soit jeune délinquante ingénue dans Wild Jumbo, cheffe de gang intraitable dans Sex Hunter et Machine Animal ou encore amoureuse tragique dans Beat ’71. À noter également qu’elle sera toujours épaulée, dans cette série, par Tatsuya Fuji, que l’on verra ensuite dans L’Empire des Sens et L’Empire de la Passion de Nagisa Oshima, puis que l’on retrouvera au début des années 2000, sous la direction de Takashi Miike, Kiyoshi Kurosawa ou plus récemment Takeshi Kitano et Naomi Kawase.
Wild Jumbo et Sex Hunter seront donc suivis de près, le 22 novembre 1970 et le 3 janvier 1971 par Machine Animal et Beat ’71. Le succès sera encore et toujours au rendez-vous, mais la série s’arrêtera là, à l’aube de l’année 1971, en ayant cumulée cinq films en seulement un an.
Fidèles au premier film de Hasebe, ces quatre suites savent, elles aussi, saisir l’air du temps, le Zeitgeist de cette année 1970. Wild Jumbo nous raconte l’histoire d’un jeune groupe de délinquants fomentant un casse dans les caisses d’une des sectes religieuses qui prolifèrent au Japon à cette période. Sex Hunter, lui, prend pour prétexte une guerre entre deux gangs ennemis, pour dresser une critique acerbe du racisme que subissent les métisses et de la main mise économique et militaire des États-Unis sur le Japon, qui par le rapport à l’argent corrumpt tout un pan de la société japonaise. Un état de fait magnifiquement illustré dans une scène où les motards piègent le groupe rival de motardes, les vendant à leur insu à un groupe d’industriels américains, qui les séquestreront et les violeront, avant que leur cheffe Mako n’intervienne à coup de cocktails Molotov faits dans des bouteilles de Coca-Cola. Vient ensuite Machine Animal, qui tire son intrigue de l’histoire d’un déserteur américain de la guerre du Vietnam désirant, avec l’aide de deux Japonais, s’acheter un passage pour la Suède grâce à la vente de LSD volé sur le front. Une nouvelle critique du Traité de Sécurité Américano-japonais donc, grâce auquel les États-Unis utilisaient ses bases au Japon pour mener la guerre au Vietnam. Enfin, Beat ’71 confronte le Japon moderne des villes au Japon traditionnel des campagnes à travers une histoire d’amour et de trahison, tout en sonnant la désillusion du mouvement hippie japonais dans un final au nihilisme évident, que préfigurait d’ailleurs déjà Sex Hunter quelques mois plus tôt.

D’un point de vue purement cinématographique et narratif, Stray Cat Rock s’inscrit là encore dans son époque. Les couleurs sont crues, criardes, pop. La caméra est libre, très souvent portée. Ses mouvements sont instinctifs. Tout est soudain possible pour elle. Dans les scènes d’action, l’image devient parfois folle. Elle tremble, elle se renverse, elle tournoie, elle zoome, elle échappe au chef-opérateur. Le montage devient lui aussi frénétique et certaines transitions épileptiques. Tout est tourné si vite, avec une énergie telle, qu’elle transpire à l’écran. On sent ici tout l’héritage récent de la nouvelle vague française, additionné des extrêmes propres à la culture japonaise.
Yasuharu Hasebe et Toshiya Fujita se partagent les cinq films. Le premier s’occupe de Female Boss, Sex Hunter et Machine Animal, alors que le second réalise Wild Jumbo et Beat ’71. Chacun a ses traits de style. Chacun a sa manière d’aborder l’intrigue, engagée et radicale pour Hasebe, plus tendre et subtile pour Fujita. Chacun gère les acteurs différemment, dans la retenue ou dans le sur-jeu. Mais tous deux ne perdent jamais de vue l’atmosphère des milieux qu’il décrivent, à l’époque à laquelle ils les décrivent. Ils partagent cette envie, ce besoin même, de faire voler les codes en éclats, de les dynamiter, et ce de quelque manière que ce soit. La liberté, à nouveau et à tout prix. Grand mot d’ordre de Stray Cat Rock, jusque dans sa mise en forme.
Cette liberté ne naît d’ailleurs pas de là où nous autres Occidentaux pourrions le croire. Habitués au cinéma japonais d’auteur, nous connaissons le Japon à travers ses fables féodales ou ses intrigues urbaines éclairées aux néons et se déroulant au cœur de centres-villes dégorgeant de passants. Les décors de Stray Cat Rock, eux, se situent plus en marge, dans les banlieues en friche des grandes cités, là où tout est gris et sale, où tout n’est qu’immeubles abandonnés et terrains vagues. Le dépaysement est total. On découvre alors un Japon moins clinquant, plus réel, plus proche des espaces oubliés et des gens, oubliés eux aussi, qui y vivent. Des espaces que l’on retrouve dans presque chaque pays du monde, des espaces communs à plusieurs cultures.

Dans la même idée, la musique, ici omniprésente, rapproche sans conteste l’Orient et l’Occident et tient un place de choix dans les cinq films. Influencée par le succès mondial de The Beatles, la musique populaire japonaise connaît à la fin des années 1960 une profonde transformation, un mouvement musical faisant le pont entre le Kayôkyoku (pop nipponne traditionnelle) et le rock venu de l’Ouest. Ce sont les Group Sounds. D’abord pensé comme un attrait purement marketing par la Nikkatsu, la musique de ces groupes populaires appuie une fois de plus l’encrage dans son époque de la série Stray Cat Rock et lui donne une identité sonore propre, une ambiance psychédélique et colorée, une autre forme de cohérence à l’ensemble. Toujours diégétique, cette musique donne même lieu à des scènes pensées exprès pour elle, comme celles, nombreuses, se déroulant dans des clubs où la jeunesse nipponne vient danser sans retenue et où les gangs se retrouvent et parfois même s’affrontent. On notera d’ailleurs la présence de The Golden Halves, un groupe exclusivement composé de jeunes femmes métisses, en ouverture de Sex Hunter, le plus engagé des cinq films. On assistera de plus à deux superbes moments de chanson, l’un dans Female Boss où Akiko Wada chante seule un titre de son album Future’s Blues et dans Sex Hunter où Meiko Kaji chante Bet My Life On Love (Koi Ni Inochi O), une renversante balade, deuxième single de sa carrière musicale qui durera jusqu’en 2009.
Mais malgré tous les talents à l’œuvre, les cinq films ne se valent pas. Celui qui fonctionne le mieux reste incontestablement l’opus du milieu : Sex Hunter. Il s’agit du film qui cristallise le plus clairement les divers propos contestataires explicités plus haut et qui les aborde de la manière la plus radicale. Américanisme, racisme, pouvoir de l’argent, violence envers les femmes, chacun de ses sujets y est traité clairement et dénoncé vivement et intelligemment. Mais Hasebe n’en oublie pas pour autant le principal objectif de son film (et des cinq de la série) : divertir. Et là aussi justement, Sex Hunter est le plus efficace. Son rythme ne connaît aucun temps mort. Sa mise en scène est la plus inspirée, avec au milieu de plans agités d’autres plus calmes, plus englobants, d’une beauté étonnante. L’écriture y est aussi la plus juste, l’attachement aux personnages inévitable et la fin d’un tragique inattendu laisse le spectateur cloué. Que Sex Hunter soit le point d’orgue de cette série ne veut cependant et en aucun cas dire que les quatre autres films soient mauvais, bien au contraire. Chacun d’eux apporte un point de vue différent qui alimente d’autant plus la série et lui offre une diversité de points de vue et de thématiques. Cette variété d’approches et de traitements est également un des points forts de l’ensemble.

En seulement un an et cinq films, Stray Cat Rock aura donc marqué l’histoire du cinéma d’exploitation japonais et demeure encore aujourd’hui un des rares exemples de films à avoir saisis l’air de son temps. Cette série aura de plus lancé la carrière de Meiko Kaji, icône mondialement reconnue du cinéma nippon et aura donné naissance à un genre, le film de motardes délinquantes, qui sera d’ailleurs repris quatre mois après la sortie de Female Boss par la série Delinquent Girl Boss, produite par la Toei, studio auquel la Nikkatsu avait à l’origine pris l’idée de base de Stray Cat Rock.
STRAY CAT ROCK
Female Boss – 02 mai 1970 – 81 min.
Wild Jumbo – 1er août 1970 – 85 min.
Sex Hunter – 1er septembre 1970 – 86 min.
Machine Animal – 22 novembre 1970 – 82 min.
Beat ’71 – 03 janvier 1971 – 87 min.
Réalisé par Yasuharu Hasebe et Toshiya Fujita
Avec Meiko Kaji, Tatsuya Fuji, Akiko Wada, Bunjaku Han
Coffret Intégrale 5 films en DVD/Blu-ray disponible chez Bach Films
(Bonus : bandes-annonces, présentation des films par Julien Sévéon et Stéphane du Mesnildot, entretien avec Marc Caro)
*1 : Le titre des films n’ont souvent pas grand chose à voir avec leur intrigue, comme c’était le cas avec la majorité des films d’exploitation nippons, ne cherchant par là qu’à attirer le plus de spectateurs dans les salles.
*2 : Interview de Yasuharu Hasebe, conduite par Thomas Weisser et Yuko Mihara, dans Asian Cult Cinema n° 25, 1999
Sources :