Love: rom-com? anti-rom-com?
En évoluant, Love va œuvrer à déconstruire la charge satisfaisante qui en était attendue tout en remplissant le cahier des charges pour lequel son public a signé.
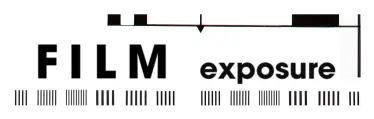 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
En évoluant, Love va œuvrer à déconstruire la charge satisfaisante qui en était attendue tout en remplissant le cahier des charges pour lequel son public a signé.
« We’ve all been there » prévient la promo Netflix de la série de Judd Apatow, Lesley Arfin et Paul Rust, dont les dix épisodes ont été lancé le 19 février. Faut-il s’en réjouir ? Si Love ménage une place à la joie, elle résiderait plus dans les interstices de sa romance que dans les déchirements qui y président. L’occasion de se demander où ça en est exactement, entre Apatow et le romantisme…
Les reproches récurrents à l’encontre du système Apatow ne sont ni très variés, ni totalement infondés. Un premier angle d’attaque serait formel. Ses films se distinguent par une relative platitude visuelle, un agencement plastique à la patine certes élégante mais principalement fonctionnelle (à quelques éclats burlesques près, l’avancée narrative passe par une parole sur fond décoratif). Un second tiendrait à la durée. Apatow ne sait pas finir ses films, étire ses derniers actes jusqu’à la lie. Un troisième porterait sur le fond. Ses conclusions sont normatives, sa manière de résoudre ses intrigues révèle le conservatisme sous-jacent de sa vision du monde. De ce point de vue, Apatow saurait trop comment finir, où précisément il voulait en venir. Ces réserves habituelles ont pu favoriser l’idée qu’il serait finalement meilleur producteur que réalisateur.
Parmi les réfractaires, une concession pourtant est souvent faite : la série lui sied mieux. Là encore, il y a du vrai. Love, produite par Netflix en collaboration avec Lesley Arfin (scénariste sur Girls) et Paul Rust (son interprète), est probablement ce qu’il a créé de plus troublant, racé, de calmement déchirant depuis ses premiers pas télévisés. Il n’est dès lors pas anodin que l’âge de ses personnages marque simultanément un retour à la jeunesse (après les quarantenaires de ses derniers longs-métrages) et un vieillissement (les lycéens nerds qu’il mettait amoureusement en scène à ses débuts étant aujourd’hui de même trentenaires). Judd Apatow est célébré (parfois attaqué) pour s’être fait le chantre d’une sous-culture appelée à venir occuper le devant de la scène, s’être sciemment constitué en promoteur d’un ethos geek qui, de la place subalterne où il s’était constitué, s’est retrouvé projeté aux premières lignes du capitalisme avancé. La mélancolie de la série tient à ce qu’elle ramène de sa demande de nouvelles aux fidèles: ce que sont devenus les petits protégés du cinéaste ne fait pas forcément rêver. Le format est pour quelque chose dans cette réussite – non seulement en jouant contre ses scories habituelles, mais en rehaussant les qualités qu’il payait de celles-ci.
Forme, d’abord. La fonctionnalité est une condition de la série, où les réalisateurs passent, tandis que l’équipe technique, les comédiens et les créateurs restent. L’affiche n’indique-t-elle pas « writer of », en lieu et place de la mention « director » – au sujet de Knocked Up et This is 40 ? La ligne graphique est pourtant ici claire, cohérente, témoigne d’un sens de la composition sous-estimé chez son maître d’œuvre. Durée, ensuite. En dix épisodes dont la longueur varie de la vingtaine de minutes aux trois quarts d’heure, la série se déploie, prend son temps à faire découvrir ses deux amants, leur sentiment naissant, offre droit de cité à la glande, au bavardage, à une galerie de seconds rôles, une imbrication de sous-intrigues qui finissent par intéresser tout autant (éventuellement plus) que les rencontres du couple vedette. C’est le rythme de la vie même qu’Apatow recherche. D’où cette hypothèse : et si ses films étaient, non pas trop longs, mais au contraire trop courts ? Propos, pour finir. De par sa structure, la série tend à persévérer dans son être. Ses conclusions ne peuvent être que locales et provisoires. La tendance à « finir en beauté » se retrouve ici disjonctée. Marier comédie romantique et feuilleton, c’est faire le pari d’une instabilité permanente : plus de temps pour l’hésitation qui fait le charme du genre, moins de poids définitif (mais plus d’irrésolu) pour la résolution obligée.
L’indice le plus sûr du romantisme de Love réside dans son acharnement à le nier. Dans une scène déjà très commentée, Gus (Rust) au retour d’aller récupérer des affaires chez sa précédente relation, face à Mickey (Gillian Jacobs) au volant (alors qu’ils ignorent encore être voués à se lier) pris d’une rage soudaine, entreprend de jeter sous le regard amusé de cette dernière ses Blu-rays par la vitre de l’auto. Les mauvais objets de son courroux allant de Pretty Woman à la troisième saison de Homeland, en passant par le commentaire audio des Affranchis. La teneur de son pétage de câble tiendrait au dialogue de Minnie and Moskowitz, que cite Pâcome Thiellement dans les derniers Cahiers[1] : « Tu sais, je crois que les films sont une conspiration. Je le pense. Ils sont une conspiration parce qu’ils te piègent. Ils te piègent depuis que tu es un enfant. Ils te préparent à croire à tout. Ils te préparent à croire à des idéaux, à la force, aux good guys, à la romance, et bien sûr à l’amour. Et même si tu es très intelligent, tu les crois. » Inutile ici de se réfugier derrière l’argument spécieux « séries contre films », Love tient sa place dans cette conspiration. À ceci près qu’elle saisit la moindre opportunité de dévier du programme qui lui est assigné.
En un montage alterné, le premier épisode donne le ton. Gus et Mickey jeunes trentenaires occupant des postes subalternes à Los Angeles (l’un comme tuteur de plateau, l’autre comme bonne à tout faire d’une petite station de radio) sont, chacun à leur manière, au plus bas. Lui sortant (versant largué) d’une longue relation, des années de refoulement et de soumission le laissant avec la sensation d’être passé à côté d’une entière décennie de sa vie. Elle, alcoolique capable de fonctionner en société, portée sur les mauvais choix impulsifs, logiquement abonnée aux relations foireuses. L’une et l’autre aux deux spectres opposés de l’absence d’épanouissement. Des destinées frustrantes qui, c’est peut-être bien le pire, n’ont rien d’exceptionnelles, parsemées au contraire de formes on ne peut plus ordinaires de misère sexuelle et affective. La mise en parallèle culmine en la juxtaposition d’un discours de désarroi sous Ambien avec un plan à trois se révélant vite source d’embarras. La rencontre de ces deux-là un lendemain vaseux à la supérette du coin ne peut paraître que justice pour les deux partis. Mais cette attente est à l’évidence elle-même conditionnée.
En évoluant, Love va œuvrer à déconstruire la charge satisfaisante qui en était attendue tout en remplissant le cahier des charges pour lequel son public a signé. Car de satisfaction, il sera peu question dans ce chassé-croisé. Puis d’abord, satisfaction pour qui ? Et selon quels critères ? Le physique loin des canons masculins de beauté du personnage principal a maintes fois été relevé, par contraste avec l’essaim de jeunes filles attirantes dont il s’attire les faveurs. Écart d’autant plus flagrant que, bien qu’amusant par sa dérision et réellement touchant par ses blessures, il s’agit malgré tout d’un homme sans qualités. Ce clivage peut devoir pour une part à un double-standard non interrogé. Pour une autre, il participe du propos même de la série. Mickey, personnification du chaos et de l’autodestruction, laisse découvrir une personnalité honnête, une volonté de venir à bout de ses penchants les plus antisociaux. Gus en avançant, ne laisse à contempler qu’un puits sans fond d’insécurité et d’hostilité. Elle mène une lutte difficile, il prend l’autoroute qui devrait achever dans les prochaines saisons, ses inhibitions complètement levées, de l’ériger en simple connard (petit jeu en sa défaveur : compter le nombre de fois où elle s’excuse par comparaison à lui).
Inattendu est le peu de temps finalement partagé à l’écran par elle et lui. Accompagnement d’amours naissants, ces dix épisodes (comme une série quand on ne la binge pas mais qu’on la laisse s’écouler à un rythme cadencé colore la vie quotidienne) évoque un quotidien changé par l’euphorie, l’attente inquiète, les hésitations quant aux textos – ou les remords quant à ceux-ci. Autour de cet affolement de deux êtres, la vie suit son cours. Il y a une qualité Albert Brooks à l’œuvre, le sentiment d’un Modern Romance en rallongé, avec son L.A. pavillonnaire tendrement filmé, ses plateaux de cinéma où l’implication de l’équipe de techniciens à des produits douteux peut par moments laisser à désirer. Un regard discrètement implacable sur une usine à rêve prompte à corrompre, briser les âmes qui y naviguent pour un cachet. Un régal pour qui affectionne la mise en scène des coulisses, entre une enfant-star absolument vendue (Iris Apatow) et une cheffe de plateau redoutable d’abjection pro (Tracie Thoms). Beaucoup de personnes décentes cependant gravitent à la périphérie du pouvoir des studios (Jordan Rock), des individus adorables d’enthousiasme non-feint parsèment ce périple amoureux (Claudia O’Doherty). Love fait sans grande démonstration l’apologie d’une gentillesse authentique, par opposition au qualificatif qui colle à la peau de son infortuné héros : fake-nice.
À l’instant de retrouvailles finales, une indécidabilité plane : est-ce là le meilleur choix ? Cela, pour des raisons différentes, pour les deux membres de l’équation (on serait tenté d’ajouter : spécialement, pour l’une des moitiés de celle-ci). Il y a un cœur secret à Love, son sixième épisode, Andy, réalisé par Joe Swanberg. Au lendemain d’une première embrassade, l’un et l’autre vaquent à leurs occupations, chacun de leur côté. Lui, boosté dans son ego, récolte l’attention d’une comédienne par une suggestion avisée. Elle s’enfonce dans une nuit de déconne chimiquement stimulée en compagnie d’Andy Dick, se concluant dans un métro nocturne par le partage d’une expérience commune d’alcooliques anonymes. La série doit continuer, les deux candidats respectifs se voient pour le moment reconduire, au profit d’un coup de fil réunissant les voix de Gus et Mickey. Ce devrait être un soulagement. Or plane un doute, celui que le pragmatisme de ces deux couples mieux ajustés vaille tout bien envisagé mieux que l’idéalisme de l’union naissante. Que le tour des événements puisse de justesse être interrompu. Mais il n’y aurait dans ce cas pas de show. Alors Love, rom-com, anti-rom-com ? La question a-t-elle encore un sens ? L’enjeu s’est maintenant déplacé : comment de nouveau – vie amoureuse incluse ou mise de côté – aimer sa vie ? De ses étreintes indécidables, l’œuvre esquisse un avertissement : il se pourrait bien que le plus grand risque avec son désir, ce soit encore de l’obtenir.
[1] Cahiers du Cinéma, n° 720, mars 2016, p. 94 (L’Homme de ma Mort par Pâcome Thiellement)