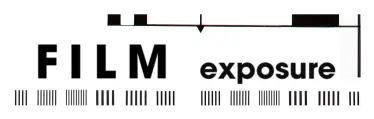France, 1984. Une citation shakespearienne ouvre les hostilités d’un film qui se proclamera porteur d’une vérité qui dérange et d’un regard neutre sur des tabous inavouables de la société française. Sur son heure et demie, le métrage déroule sans transitions des scènettes suivant des épisodes de la vie de personnes fréquentant les « dessous » de la France, ces espaces déviants où des anonymes s’adonnent à une liberté de mœurs sans limite.
France, 1984. Une citation shakespearienne ouvre les hostilités d’un film qui se proclamera porteur d’une vérité qui dérange et d’un regard neutre sur des tabous inavouables de la société française. Sur son heure et demie, le métrage déroule sans transitions des scènettes suivant des épisodes de la vie de personnes fréquentant les « dessous » de la France, ces espaces déviants où des anonymes s’adonnent à une liberté de mœurs sans limite.
Il serait bien hypocrite d’imaginer que l’existence de ces milieux ait constitué une quelconque surprise pour les spectateurs d’il y a 30 ans : tout le monde avait entendu parler de Pigalle et du Bois de Boulogne, des peep show, du porno et des sado-masos. L’argument de vente de La France Interdite ne se situait donc pas dans sa révélation, mais dans son invitation ; une invitation (une initiation, peut-être, pour certains) à découvrir de plus près ces univers que le public fantasmait mais n’osait pas pénétrer.
 La France Interdite se dit messagère, et s’inscrit, dans son approche substantielle comme dans sa forme, aux côtés d’une tradition cinématographique appelée « mondo », des pseudo-documentaires prétendant contenir des scènes prises sur le vif, se servant de leur label pour échapper à la censure, et faisant preuve d’une médiocrité technique effarante. Le film du trio français est tout ça à la fois, et même un peu plus.
La France Interdite se dit messagère, et s’inscrit, dans son approche substantielle comme dans sa forme, aux côtés d’une tradition cinématographique appelée « mondo », des pseudo-documentaires prétendant contenir des scènes prises sur le vif, se servant de leur label pour échapper à la censure, et faisant preuve d’une médiocrité technique effarante. Le film du trio français est tout ça à la fois, et même un peu plus.
Si la plupart des films mondo des années 1960 et 1970 se focalisaient sur la brutalité extrême et la mort (obsession héritée des films de sécurité routière gores américains des années 1950, tels que Signal 30) ou sur le voyeurisme (sujet de prédilection des snuff films), ils devaient également leur forme à des influences de cinéma vérité, un style documentaire tout sauf véridique dont la portée se trouve bien plus dans les implications culturelles et anthropologiques du sujet filmé que dans le sujet lui-même.
Le « chocumentaire » sexuel, puisque c’est principalement de ça dont il est question dans La France Interdite, remonte facilement aux années 1940 et au cinéma d’attraction ambulant (les « roadshow pictures ») de Kroger Babb, un producteur excommunié d’Hollywood et louant petite salle après petite salle dans la campagne états-unienne pour montrer son film Mom and Dad, étalage de scènes charnelles sous couvert d’éducation sexuelle. Plus tard, de rares cinéastes français reprendrons le flambeau, comme Pierre Chevalier et son film Nathalie, l’amour s’éveille (1968). Le même réalisateur met d’ailleurs en boite, quelques mois plus tôt, le mondo en trois segments Paris inconnu.
Les ancêtres directs de ce mondo français, cependant, se trouvent dans des œuvres analysant elles aussi une scène spécifique, plaçant leur ambition dans la redéfinition d’un quotidien que l’on pense familier, sous une lumière inédite ; des œuvres comme Dossier Prostitution (Jean-Claude Roy ; 1969) et Pornography in New York (Vikkers, Moss ; 1970). Mondo Topless (1966) du légendaire Russ Meyer (Faster Pussycat! Kill! Kill!, c’était lui) est un autre de ces documentaires ne quittant pas le circuit des films de minuit, et explorant l’univers des clubs de strip-tease de San Francisco dans les années 1960, à l’époque où ceux-ci commençaient tout juste à émerger dans les villes portuaires décadentes.
Mais La France Interdite repose finalement et avant tout sur un inconscient collectif français remontant à plusieurs siècles en arrière, aux romans libertins du XVIIe et XVIIIe siècle initiés par Les Égarements du cœur et de l’esprit de Crébillon, puis entérinés dans l’héritage littéraire par Les Liaisons dangereuses de Laclos. Le film ne se réclame bien sûr pas directement d’un mouvement de libre pensée philosophique, comme l’a fait à l’époque le mouvement artistique libertin, mais l’association de mœurs hédonistes à l’histoire française et au siècle des Lumières est toujours restée là, quelque part, terrée dans un coin de la perception sociologique du pays. On en revient donc à l’objectif du cinéma vérité, celui d’articuler une observation ou de suggérer une vision nouvelle du réel à travers le simulacre de ce dernier, et c’est bien la présence d’une dimension mêlant les extrêmes de la dépravation et de la proposition idéologique qui est ici invoquée.
La révolution sexuelle qui avait accompagné les mouvements de mai 68 a eu un effet double, car les libertés gagnées dans la sphère publique ont inévitablement engendré des réactions similaires dans les espaces privés et commerciaux, cherchant à tirer profit de nouvelles opportunités. Dans les années 1970 et 1980 (d’autant plus une fois le marché de la vidéo en place), l’idéologie de la révolution s’est soudain retrouvée entraînée dans l’univers de l’exploitation. C’est l’idée sous-tendant La France Interdite, qui promeut la transcendance des frontières dans une culture marquée par 300 ans d’évolution de l’idéologie des mœurs.

N’allez pas croire cependant qu’il ne s’agit pas là d’un mondo qui se respecte, car l’exégèse se révélant plus intéressante que l’expérience elle-même, on n’échappe pas aux plans se complaisant à filmer du vide ou à s’attarder sur des scènes répétitives et interminables, ornées d’amateurisme revendiqué. Ainsi, les soirées privées exclusivement entre hommes ou femmes s’éternisent toujours plus, tandis que les scènes les plus ouvertement pornographiques sont sans doute les plus longues de l’ensemble (et notamment l’audition d’actrices X à qui l’on demande de se masturber ou de se caresser les unes les autres, ou l’épilogue explorant un donjon de soumissions sexuelles teintées de jeux de rôle). Admettons toutefois que ce film a un avantage sur certains de ses homologues : il ne tente pas d’installer de semblant de fil rouge intradiégétique au récit, nous épargnant toute séquence de remplissage aux volontés dramaturgiques.
Bien sûr, l’emploi d’une photographie douteuse et de la caméra portée sert à renforcer la tentative de création de vraisemblance du métrage, mais celle-ci est constamment sapée par la mise en scène pré-programmée de nombreuses séquences, qui tient de l’évidence même, car il n’est pas possible que l’équipe de tournage soit arrivée au bon endroit et au bon moment dans chacun des lieux concernés (et encore moins qu’ils aient filmé les séquences en une seule prise). Par exemple, le premier acte comprend une scène pivot dans laquelle une strip-teaseuse mène un peep show pour les clients confinés dans leur cabine individuelle. Un champ-contrechamp est alors utilisé, alternant entre un plan pris du dance floor et un autre de l’intérieur d’une cabine, suivant le même axe, sous-entendant par conséquent que les deux caméras auraient dû se filmer mutuellement. Il n’en est bien sûr rien.
Cette contradiction a toujours demeurée au cœur du genre mondesque, et met en exergue la question de la véracité sur la pellicule : si les mondos manipulent leur substance pour s’assurer de choquer ou d’interpeller leur public, il peut en aller de même de tout document filmé, et il en va ainsi de La France Interdite. Dans sa construction polyphonique (à rapprocher – comme c’est étrange – de la narration épistolaire des romans libertins) d’une représentation naturaliste mais reproduite de la réalité, le film d’Imbrohoris, Delannoy et Garnier fabrique sa propre fiction non seulement à travers le dispositif logistique du cinéma, mais aussi par le biais de la superstructure narrative émergeant au fil du récit, rendu cohérent grâce à la voix-off du narrateur.
Cette France interdite a beau exister dans la vie des quelques affranchis filmés, le métrage la transforme en courant souterrain englobant le pays entier, formant une alternative aux conventions sociétales et plongeant la France dans un monde plus primal. Ce monde, c’est celui du libertinage, de la déviance et du paganisme ; un monde où l’héritage culturel promeut l’exploration de nouveaux horizons, où le patrimoine du Moyen Âge se fait lieu des violences sado-masochistes, et où la religion n’est plus qu’un vague écho des rituels de magie noire hantant les campagnes reculées.

L’incroyable musique d’André Georget (lire notre article sur la musique du film) participe en outre de cette ambiguïté, faisant traverser au film fiction comme réalité, jusqu’à ce que ce dernier finisse par intégrer un domaine quasiment mythologique, enrichissant le pays d’une zone d’ombre ne demandant qu’à être défrichée. Ce n’est pas pour rien que le film se clôt sur l’image insolite et exaltante d’une jeune femme nue galopant à cheval : une scène ne pouvant être inspirée que des mythes et légendes folkloriques, venant pourtant s’inscrire dans la supposée réalité dévoilée par La France Interdite.
LA FRANCE INTERDITE
Réalisé par J.-P. Imbrohoris, J.-P. Garnier et G. Delannoy
Narré par Christian Barbier
France, 1984