Entretien avec Béla Tarr : « le monde est très vaste »
Du 29 au 31 mars, Béla Tarr était l’invité d’honneur de l’événement de printemps du Locarno Film Festival : L’immagine et la Parola (comprenant entre autres une masterclass et la projection […]
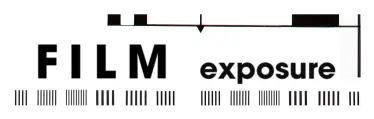 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Du 29 au 31 mars, Béla Tarr était l’invité d’honneur de l’événement de printemps du Locarno Film Festival : L’immagine et la Parola (comprenant entre autres une masterclass et la projection […]
Du 29 au 31 mars, Béla Tarr était l’invité d’honneur de l’événement de printemps du Locarno Film Festival :  L’immagine et la Parola (comprenant entre autres une masterclass et la projection en sa présence des Harmonies Werckmeister). Son séjour au Tessin était aussi (surtout) pour lui l’occasion de conduire un atelier de dix jours avec de jeunes cinéastes venus du monde entier, s’étant portés candidats pour réaliser sur cette durée, dans cette région, un film court (sur le thème Moutain – Loneliness – Desire) sous sa tutelle. L’occasion également de le rencontrer à ce sujet et celui, lié, de sa propre œuvre, caractérisée par une attention aux lieux, au déroulement du temps dans des espaces patiemment scrutés, explorés. Une œuvre affirmant le primat du sensible, elle-même une éducation du regard, la recherche d’un être au monde dans un environnement de l’après (bien des tragédies historiques) qui s’offre à être ressenti, avant même d’être raconté.
L’immagine et la Parola (comprenant entre autres une masterclass et la projection en sa présence des Harmonies Werckmeister). Son séjour au Tessin était aussi (surtout) pour lui l’occasion de conduire un atelier de dix jours avec de jeunes cinéastes venus du monde entier, s’étant portés candidats pour réaliser sur cette durée, dans cette région, un film court (sur le thème Moutain – Loneliness – Desire) sous sa tutelle. L’occasion également de le rencontrer à ce sujet et celui, lié, de sa propre œuvre, caractérisée par une attention aux lieux, au déroulement du temps dans des espaces patiemment scrutés, explorés. Une œuvre affirmant le primat du sensible, elle-même une éducation du regard, la recherche d’un être au monde dans un environnement de l’après (bien des tragédies historiques) qui s’offre à être ressenti, avant même d’être raconté.
Pourriez-vous décrire un atelier que vous donnez ?
Il est très difficile de répondre car l’atelier dépend des élèves, de notre relation, de leurs intérêts. Je n’ai jamais eu de recettes de comment faire cela, vous savez, car chacun est différent. Spécialement dans ce cas, où les élèves viennent des quatre coins du globe. Ils ont des cultures différentes, des milieux d’origine variés, une, disons, histoire différente, des religions différentes. Il faut trouver la clé pour chacun d’eux : différentes clés, différentes manières. Il vous faut trouver comment établir une relation avec chacun et après cela… quelque chose, à un moment donné, se passera, mûrira. Mais vous ne pouvez pas le faire mécaniquement. Donc, pas de recette. Ça dépend de la situation. Je ne suis jamais sûr que ça marche, mais d’habitude j’y arrive. D’une part parce qu’une sélection est faite : nous recevons beaucoup de demandes, je les étudie toutes. Le choix est personnel et je peux me tromper, on ne sait jamais. C’est vraiment un pari.
Qu’est-ce qui vous a donné le désir d’enseigner à de jeunes cinéastes et cela vous a-t-il enseigné quelque chose en retour ?
Tout d’abord, je ne crois pas que quiconque puisse enseigner la mise en scène. Si vous vous mettez en position d’enseignant, tout ce que vous faites c’est vous poser face à eux et en somme leur faire la leçon. C’est quelque chose que je n’ai jamais voulu faire, parce que si je monte sur une estrade pour leur dire quoi que ce soit, cela présuppose que j’ai raison. Que je fais les choses de la bonne manière. Un enseignant veut vérifier que l’élève fasse la bonne chose, selon ses critères. Mais j’ai appris que ce n’est pas la bonne manière de faire, et que ce n’est pas comme ça que nous apprenons vraiment. La vie m’a appris que ce modèle est une erreur. Quand j’ai commencé à Sarajevo, par exemple, le problème en ce qui me concerne, était l’absence de CV, l’absence d’un diplôme quelconque, de quelque faculté universitaire que ce soit. À partir de là, j’ai invité de nombreux cinéastes à donner des ateliers à leur guise. Tout le monde était différent, c’était un différent cadre à chaque fois. Il est important que les cinéastes comprennent combien vaste est cette planète, toutes les différentes manières qui ont pu s’y développer de faire du cinéma. Vous devez comprendre ça : il n’y a pas qu’une seule manière de faire. Aujourd’hui, vous pouvez faire un film ici tout de suite avec votre téléphone. Vous êtes libre. Il n’y a plus de règles. Si vous enseignez, vous posez un certain nombre de règles. Laissez simplement les gens être eux-mêmes, donnez-leur du courage, poussez-les à être vraiment audacieux, à repousser les limites.
Donc l’acte même de mélanger des personnes de différents horizons possède une valeur pour celles qui participent ?
Bien sûr. C’est une des valeurs de cette rencontre, car c’est important de le comprendre : le monde n’est pas que votre monde, le monde est très vaste. Il possède une vaste échelle, qui vous englobe et vous dépasse. Vous rencontrerez des personnes qui possèdent une autre religion, qui ont une histoire différente que celle de l’Europe… ce qui suscite tant d’incompréhension auprès de tous ces putains de mouvements nationalistes de merde qui ne cessent de grandir. Je suis désolé de le dire, mais je crois toujours au multiculturalisme et je crois encore qu’il n’y a qu’une manière collective de s’en sortir au XXIe Siècle.
Ce refus d’enseigner des règles est également intéressant en regard de votre propre cinéma, qui est arrivé à un refus du découpage classique et d’une certaine forme de réalisme.
Tout le monde fait différemment. J’aime beaucoup certains de mes collègues qui, eux, ne se ressemblent pas. Ils sont différents : pouvez-vous imaginer Carlos Reygadas et Apichatpong Weerasethakul assis dans la même pièce et discutant ensemble de dramaturgie, ou quelque chose dans le genre ? Apichatpong est très calme, silencieux, il pratique la méditation. Rien à voir avec Carlos qui est Mexicain, très énergique et bruyant. Mais Apichatpong et lui pouvaient travailler ensemble, discuter ensemble. C’est vraiment très important. Ils ont des styles réellement différents, des approches de la mise en scène qui ne sont pas du tout les mêmes, mais cependant, à un certain endroit, leurs points de vue convergent, se ressemblent quand même un peu. Beaucoup de grands cinéastes, aussi différents soient-ils, voient les choses, à une certaine échelle, qui est vraiment large, d’une manière qui est très proche. Au final, ils entrevoient la même chose.
Vos étudiants travailleront dans la région, vous êtes vous-mêmes venus au Festival de Locarno y présenter deux films (ndr : Rapports Préfabriqués, 1982, Almanach d’Automne, 1984) : l’aviez-vous exploré à l’époque ?
Non… Là nous n’avons que dix jours : ce sera rude, un travail du matin au soir sur cette durée. Ça ne déconne pas. Tout le monde doit travailler très dur, pour produire à partir de nos alentours quelque chose dans ce temps imparti.
Votre atelier se nomme Mountain – Loneliness – Desire. Il n’y a pas beaucoup de montagnes dans vos propres films, mais les paysages, la solitude et le désir en font en revanche résolument partie.
Les montagnes sont au programme car ici il n’y a que ça…
Ce n’est pas la Hongrie…
La Hongrie au contraire est un pays plat, le territoire s’étend à perte vue. Ici tout est si proche de tout, le champ de vision est immédiatement restreint. Je ne sais pas où poser mon regard : où est le ciel ? Voilà par exemple une différence notoire. Mais je suis d’accord avec vous : le paysage, la nature, font partie de la vie. Nous faisons partie de notre environnement et nous devons le ressentir. Tout arrive dans le temps et dans l’espace, c’est le tissu de nos vies. C’est pour ça que je commence par la montagne, puisque ici je ne vois que ça.
Il y a aussi les lacs…
D’accord, les lacs aussi font partie de ce paysage.
Pourriez-vous parler de l’exposition Till the End of the World que vous avez présenté aux Pays-Bas ? Elle paraît ramener une certaine forme de colère dans votre œuvre.
Oui… Cette exposition c’était simplement… Je voulais aller vers l’installation, projeter quelque chose quelque part, j’ai tourné de nouveaux plans. Je suis à la recherche de nouvelles structures, de nouvelles pistes formelles. C’était à titre d’expérimentation, car je n’avais jamais fait d’exposition avant celle-là. C’était une expérience très joyeuse, entourée de personnes bienveillantes. Ça a été pour ainsi dire facile à faire. Mais là, ça va devenir plus difficile, car je travaille sur une autre forme pour le prochain Festival de Vienne où je m’apprête à faire une sorte de performance, qui inclura des éléments théâtraux, du cinéma, de l’installation, de la musique live. C’est un gros projet et j’aimerais faire venir cinquante sans-abris dans cet espace. C’est vraiment quelque chose.
Vous êtes un cinéaste qui a aussi beaucoup d’influence hors de la sphère du cinéma lui-même, des artistes qui ne sont pas des cinéastes admirent vos films…
Je ne sais pas, je ne réfléchis pas à cela. On pourrait dire que ce que je fais maintenant se rapproche d’une forme de théâtre.
Avez-vous toujours été intéressé par le théâtre ?
Non, jamais… Voyez-vous le théâtre est un art de l’instant : ça arrive maintenant. Je préférais les films parce que vous traquez le bon moment, un moment réellement humain et là vous le filmez, puis c’est dans la boîte, à disposition pour toujours. Au théâtre, même si vous êtes très précis, que vous savez ce que vous cherchez, survient toujours quelque chose d’inattendu. Certaines personnes aiment beaucoup ça, mais pour une raison ou une autre je n’ai jamais eu d’appréciation pour cette chose. J’ai grandi dans l’univers du théâtre, car mes parents y travaillaient. J’y ai passé mon enfance. J’ai une grande familiarité avec ce monde. Peut-être qu’un jour je m’y essaierai, car à présent je ressens le besoin de faire des choses que je n’ai jamais faites. Pour la simple raison que je suis curieux. Mais je ne suis pas sûr d’être d’humeur à m’y lancer ou non. Peut-être pour un opéra…
Le fait qu’au théâtre tout puisse déraper, tandis qu’au cinéma vous connaissez d’une certaine manière le matériau engrangé, cela demande une autre forme de confiance…
Mais vous savez, mon but n’est pas l’expression de soi, de m’exprimer moi-même. Tout ce que je fais, c’est regarder le monde, en capturer quelque chose et le partager avec d’autres. « Voici ma réaction au monde. » Cela n’a rien d’un acte exhibitionniste.
Et quelle est votre réaction au monde en ce moment ?
(dans un large sourire) – Vous verrez à Vienne…
Vos films témoignent d’un grand sens, souvent musical, de l’ouverture…
Oui, j’aime beaucoup les ouvertures. Parce que c’est le moment où vous établissez un contrat avec le public. Comme dans un opéra : l’ouverture vous renseigne sur ce que vous verrez durant les deux heures à venir. C’est pourquoi j’aime beaucoup ce moment : si le public aime ce que vous proposez au début, qu’il ne quitte pas immédiatement la salle, dans ce cas il restera jusqu’à la fin. Si quelqu’un doit partir, il peut partir dès l’ouverture. Il n’y a pas de problèmes. Je les ai informés : sur le style, sur ce qu’ils verront, sur comment cela leur sera montré. Ils sont sur des rails, tout va bien.
Est-ce important pour vous parce que vos films requerront ensuite d’eux une certaine forme d’attention ?
Je ne crois pas, mais… Bon, d’accord : je saisis les gens, je veux que soyez dedans tout de suite et, bien sûr, je veux que vous écoutiez. Mais d’ordinaire, je n’ai que cela à dire : écoutez votre cœur et ayez confiance en votre regard. Et ne mélangez pas ces deux choses.
C’est une question très générale, mais… quelle a été votre expérience de l’effondrement du système communiste ?
À ce moment, je vivais à Berlin-Ouest. Nous étions là quand le Mur s’est effondré, dans les rues durant cette nuit historique. Vous savez c’était un peu imprévisible, car vous aviez grandi au sein d’un système et vous ne pouviez pas vraiment croire qu’il changerait. Mais à la fin, c’est bel et bien ce qui est arrivé : il s’est effondré de lui-même. C’est important de comprendre cette distinction : ce ne sont pas les gens qui ont changé, ou le régime qui le désirait, simplement le système qui était trop pourri, trop faible. Et il s’est tout simplement effondré. Ce n’était pas une révolution, une mobilisation du peuple, c’est simplement arrivé. C’est pourquoi je suis quelqu’un de nature un peu sceptique, car mon sentiment est qu’en fin de compte pas grand-chose n’a changé depuis. Disons que le « décor » est un peu plus coloré. Vous avez des banques, des noms de métiers qui sonnent bien, des bars… mais dans le fond, rien ne s’est passé, on en est toujours au même point.
Les problèmes sociaux que vous traitiez au début de votre carrière sont toujours on ne peut plus réels…
Malheureusement, oui. Parfois, c’est pire : quand nous avons fait les Harmonies Werckmeister, qui sera projeté ici ce soir, c’était une sorte de fiction, nous n’aurions pas pu croire que cette situation soit vraie. Maintenant, si vous regardez le monde : ce film est réel, il est devenu réel.
Il est vrai que cette période de votre œuvre, Sátántangó, Les Harmonies Werckmeister, traite de formes de désespoir qui sont très visibles actuellement.
Vous savez, cette histoire de désespoir… Quand vous faites un film, vous voulez saisir le public, le secouer. Si des gens viennent ensuite et me disent : « Vos films sont trop sombres, trop pessimistes, vous ne voyez pas ce qu’il y a de noble ou de porteur d’espoir… » Ma réponse est : « allez vous faire foutre. » Je n’ai qu’une question : Quand vous avez quitté la salle, étiez-vous plus forts ou plus faibles, en tant qu’êtres humains ? Je veux que vous vous sentiez plus forts en sortant. C’est tout. Si vous vous sentez forts, tant mieux. Personne n’est jamais venu me dire qu’un de mes films l’avait affaibli.
Seriez-vous d’accord pour dire que cet affermissement a trait à l’exercice d’une empathie, sachant que vos films vous mettent en position de l’exercer avec des personnes laissées-pour-compte ?
C’est ce que vous souhaitez ardemment pour chaque film : que toute l’empathie dont vous êtes capable y soit. Parce que vous travaillez avec des personnes réelles. Vous devez les comprendre, les sentir. C’est capital. L’empathie est à la base de tout le reste. Après il vous faut deux, trois choses en plus. Mais à la fin, c’est vraiment ce à quoi tout se ramène.
Les ouvrages que vous avez adapté de László Krasznahorkai reposent sur des arguments satiriques, mais votre traitement de ces textes n’est pas, ou alors de manière très locale, de nature satirique…
Krasznahorkai n’est pas satirique. Les « bonnes choses » dans ce qu’il écrit sont parfois drôles, mais le sens de ses écrits malheureusement ne l’est pas. Vous trouvez l’humour dans les petites choses, pas dans une perspective plus large. De toute façon, il est impossible de réaliser une adaptation, car le cinéma et la littérature sont deux langages différents. Quand par exemple j’ai lu Sátántangó, je l’ai beaucoup aimé mais j’ai compris tout de suite que, non, il aurait été impossible d’en faire une adaptation. Il y a une certaine réalité autour de nous et il a écrit sur cette réalité, en partant d’un certain point de vue. Il en a dressé une certaine image. Elle constitue une sorte d’interprétation de cette réalité. Si je veux faire un film à partir d’un de ses textes, je dois revenir à sa réalité. Je dois trouver une manière, au cinéma, avec un langage différent, de traduire la vision qu’il en a. C’est très difficile à expliquer. Mais j’ai passé quatre ans à travailler sur ce film. Durant deux ans, je n’ai fait que voyager, explorer les lieux où nous tournerions. J’en connais chaque maison, à peu près tous les gens du coin. Je me renseigne autant que je peux sur cette foutue parcelle du monde. Vous engrangez un certain savoir, que vous pouvez utiliser au sein d’une structure dramaturgique. Vous devez créer les situations, des scènes de cinéma. Ce n’est pas un travail d’adaptation. C’est ce que vous avez à faire si vous voulez toucher à l’os de cette putain de réalité, comprendre son point de vue à lui sur elle.
C’est aussi un autre rapport au temps, puisque vous ne compressez pas les choses au sein de cette dramaturgie, vous les laissez se développer…
La dramaturgie est très stricte. C’est juste que j’utilise le temps différemment. Non, tout est très bien composé. Mais c’est un exercice compliqué. La plupart des cinéastes ignorent le facteur temps, alors que c’est une composante essentielle de nos vies. Tout arrive dans le temps… et dans l’espace. Vous ne pouvez pas vous en extraire, vous ne pouvez que l’oublier. Moi, je vous pousse à vraiment regarder ce qui se passe au sein de la scène, et pas à la survoler. À mon sens, le problème de la plupart des films est très simple : ils sont pensés comme des bande dessinées. Vous voyez ? «Action/Coupez. Action/Coupez. Action/Coupez…» Qu’est-ce qu’on en a à foutre ? Parfois, je le fais un peu : une coupe pour apporter une information, mais pour moi (il regarde autour de nous), un morceau de mur, une tasse de café, c’est une information… Tout est informatif, ce qui change est le degré d’attention accordé aux choses.
Avez-vous vu, depuis votre pour ainsi dire retraite du cinéma, des films qui vous aient profondément ému ?
J’ai par exemple beaucoup aimé le dernier film de Carlos Reygadas (ndr : Nuestro Tiempo), je suis très mauvais pour les titres… Et bien sûr le dernier film de Pedro Costa : Cavalo Dinheiro. J’aime énormément ce que fait Apichatpong… Cemetery of Splendor… J’aime très fort ces trois films, ce sont ceux qui m’ont ému ces dernières années. Je ne vois pas tout ce qui sort, parce que je n’ai pas le temps. Disons que ce serait ma sélection, il n’y en a pas d’autres qui me viennent en ce moment à l’esprit. Mais trois films, c’est suffisant pour une décennie.
Propos recueillis le 29 mars à Locarno. Remerciements à Ursula Pfander, Giada Peter, Nathalie Solimano, ainsi qu’à l’équipe du Locarno Film Festival.
Photo de couverture © Locarno Festival