La persistance des Vikings au cinéma
Revenons sur l’histoire des guerriers d’Odin au cinéma à travers plus de 80 films afin d’en relever les caractéristiques et d’essayer d’en comprendre la persistance.
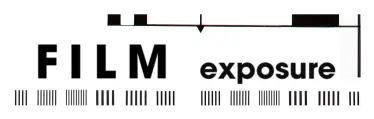 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Revenons sur l’histoire des guerriers d’Odin au cinéma à travers plus de 80 films afin d’en relever les caractéristiques et d’essayer d’en comprendre la persistance.
 « Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà qu’ils m’appellent, et me demandent de prendre place à leur côté dans le palais du Valhalla, là où les braves vivent à jamais… »
« Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà qu’ils m’appellent, et me demandent de prendre place à leur côté dans le palais du Valhalla, là où les braves vivent à jamais… »
Ils ont cessé d’exister en tant que civilisation proprement dite depuis le milieu du XIe siècle et pourtant, les Vikings sont toujours vivants. Ils poursuivent en effet leur évolution dans les pages de nos livres, dans les cases de nos bandes dessinées, à travers nos sonorités renouvelées et sur nos écrans de toute taille, sur presque tous les continents. Alors que les studios Disney sérialisent au cinéma, depuis 2011, les aventures d’un personnage directement inspiré du panthéon nordique, et que les Vikings continuent d’alimenter les séries B comme les grandes fresques épiques (entre autres séries télévisées et projets intrigants), revenons sur l’histoire des guerriers d’Odin au cinéma, afin d’en relever les caractéristiques et d’essayer d’en comprendre la persistance.
C’était à l’origine des temps, alors que régnait le néant…
D’où vient la fascination indomptable qu’exerce la civilisation viking sur l’imaginaire héroïque occidental ? Probablement pas du Ginnungagap, gouffre mythologique primordial du monde nordique. Il convient plutôt de s’en tenir à quelques siècles d’histoire, et constater que l’intérêt pour le passé scandinave est né des régions nordiques elle-mêmes tout au long du Moyen Âge, alors que des conflits opposent sans cesse le Danemark et la Suède, et que l’Europe du Nord ne parvient que difficilement à conserver un semblant de stabilité. Souhaitant tourner l’histoire nationaliste en argument culturel et renforcer leur légitimité, les différents souverains ordonnent la conduite de diverses recherches académiques, donnant lieu à des récits formatifs, de la Geste des Danois à la Défense de l’Islande, en passant même par une théorie nationaliste du Suédois Olof Rudbeck, selon laquelle la Suède correspondrait à l’Atlantide et le suédois à la langue originelle de l’humanité. Le milieu du XVIIIe siècle est décisif pour l’essor du monde scandinave antique : en 1756, le Suisse Paul-Henri Mallet publie, sur la demande du roi Frédéric V de Danemark, l’ouvrage Monuments de la mythologie et de la poésie des Celtes et particulièrement des anciens Scandinaves, qui a pour but de promouvoir la richesse culturelle de l’Europe du Nord sur le continent. Peu après, la frénésie ossianique initiée par le poète James Macpherson s’empare des intellectuels européens, qui découvrent alors un compagnon d’armes à l’indétrônable Homère, aussi fantasmatique soit-il. Dès lors, l’intérêt pour la mythologie nordique ne faiblit plus, et il ne faudra plus longtemps aux Vikings pour reconquérir l’espace idéel européen. Un élément d’explication fascinant mais contre-intuitif a été proposé par Andrew Wawn dans son ouvrage The Vikings and the Victorians: Inventing the Old North in Nineteenth-Century Britain :
« De bien des façons, les Victoriens ont inventé les Vikings. […] En l’espace de cinquante ans, le mot « Viking » était apparu sur des dizaines de documents : des poèmes, des pièces, des fables morales, des parodies, des retranscriptions de sagas, des essais, des conférences écrites, des articles de revues académiques, des traductions, des carnets de voyage, des monographies, et des entrées encyclopédiques. »
Cette réintroduction de la civilisation viking à l’époque victorienne tient de multiples facteurs, comprenant notamment l’émergence de questions relatives à l’identité nationale britannique, ainsi qu’à la place de plus en plus importante accordée aux études philologiques, qui menèrent donc inévitablement les érudits à retracer les pas des envahisseurs vikings ayant laissé une marque indélébile sur la culture anglo-saxonne pendant le Moyen Âge.
Dès lors, les Vikings n’ont jamais vraiment quitté la conscience populaire occidentale, et ils finiront évidemment par donner lieu à un important corpus cinématographique. Un parfait exemple de la persistance de cette fascination aux ramifications victoriennes se retrouve jusque dans le film L’Île sur le toit du monde (Robert Stevenson ; 1974), une production Disney se déroulant au début du XXe siècle, dans laquelle un aristocrate britannique organise une expédition vers les régions arctiques pour retrouver son fils disparu. Il emploie à cette fin les services d’un archéologue de descendance scandinave et d’un inventeur français acceptant d’affréter son dirigeable steampunk, l’Hyperion. Leur aventure les mène à la découverte d’une colonie insulaire viking ayant évolué en autarcie totale depuis des centaines d’années, dont les habitants ne s’expriment qu’en vieux norrois ! Les fantasmes de projection de l’imaginaire collectif se retrouvent ici réunis pour proposer une représentation hautement iconique des Vikings et de leurs rapports avec la civilisation moderne, du paganisme ésotérique (en atteste la présence du godi antagoniste) aux tuniques et casques anachroniques, en passant par leur capacité de rédemption et d’ouverture vers un possible salut post-apocalyptique (l’ultime dialogue posant l’île secrète d’Astragard comme potentiel refuge futur pour l’humanité).
Cette influence victorienne a-t-elle cependant suffit à emmener les Vikings jusqu’aux rivages du nouveau millénaire ? Un autre élément d’explication se trouve dans l’introduction du livre Légendes de la mythologie nordique, de Jean Mabire :
« Derrière les hauts murs des collèges catholiques, la mythologie gréco-latine semblait apprivoisée et affadie. Elle n’était plus jugée dangereuse et les adolescents se voyaient autorisés à taquiner les muses. Le tonnerre de Zeus devenait anodin. La légende dorée des dieux et des héros de l’ancienne Hellade ou de la Rome antique se trouvait ainsi récupérée, véritablement aseptisée, débarrassée de tous les miasmes septentrionaux, qui constituaient pour les clercs une sorte de mal absolu. L’Antéchrist venait du froid… Les dieux maudits, ignorés, perdus dans les brumes du Nord devaient fatalement m’apparaître séduisants, dans la mesure où ils restaient interdits. Réflexe élémentaire de tout adolescent : la révolte contre l’ordre établi et surtout enseigné. »
Ainsi, la fascination persistante dont jouissent encore aujourd’hui les Vikings et leurs dieux viendrait à la fois d’une prise de conscience historique exacerbée à l’époque victorienne, et d’un désir d’explorer les zones culturelles volontairement laissées dans l’ombre par l’enseignement occidental chrétien – ce n’est pas une coïncidence si ladite résurgence de l’histoire nordique a eu lieu pendant le siècle de Darwin, des fouilles archéologiques, de Nietzsche et des recherches linguistiques.
La représentation graphique des Vikings au cinéma a autant évolué que leur traitement scénaristique, mais un certain nombre de signifiants visuels symboliques sont depuis longtemps utilisés par les réalisateurs pour faire accepter immédiatement aux spectateurs la présence de ladite population à l’écran. Ainsi, il n’est pas important, en termes cinématographiques, de savoir si les Vikings portaient oui ou non des casques à cornes à tout bout de champ, car c’est leur reconnaissance immédiate par le public qui importe.
« Les spectateurs acceptent qu’une coupe à la César, par exemple, se fasse symbole de l’époque de la Rome antique, non parce qu’ils seraient naïfs ou trop peu sophistiqués, mais parce qu’ils sont devenus des lecteurs compétents de ce raccourci cinématographique permettant de raviver pendant deux heures une époque révolue. Les systèmes de sens composant ledit raccourci se retrouvent dans de nombreux films très variés, ce qui les transforme en vecteur de suspension d’incrédulité volontaire, qui nous permettrait de pénétrer éphémèrement dans la diégèse du film, même si la représentation approximative du passé est susceptible de laisser les historiens perplexes. »
– Laurie A. Finke et Martin B. Shichtman, Cinematic Illuminations: The Middle Ages on Film
De même, les films de Vikings n’ont jamais pour objectif de constituer des documentaires ou reproductions fidèles à l’histoire, mais d’en construire une nouvelle image, correspondant aux objectifs des cinéastes ou aux attentes des spectateurs. C’est pourquoi il n’est pas non plus important, en dehors d’exercices de comparaisons académiques, de savoir si tel ou tel événement dépeint dans un film s’est vraiment déroulé : la véracité du récit n’a d’importance qu’aux niveaux diégétique (pour les personnages) et interprétatif (pour le public).
Le tout premier film de Vikings dont le nom a survécu au passage du temps est The Viking’s Bride (Lewin Fitzhamon ; 1907), en provenance du Royaume-Uni. Peu d’informations subsistent (tous les courts métrages primordiaux ici évoqués semblent être perdus), mais certains ouvrages rapportent que ce court-ci traite de l’enlèvement d’une jeune mariée viking par une tribu ennemie, suivie de son sauvetage par son prétendant légitime et ses hommes. On remarquera cela dit que, logiquement, ce sont les britanniques qui donnent vie aux Vikings sur pellicule, et ce au sortir de leur époque victorienne et de leur obsession académique pour la culture nordique médiévale. Parallèlement, un autre court émerge cette année-là, cette fois au Danemark : Vikingeblod (Viggo Larsen ; 1907), un film renommé The Hot Temper aux États-Unis, et qui se serait intéressé à une rivalité entre deux familles. Il est possible qu’il ait été inspiré de l’opéra n°50 du compositeur danois Peter Lange-Müller, portant le même nom.
L’année suivante, The Viking’s Daughter: The Story of the Ancient Norsemen (J. Stuart Blackton ; 1908) sort aux États-Unis et tisse un récit mêlant problématiques raciales, sexuelles et de classes, en mettant en scène la capture et la mise en esclavage d’un prince saxon par un clan de Vikings, qui tombera réciproquement amoureux de la fille du chef de tribu. Après avoir sauvé sa vie au cours d’un incendie, le patriarche accepte que l’esclave retrouve sa liberté et épouse sa fille.
En 1914, Edison produit à son tour une aventure nordique avec The Viking Queen (Walter Edwin), court dans lequel une chef de clan nommée Helga parvient à repousser une insurrection sur son territoire, tout en conquérant de nouveaux trésors en terres ennemies. La même année, enfin, sort le visiblement très romantique The Oath of a Viking (J. Searle Dawley), qui suit le parcours d’un Viking ayant fuit sa tribu, et tombant amoureux d’une femme qui appartient à un autre clan. Après avoir essayé de la séduire bien qu’elle soit déjà promise à un homme, il est renvoyé chez lui pour subir les conséquences de ses actions.
En dehors du monde anglophone, l’opéra de Wagner inspire deux réalisateurs italiens à concevoir des courts métrages basés sur son cycle mythologique : I Nibelunghi (Mario Bernacchi ; 1910) et Siegfried (Mario Caserini ; 1912). Bien qu’introuvables, on peut sans doute supposer qu’ils synthétisent la légende du héros Sigurd, qui vivait alors une renaissance encouragée par le romantisme allemand. Sans grande surprise donc, la première grande œuvre cinématographique inspirée de l’héritage nordique – et à ce jour l’une des plus accomplies – est le diptyque allemand muet Die Nibelungen de Fritz Lang, sorti en 1924. Dans une aventure avoisinant les cinq heures, le cinéaste reprend le mythe du trésor des Nibelungen et du héros Siegfried pour créer un récit d’aventure aux propensions épiques, usant toujours plus efficacement de son sens de la composition et de l’éclairage afin de magnifier l’univers imaginaire représenté. Ainsi, chaque plan devient un vecteur du drame se déroulant à l’écran, transformant ses composants minutieusement fabriqués en référence du genre : le héros auquel le public s’identifie, son monde rempli de mystères, ses adversaires étrangers qu’il convient de conquérir, de tromper ou auxquels il faut résister, l’honneur indéfectible encadrant la vie des personnages, etc. Familiers du mythe, le réalisateur et sa femme Thea von Harbou choisissent donc d’emprunter autant à la chanson d’origine qu’à la version wagnérienne désormais populaire, faisant par exemple de l’épisode du dragon un événement important, et ouvrant le film sur le façonnement d’une épée. Le caractère pionnier de ce monument du cinéma muet ne saurait être trop souligné, tant aucun des films subséquents n’aura su totalement se détacher de la structure narrative ici proposée par Lang. Il partage toutefois le rang d’œuvre référentielle avec une autre production, elle en provenance des États-Unis.
Avant d’aborder celle-ci, cependant, précisons qu’un film suédois s’inspirant des sagas sort dans l’intervalle. Il s’agit de Arnljot (Theodor Berthels ; 1927), qui s’intéresse au personnage d’Arnljot Sunvisson Gelline, apparaissant dans la saga des rois de Norvège rédigée par Snorri Sturlusson. Le film constitue cependant une adaptation plus directe de l’opéra éponyme du compositeur Wilhelm Peterson-Berger, qui s’occupe également des arrangements musicaux sur la production. Selon la cinémathèque suédoise, le film met en scène le retour au pays du Viking Arnljot après plusieurs années passées en mer. Il découvre que la femme à qui il était promis s’est mariée avec un autre et, ne pouvant s’empêcher d’assassiner son rival, est ensuite banni de son clan. Il s’aventure dans les montagnes où il devient un ermite qui offre sa protection à une jeune femme lapone. Dans l’intervalle, sa promise se convertit au christianisme et est chassée de son village. Tentant de se rendre en Norvège (gouvernée par le roi chrétien Olaf Haraldsson), elle rencontre à nouveau Arnljot, qui ne parvient pas à raviver leur amour. Il hésite d’abord à mettre fin à ses jours, puis décide de rejoindre l’armée sainte d’Olaf, par qui il est baptisé. Les deux hommes trouvent finalement la mort lors de l’historique bataille de Stiklestad opposant chrétiens et païens.
Cap sur l’Amérique avec The Viking (Roy William Neill ; 1928), dernier film muet du genre et premier long-métrage en Technicolor à bénéficier d’une bande originale complète, un récit d’aventure (qui présente des similarités mélodramatiques avec le court de Blackton susmentionné) qui se réapproprie en substance les légendes d’Erik le Rouge et de son fils Leif Erikson pour remythologiser à la fois les histoires des Vikings et le passé primordial américain (la fin du film affirmant, faussement, que la Tour de Newport à Rhode Island est un vestige de colonie viking). Cette œuvre, elle aussi fondamentale dans la construction du genre au cinéma (notamment en raison de ses partis pris esthétiques et narratifs mettant l’accent sur les décors chatoyants ou sur l’adoration portée à la culture dépeinte) installe un dialogue entre fois, le christianisme étant présenté comme unique voie de rédemption d’un peuple barbare : c’est la foi chrétienne de Leif qui lui permet d’épargner l’esclave qui le trahit et de découvrir Vinland. Là encore, l’attrait pour les Vikings est parfaitement illustré par le fait que le film commence par les représenter comme des sauvages à la brutalité excessive, puis fait progressivement d’eux le peuple de la civilisation, et les premiers évangélistes pacifistes de l’Amérique. Dans son livre Nordic Exposures: Scandinavian Identities in Classical Hollywood Cinema, Arne Lunde résume l’objectif métatextuel du film de la manière suivante :
« [Un déploiement] de l’idéal nordique des Vikings en termes biologiques et vitalistes, couplé à une assimilation et à un désarmement en toute sûreté de leur altérité païenne, qui risquerait de mettre à mal la norme anglo-saxonne d’Hollywood. »
Le chercheur continue en soulignant le fait que le film est obsédé par le fait de démontrer que la présence de l’homme blanc en Amérique du Nord prédate Christophe Colomb de plusieurs siècles, et que sa revendication à ces terres est légitime, appartenant de fait à une histoire mythologique toujours entourée de mystère.
Les Vikings semblent ensuite disparaître du paysage cinématographique mondial dans les années 30 et 40, peut-être en raison d’une abondance de l’imagerie liée sous l’Allemagne nazie qui, influencée par les travaux runiques du théoricien Guido von List, s’engage dans une exploitation réinterprétative des anciens symboles nordiques, en particulier sous la direction de l’intellectuel Karl Maria Wiligut. Aux États-Unis, même les auteurs de pulps et de comics évitent globalement cette mythologie malgré leur exploration acharnée des univers imaginaires (à l’exception notable de Prince Vaillant, évoqué ci-dessous). Mike Ashley relève en outre un exemple particulièrement parlant du statut des dieux et héros nordiques à l’époque :
« Dans l’histoire « The Daughter of Thor » d’Edmond Hamilton (Fantastic Adventures, août 1942), […] les dieux se battent d’abord du côté des Nazis assoiffés de guerre, jusqu’à ce qu’ils réalisent que ces derniers, inhumains, leur ont mentis, et qu’ils décident de changer de camp. »
– Mike Ashley, The Time Machines: The Story of the Science Fiction Pulp Magazines
Histoires mythologiques : des mythes divins aux aventures légendaires
La stratégie globale du cinéma représentant la civilisation viking (et, c’est évident, d’autres peuples médiévaux inspirant une certaine fascination) répond de deux approches complémentaires, déjà illustrées en filigrane dans les deux œuvres majeurs d’avant-guerre précitées. La première se résume simplement à perpétuer la tradition de passation des aventures légendaires impliquant les acteurs du panthéon nordique, qu’il s’agisse de dieux ou de héros peuplant les grandes sagas de l’Edda (comme dans le diptyque des Nibelungen de Fritz Lang). Il s’agit ainsi d’un mouvement de mythologisation descendant, du mythe vers son expression articulée. La seconde s’apparente plus à une manœuvre anti-évhémériste, se traduisant par une remythologisation d’un passé historicisé (à l’instar de The Viking de R.W. Neill). On parlera plutôt, dans ce cas, de mouvement ascendant, partant du conte trivial vers son inscription dans le mythe.
Suite à l’épopée mise en images par Lang, la continuation des récits mythologiques scandinaves se divise en deux courants : les adaptations directes de légendes, et leur transmutation à un contexte culturo-populaire nouveau. Cette dernière se retrouve notamment dans les films de la Marvel mettant en scène le personnage de Thor, qui évolue dans un univers inspiré des légendes nordiques et représente désormais une petite icône culturelle à la portée limitée mais bien réelle, permettant de réinscrire l’existence de concepts comme Asgard, le Valhalla ou les neufs mondes dans l’inconscient collectif d’une certaine frange de la population. L’appartenance des métrages Thor (Kenneth Branagh ; 2011) et Thor : Le Monde des Ténèbres (Alan Taylor ; 2013) à une gamme de films plus vaste les empêche cependant d’accéder à un statut de type mythologique comme on l’entend avec le panthéon des dieux scandinaves, car ils doivent répondre d’une certaine logique science-fictionnelle commune qui les rend plus terre-à-terre, transformant à demi-mot les Asgardiens en extra-terrestres privés de pouvoirs réellement magiques ou transcendantaux. Surtout, personne dans ces films ne croit réellement que les Asgardiens sont des divinités (à part peut-être eux-mêmes), ce qui les vide inéluctablement de toute portée spirituelle. Ils participent toutefois bel et bien d’un corpus de récits mythologiques contemporains en contribuant au genre des super-héros, dont les objectifs narratifs ne sont pas les mêmes que les films dits « de Vikings », car la représentation – même à l’état conceptuel – d’un peuple, d’une époque, de mœurs ou d’événements précis ne fait absolument pas partie de ses entreprises. Par conséquent, si les termes et certains symboles persistent, ils y sont utilisés de manière superficielle, comme un habillage potentiellement interchangeable avec d’autres systèmes de référence mythologiques (il suffirait, en effet, de renommer tous les termes idiosyncratiques des films en adoptant la mythologie celtique ou romaine, que cela n’aurait que peu d’impact sur la finalité du récit). Au final, comme avec les comics, le monde cinématographique de Thor a moins à voir avec les mythes nordiques qu’avec la représentation allégorique de l’identité culturelle américaine.
Marvel ne sont cependant pas les premiers à avoir exploité une entité culturelle descendue des Vikings, en attestent les adaptations cinématographiques de la bande dessinée Prince Vaillant, elle-même apparue sous forme de strips dans les années 1930 aux États-Unis. La différence essentielle avec les autres comics d’alors, cependant, tient du fait que le protagoniste est un prince nordique ayant prêté allégeance au roi Arthur et aux chevaliers de la Table Ronde, et qu’il s’oppose souvent en personne à des envahisseurs vikings. Il représente donc l’archétype parfait de l’immigrant entièrement assimilé à son pays d’accueil, qui n’hésite pas à combattre ses frères de sang au nom de son soutien à la culture arthurienne (comprendre, dans le contexte de publication, à la culture américaine occidentale). L’opposition répétée de Vaillant à ses adversaires Huns (surnom largement utilisé pendant la guerre pour désigner les Allemands en anglophonie) est à l’époque une prise de position à peine déguisée.
C’est donc sans grande surprise que l’on trouve la première adaptation de ladite bande au cœur de la Guerre Froide : Prince Vaillant (Henry Hathaway ; 1954) substitue l’allégorie nazie à l’allégorie communiste, faisant de Vaillant le défenseur de sa culture d’adoption face aux envahisseurs vikings. Teinté de paranoïa anti-rouge, le film baigne dans un anachronisme amusant, illustrant parfaitement l’inutilité de l’historicité en fiction : en mêlant Vikings et légende arthurienne, le récit confond les invasions barbares avec les raids Vikings, des périodes tout de même séparées d’environ 400 ans. Mais dans la conscience collective, ces événements appartiennent tous plus au moins au même passé, ancien, distant, presque mystérieux car ayant inspiré les plus grands univers de fantasy littéraire. Le but du film d’Hathaway n’est donc évidemment pas de relater authentiquement quoi que ce soit, mais d’enrichir la mythologie médiévale au détour d’un film opposant christianisme et paganisme, civilisation et barbarie supposée.
Cette même barbarie est de nouveau exposée dès les premières minutes de la seconde adaptation cinématographique de la bande dessinée. En effet, dans Prince Vaillant (Anthony Hickox ; 1997), Vaillant combat aux côtés du roi Arthur les envahisseurs vikings venus dérober Excalibur sous l’influence de la maléfique Fée Morgane. Né de la volonté de la compagnie allemande Neue Constantin Film qui souhaite exploiter la popularité de la bande dessinée, le métrage est tourné en moins de deux mois et constitue ce que certains appellent un projet « d’Europudding », c’est à dire qui réunit des forces créatrices paneuropéennes (en l’occurrence, des lieux, producteurs, acteurs et scénaristes allemands, ainsi que des lieux, acteurs et un réalisateur britanniques – en outre responsable de séries B telles que Hellraiser III et Warlock). Le film privilégie un ton globalement humoristique et enfantin, et choisit de mettre la dimension arthurienne en avant, au détriment de la culture viking. Toujours est-il que les Vikings, antagonistes du récit, sont dépeints comme étant à la fois dangereux et quelque peu ridicules, s’exprimant notamment avec un fort accent allemand. Ils représentent ainsi une menace d’ordre existentiel externe constamment jugée comme étant inférieure et moins évoluée que la société saxonne. L’identité visuelle peu remarquable des Vikings, alliée à l’absence de leurs caractéristiques culturelles ou religieuses, laisseraient toutefois penser que les guerriers nordiques jouent ici le rôle de représentants interchangeables d’ennemis étrangers. Une entité vite oubliable du corpus, donc, qui ne tient pas à explorer ses possibilités.

La meilleure adaptation d’une bande dessinée consacrée aux Vikings est probablement le film d’animation danois Valhalla (Peter Madsen, Jeffrey J. Varab ; 1986), projet le plus cher de sa catégorie à l’époque de sa sortie au Danemark et qui, malgré son immense succès populaire, ne rentra pas dans ses frais. Le film est adapté de la série de BD du même nom, conçue de 1978 à 2009 par l’illustrateur Peter Madsen et ses divers collaborateurs, se focalisant plus particulièrement sur les tomes 1, 4 et 5 (seuls trois tomes ont été publiés en français). L’histoire, adaptée aux jeunes enfants, s’articule tout simplement autour de fables mythologiques inspirées de l’Edda de Snorri, et plus particulièrement des passages impliquant le géant Útgarða-Loki. Une entreprise de passation de contes folkloriques conforme à la tradition orale, en somme, représentant un parfait exemple du mouvement descendant de mythologisation culturelle.
Peu d’autres films s’intéresseront directement aux dieux nordiques. On écartera promptement l’inégalable série Z Thor le guerrier (Thor il conquistatore ; Tonino Ricci ; 1983), un film d’exploitation italien d’une abyssale nullité, tourné dans une seule forêt avec une dizaine d’acteurs, et mettant en scène un fac-similé de Conan le barbare, aux tendances de violeur complètement attardé. Inutile de préciser en détails que ce film n’a strictement aucun rapport ni avec les Vikings, ni avec la mythologie nordique (le protagoniste est un humain ordinaire, allié à la divinité « Teisha »), si ce n’est une vague descendance thématique héritée du modèle qu’il copie. Que dire sinon du tout aussi abyssal Les Gladiatrices (Le Gladiatrici ; Antonio Leonviola ; 1963), autre film d’exploitation italien (en coproduction avec la Yougoslavie) dans lequel le personnage principal, nommé Thor, est un sous-dérivé d’Hercules ? Que dire de son « ami » noir Ubaratutu, qui appelle constamment le protagoniste « maître », et qui combat maladroitement à ses côtés pour délivrer le monde d’une matriarche amazone émasculatrice ? Rien, n’en disons rien.
Il en va quasiment de même avec le mockmuster Almighty Thor (Christopher Bray ; 2011), une production The Asylum profitant de la sortie du film Marvel pour proposer un produit de seconde zone s’imaginant utiliser à bon escient l’héritage mythologique scandinave. Dans ce DTV, Thor est un jeune dieu dont le père Odin et le frère Balder sont assassinés par Loki, qui dérobe Mjölnir afin d’initier le Ragnarök. Heureusement, Thor peut compter sur ses épées et ses uzis. Notons que la chaîne SyFy a également produit un autre téléfilm à l’idiotie crasse, le très mauvais Thor: Hammer of the Gods (Todor Chapkanov ; 2009), dans lequel une bande de Vikings accompagnant un Thor des plus banal affronte des loups-garous sur une île perdue. Vikingdom : L’Éclipse de sang est un autre film récent qui met en scène certaines divinités du panthéon nordique, mais son origine un peu particulière appelle à y revenir en dernière partie.
En 1989, Terry Jones réalise Erik le Viking, un film d’aventure aux allures de Monty Python, ne sachant jamais s’il doit être complètement parodique ou prendre son récit au sérieux. Le manque de cohérence d’écriture finit par avoir raison du public, qui rejette le métrage à sa sortie, dérouté par l’approche explicitement anti-Viking et pacifiste de l’entreprise. Même si la démarche allégorique est compréhensible, la représentation des Scandinaves d’alors comme d’épaisses brutes attardées pillant, violant et trucidant exclusivement par plaisir n’aide pas vraiment à l’identification ni à l’immersion dans un film leur étant a priori consacré. L’on pourrait également se demander comment un film sur des guerriers parmi les plus célèbrement féroces de l’Europe médiévale pourrait fonctionner en partant d’un tel principe et, hormis quelques détails intéressants, le projet s’effondre effectivement sous un traitement qui manque de rigueur. Cela étant, le récit amène son protagoniste Erik (le Viking pacifiste souhaitant donc que les dieux fassent cesser les guerres) à rencontrer les divinités elles-mêmes dans un dénouement illustrant parfaitement la bipolarité du scénario. Achevant leur quête pour trouver la corne qui leur permettra de se rendre à Asgard, Erik et ses amis découvrent la cité des dieux avec émerveillement. Le bout du monde, le pont Bifrost, le Valhalla, tous sont présentés avec révérence, du moins jusqu’à ce que l’on apprenne que les dieux sont des enfants capricieux qui n’ont aucun pouvoir sur le cours des événements. Or, il s’agit d’un pléonasme cynique et inutile : si Erik avait réfléchi (et s’il avait été un véritable Viking), il aurait compris dès le début que les dieux, enfants ou non, ne peuvent rien faire pour changer le sort du monde, car le système de croyance nordique empêche précisément tout échappatoire au Ragnarök.
En dehors de ça, il faut à nouveau se tourner vers l’animation et attendre le nouveau millénaire pour rencontrer les dieux nordiques dans un contexte cinématographique acceptable, quoi que très enfantin. Avec Thor et les légendes du Valhalla (Hetjur Valhallar – Þór ; Óskar Jónasson, Toby Genkel et Gunnar Karlsson ; 2009), le studio islandais CAOZ entreprend de suivre l’exemple de Peter Madsen en concevant une aventure pour enfants qui intègre de nombreux êtres mythologiques. Dans celle-ci, un jeune homme nommé Thor, que la tradition régionale présente comme le fils d’Odin, doit sauver ses amis des griffes de la déesse Hel et de ses géants à l’aide d’un marteau magique.
L’autre facette de l’adaptation des légendes se rapporte à la mise en image des aventures des héros et des sagas nordiques, qui impliquent des êtres humains intrinsèquement liés au divin, mais toutefois clairement distincts des dieux eux-mêmes. Leur importance est potentiellement plus grande que celle des déités, car ces héros offrent un socle d’identification plus ferme à leurs publics.
« Les légendes héroïques […] permettent d’attester des plus profondes convictions morales d’un peuple, car […] si les dieux conservent une forme d’inaccessibilité, les héros s’imposeront toujours comme des idéals de vertu humaine atteignables. »
– Andrew Peter Fors, The Ethical World-Conception of the Norse People
Nombreux sont les films s’intéressant aux exploits de héros nordiques, autrefois racontés dans les légendes et sagas. Ainsi, on compte au moins cinq longs métrages réinterprétant l’épopée du héros Sigurd, relatée dans les Völsunga saga et Thidreksaga (ou de Siegfried, version continentale trouvée dans la Chanson des Nibelungen) : le diptyque fondateur de Fritz Lang, son remake La Vengeance de Siegfried (Harald Reinl ; 1966), le film d’époque italien Le chevalier blanc (Sigfrido ; Giacomo Gentilomo ; 1958), le film érotique allemand Les fantaisies amoureuses de Siegfried/Voluptés nordiques (Siegfried und das sangenhafte Liebesleben des Nibelungen ; Adrian Hoven, David Friedman ; 1971), et le téléfilm allemand L’Anneau sacré (Uli Edel ; 2004).
En vérité, le film de Gentilomo pourrait être lui aussi considéré comme un remake du Fritz Lang, tant la trame narrative s’attache à respecter cette œuvre fondatrice, au point d’en emprunter des plans entiers. Accompagné de sonorités composées en grande partie par Richard Wagner lui-même, Le chevalier blanc se positionne à l’orée de la période mythologique et des péplums en Italie. Comme ses prédécesseurs, et sous l’influence persistante de la version wagnérienne, l’intrigue s’emploie à retracer le destin unique du héros qui, hanté par ses désirs charnels, matériels et d’aventure, s’inscrit dans l’univers mythique européen. Le cinéaste italien jusqu’alors connu pour ses films de réalisme social choisit, en exorcisant sa passion pour la légende germanique, de concevoir un film appliqué, qui retient sa puissance évocatrice même si elle n’introduit pas vraiment de variation ni d’interprétation nouvelle. Le film fait quelque peu figure d’exception dans le paysage cinématographique italien, et plus particulièrement dans la branche fantastique ré-émergeant alors dans le pays. Si la période du muet avait donné lieu à deux courts inspirés des Nibelungen, la très vaste majorité des mythes portés à l’écran dans l’Italie d’avant-guerre se concentrait sur des sources littéraires étrangères, qui étaient l’occasion de bâtir des films ravivant un passé antique glorieux, flirtant même parfois avec l’exaltation d’un nationalisme repris subséquemment par le régime mussolinien. Or ici, vingt ans après la guerre et une fois la reconstruction révolue, le cinéma italien repart en quête de mythes et de légendes, produisant des dizaines de films antiques en quelques années. Mais Le chevalier blanc ne tient finalement pas de la même approche, Gentilomo évacuant toute sur-préoccupation esthétique de l’homme visuellement puissant, et opte pour un style résolument médiéval, résonnant constamment avec le romantisme allemand du début du siècle. Il abandonne donc son exploration sociale caractérisant ses premiers films pour s’aventurer dans le défi technique de la recréation des mythes. C’est aussi là que Sigfrido se révèle singulier : il n’est ni une série B fauchée, ni une superproduction, et s’impose par conséquent comme un film d’aventure résistant solidement au passage du temps, bien qu’il ne fit jamais réellement parti de son époque non plus.
La version d’Harald Reinl sortie en 1966-1967, elle aussi en deux parties, suit la même trame générale légendaire, bien qu’elle ait tendance à tourner les relations entre personnages au mélodrame. Visuellement, l’utilisation de décors naturels islandais somptueux donne une puissance encore inédite au récit, qui compense le ton globalement moins solennel de l’œuvre, qui sort dans une période où le cinéma allemand était très enclin à produire des contes de fées. Dans la sympathique version télévisuelle (en trois parties) au budget plutôt confortable L’Anneau sacré d’Uli Edel (2004), le mythe est exploré de manière plus détaillée, commençant lors de l’enfance du héros pour se terminer avec sa mort, utilisant donc la légende des Nibelungen comme prétexte à la reconstruction de Siegfried lui-même. Cette adaptation fait par ailleurs le choix d’opposer de façon évidente la tension qui existe entre le paganisme enraciné dans la culture germanique et la conquête du christianisme, en témoigne l’ultime échange de l’épilogue, prononcé alors que Siegfried et Brunnhild succombent ensemble à la mort :
« Giselher : Aujourd’hui, les anciens dieux reviennent à la vie.
Lena : Aujourd’hui, les anciens dieux disparaissent avec eux. »
Si cette production bénéficie d’une qualité globalement honnête, elle souffre d’une approche ouvertement explicite, qui l’empêche d’atteindre la richesse interprétative dont les versions de Lang et Reinl regorgeaient. En outre, certains films préfèrent aborder le mythe nibelungien de manière détournée. Par exemple, Le trésor de la forêt noire (Il tesoro della foresta pietrificata ; Emimmo Salvi ; 1965) revient sur la légende des Nibelungen sans y intégrer les héros iconiques de la saga pour se concentrer sur la quête du trésor elle-même, convoité par le maléfique Viking Hunding (un Gordon Mitchell au sommet de l’outrance), et que le jeune Sigmund – fils de Sigurd d’après la tradition nordique – se doit de protéger avec l’aide de valkyries. Tout cela étant produit en Italie pendant la mode des films d’époque, le budget limité se fait ressentir à tous les niveaux, ce qui empêche le film d’échapper à son statut de nanar difficilement trouvable. Le téléfilm allemand À la poursuite du trésor oublié (Die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen ; Ralf Huettner ; 2008) transpose la problématique de nos jours, dans un récit qui singe la mécanique d’Indiana Jones sans grand succès.
Le second héros le plus largement adapté au cinéma est sans conteste Beowulf. La légende de ce personnage provient d’un manuscrit rédigé en vieil anglais, mais conte une histoire se déroulant dans les présentes régions suédoises et danoises. L’œuvre a été liée, de façon globalement théorique, à d’anciens textes scandinaves, ces deux points expliquant ainsi son association au corpus des légendes nordiques. L’histoire, censée se dérouler au Ve siècle, prédaterait donc la civilisation viking d’au moins trois siècles, ce qui ne l’empêche jamais de figurer dans les discussions de tout acabit ayant trait aux films qui nous intéressent ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que les films s’attaquant à la légende de Beowulf contiennent des stéréotypes visuels et cinématographiques intrinsèquement liés au corpus : les costumes, les coutumes et les structures narratives héroïques sont invariablement adaptées à la période historique scandinave la plus immédiatement identifiable pour les spectateurs, à savoir l’âge des Vikings.
Si Derek Elley regrettait, dans son livre The Epic Film – Myth and History (sorti en 1984), que la légende de Beowulf n’avait donné lieu a aucune retranscription à l’écran, la situation a quelque peu changé depuis. Il avait cependant omis de revenir sur le film d’animation australien Grendel Grendel Grendel (Alexander Stitt ; 1981), une adaptation du roman de l’Américain John Gardner, qui propose d’explorer la légendaire histoire du point de vue du monstre antagoniste, Grendel. Dans le film, celui-ci est un personnage errant, ne sachant trop que penser de la finalité de son existence. Se sentant similaire aux Danois médiévaux, mais incapable de communiquer avec eux, il finit par accepter que son rôle dans l’ordre universel consiste à terroriser les humains, afin que ces derniers forment un groupe social cohérent, et surtout cultivent leur imagination pour savoir appréhender correctement la notion de mythe. Il est amusant de remarquer que la première itération de Beowulf au cinéma intervient dans un dessin animé condamné, par son style encore plus dépouillé que les œuvres de René Laloux, à sombrer dans l’oubli après quelques séances dans les salles d’art et d’essai. Et pourtant, la pertinence unique de son approche et de son questionnement du rapport mythologique qu’entretiennent les hommes avec les esprits habitant les mondes de leur imaginaire permet d’installer des bases d’une robustesse inébranlable au sein du corpus, et même de théoriser la nécessité pour ces légendes d’exister.
Plus de quinze ans plus tard, et sans qu’aucune autre adaptation n’ait vu le jour entre temps, le film Le 13e Guerrier (John McTiernan ; 1999) vient prendre le contre-pied de cette théorisation en adaptant le roman Eaters of the Dead de Michael Crichton, qui lui-même mêlait le poème de Beowulf aux supposées chroniques du voyageur arabe Ahmad ibn Fadlan. Dans cette histoire, l’ambassadeur est envoyé en Europe de l’Est où il rencontre des Vikings menés par Buliwyf (archétype beowulfien), et appelés à rejoindre leur terre natale pour la défendre des attaques de monstres nommés les Wendols (substituts de Grendel). Choisi par les runes pour les accompagner dans leur quête, il se retrouve en Scandinavie, dans une aventure mettant en perspective les croyances de chacun, et surtout le rapport de l’homme aux zones d’ombre de son imaginaire et de ses peurs. Tendant de ce fait à retirer leur caractère surnaturel aux éléments diégétiques en vue de ramener les figures du passé à la portée du spectateur contemporain, Le 13e Guerrier parvient à engager une discussion avec son unique prédécesseur, proposant une autre vision, plus déconstructiviste, du rôle des légendes.
La même année, Christophe Lambert se retrouve à l’affiche d’un film simplement intitulé Beowulf (Graham Baker ; 1999), qui tente de transposer la structure du poème dans un futur post-apocalyptique féodal aux sonorités techno. Bien que le film en lui-même soit un échec à bien des niveaux, il convient de remarquer qu’il s’agit du premier à oser injecter des éléments futuristes à un univers visuel médiéval, ce qui se révèle malheureusement contre-productif. On remarque qu’ici, le peuple et les terres hantées par la présence de Grendel et de sa mère démoniaque sont rendus anonymes, interchangeables. En cela, ce Beowulf peut être vu comme une pure expression de l’idée confuse que la conscience populaire se fait du Moyen Âge : une période indéterminée, vague et malléable, qui sert de purgatoire aux histoires indécises, composées d’un amalgame d’éléments disparates. En ce sens, sa transposition temporelle (et, implicitement, de genre) fait que le film de Graham Baker n’a rien à offrir au corpus des Vikings, mais il demeure une curiosité amusante pour les amateurs de cinéma bis.
Si l’on écarte No Such Thing (2001), un petit film indépendant d’Hal Hartley qui adapte très librement la légende au monde contemporain, il faut se tourner vers la petite ébullition qui a frappé le corpus beowulfien dans la seconde partie des années 2000, avec tout d’abord Beowulf, la légende viking (Sturla Gunnarsson ; 2005), une production provenant du Canada, du Royaume-Uni et de l’Islande. Celle-ci reprend assez fidèlement la structure du poème en adoptant toutefois une approche âpre, insistant sur la violence infligée aux personnages (et sur la torture linguistique imposée par un scénario qui tente de rendre modernes des dialogues mal adaptés au récit). Dans ce dernier, Beowulf, ici campé par Gerard Butler, se rend donc au Danemark du VIe siècle pour aider les autochtones à se libérer de Grendel. Bien qu’introduisant des différences mineures avec son matériau d’origine (une « sorcière » est impliquée, Grendel venge ici la mort de son père assassiné par cupidité), Gunnarsson parvient à proposer une translittération fidèle de la légende, et surtout une représentation assez fascinante de la transition du paganisme vers le culte chrétien, motivé par le désespoir dû à un présent invivable et par les promesses d’un avenir plus paisible. Mettant grandement à profit ses paysages islandais naturels époustouflants, le film se révèle alors globalement être une réussite en termes d’adaptation stricte du texte d’antan. Cependant, son meilleur argument tient sans doute du fait qu’il reprend également le caractère empathique du monstre tel que dépeint dans Grendel Grendel Grendel, afin de brouiller les lignes de démarcation entre les concepts de bien et de mal, pour finalement observer que l’altérité mène, inéluctablement, à accrocher le bras déchiqueté de son ennemi à son tableau de chasse.
À peine deux ans plus tard sort le film en performance capture La légende de Beowulf (Robert Zemeckis ; 2007), qui en constitue sans doute la version cinématographique la plus puissante et iconique à ce jour. Libéré des contraintes d’un tournage traditionnel, le réalisateur parvient ici à invoquer des images mythologiques écrasantes, octroyant enfin à l’œuvre toute la portée qu’elle a depuis toujours cultivée. Surtout, le script de Gaiman et Avery réorganise les éléments légendaires du récit à travers un syncrétisme et une exploration inégalés, offrant à la fois un reflet opposé au long métrage de McTiernan et une mise en œuvre de la théorisation proposée par celui de Stitt. Ainsi, Beowulf est ici un guerrier renommé qui comprend le pouvoir des histoires, soucieux de construire sa propre légende à travers le monde, et se pavanant à plusieurs reprises de hauts faits héroïques, du moins jusqu’à ce que son ambition même se fasse l’instrument de sa défaite face à la mère de Grendel. Alors, son rapport au mythe est à jamais changé, et le glissement de l’âge des héros nordiques vers celui des martyrs chrétiens accompagne l’évanouissement de la portée des fables. Souhaitant finalement rétablir la vérité pour expier ses pêchés, Beowulf tente de se confier à son meilleur ami et demande à son épouse d’honorer la mémoire de l’homme plutôt que du héros. Pourtant, rien n’y fait. La mémoire s’inscrivant à jamais dans l’histoire est celle du héros ; une histoire condamnée à se répéter tant que les hommes vivront, tant qu’ils auront besoin de récits pour guider leurs pas et trouver un sens à leurs actions, qu’importe la vérité. L’analyse du mythe proposée par Zemeckis est, en cela, parfaitement raccord avec ceux gouvernant les Vikings d’antan, qui considéraient que l’univers fonctionnait sur un modèle cyclique soumis à des forces surhumaines, guidant leurs pas vers l’inéluctable (et glorieux) combat final.
Une petite production indépendante et sans budget, Beowulf, Prince of the Geats (Scott Wegener ; 2007), sort la même année et s’essaie au révisionnisme incompréhensible en faisant du héros un prince africain. L’absence de toute qualité cinématographique condamnant de toute manière le film aux oubliettes (perruques en plastique, épées en bois, tournage dans la cabane au fond du jardin), mieux vaut se tourner vers une autre relecture autrement plus intéressante, à savoir l’hybride médiévo-science-fictionnel Outlander (Howard McCain ; 2008). Le film, également indépendant, parvient à réunir un budget assez confortable pour créer une atmosphère retranscrivant plutôt bien l’époque médiévale en Scandinavie. McCain propose ainsi de réinterpréter la légende de Beowulf sous le prisme de la SF en faisant de Grendel une créature extra-terrestre cauchemardesque, et du protagoniste son chasseur humanoïde (interprété par un Jim Caveziel aussi stoïque qu’à son habitude). Il est plus tard révélé que le Moorwen est le dernier survivant d’une espèce annihilée par la politique colonisatrice de la civilisation dont vient Kainan, le protagoniste. Surtout, et si les éléments science-fictionnels demeurent globalement superficiels, le film se sert de la structure du mythe pour suggérer de voir en la figure du Grendel la manifestation de nos échecs passés. L’affrontement qui s’en suit devient, ainsi, l’expression des tourments intérieurs du héros vis-à-vis de l’altérité (qu’il s’agisse de la sienne sur Terre, ou de celle de sa némesis). En mêlant le récit beowulfien à ce poncif de la SF, le réalisateur parvient à mettre en scène la lutte que mène le héros contre les conséquences d’une colonisation irraisonnée, tout en faisant de lui un être capable d’embrasser entièrement la culture viking qu’il adopte et qui l’accueille, comme s’il en avait toujours fait partie.
En dehors des grands héros de la littérature nordique, d’autres textes ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques, et notamment dans les pays scandinaves. Bien que n’appartenant pas réellement au corpus, il est intéressant de relever l’existence du film Sampo (Aleksandr Ptushko ; 1959), une production fino-soviétique basée sur le texte mythologique fondateur du Kalevala. Articulée autour de la convoitise du Sampo (un artefact magique synonyme d’abondance), l’intrigue révèle des différences assez importantes avec celles usuellement mises en scène dans les pays voisins, notamment en raison de l’absence globale de violence, et le recours aux arts contre les forces du mal (la musique jouée par les humains permet ici d’endormir l’armée de trolls, évitant de ce fait toute effusion de sang). Avec ce film, la Finlande place ses enjeux ailleurs que le reste des pays nordiques, et en particulier sur le désir de simplification d’une vie faite d’épreuves face à une nature contraignante. Il ne s’agit pas de l’unique tentative finlandaise d’adapter ce texte national, en témoigne par exemple le récent hybride wuxia/kalevala Le guerrier de jade (Jadesoturi ; Antti-Jussi Annila ; 2006), qui tente de positionner l’héritage finlandais dans un contexte historiographique plus large.
De retour en terres vikings, l’incontournable La Mante rouge (Den røde kappe ; Gabriel Axel ; 1967), une production suédo-dano-islandaise adapte l’histoire d’Hagbard et Signe tirée de la Geste des Danois. Dans ce film, se déroulant dans l’Islande du XIIe siècle, trois frères guerriers tentent de venger la mort de leur père en s’en prenant au clan responsable de sa disparition. Ne parvenant pas à se départager, les deux familles adoptent une trêve, brisée lorsque l’un des frères tombe réciproquement amoureux de la fille du roi adverse. Suivant fidèlement la trame de la tragédie légendaire, le réalisateur ne crée rien de moins qu’une branche nouvelle du corpus. C’est le début de la phase « brute » des films de Vikings, imaginés par les artistes des pays nordiques eux-mêmes, souhaitant s’éloigner du romantisme hollywoodien à la Fleischer ou des péripéties colorées de l’industrie italienne. En alliant authenticité des paysages islandais, brutalité âpre des combats réalistes (dénués de chorégraphies excessives au profit d’une immédiateté un peu maladroite mais bien plus crédible), structure mythologique minimaliste et économie de dialogues (après tout, ne lit-on pas dans l’Hávamál qu’il est préférable de « parler de manière sensée ou de rester coi »?), Gabriel Axel se réapproprie l’héritage viking pour enfin l’intégrer à l’identité cinématographique scandinave. En résulte un film épuré, à la fois grandiose et intimiste ; une fabuleuse expression de l’identité des sagas nordiques au cinéma. En outre, le tournage du film est l’occasion pour le jeune Islandais Hrafn Gunnlaugsson, alors âgé de 18 ans, de travailler au département des effets spéciaux. L’influence que cette expérience aura sur son œuvre à venir se révélera immense par la suite.
Les Islandais continuent ensuite d’explorer leur riche culture littéraire avec Outlaw (Útlaginn ; Ágúst Guðmundsson ; 1981), adaptation de la saga de Gísli Súrsson, dans laquelle le protagoniste est obligé, sur l’honneur, de tuer son beau frère en représailles d’un meurtre, suite à quoi il devient lui aussi un hors-la-loi. Si le film se révèle moins mémorable que La Mante rouge, Guðmundsson a le mérite de proposer une représentation assez intéressante de la vie des Islandais du Xe siècle, de leurs rituels païens à leurs sports et à leur organisation sociale, en passant par les difficultés découlant du climat. L’intrigue, entièrement centrée sur le thème de la vengeance et du cercle vicieux qu’elle entraîne, est accompagnée d’un style de mise en scène légèrement moins statique, mais également moins iconique, que celle d’Axel. Le même Ágúst Guðmundsson pilotera en 1990 une mini-série télévisée en quatre épisodes intitulée Sea Dragon, une autre histoire de vengeance. Dans l’intervalle, en Norvège, la comédie Prima Vega’s Saga of the Viking Saint Olaf (Prima Vegas Saga om Olav den Hellige ; Herodes Falsk ; 1983) adopte un ton irrévérencieux pour aborder la conversion forcée des sujets du roi Saint Olaf Haraldsson au début du XIe siècle.
De retour en Islande, l’une des œuvres les plus fondamentales du corpus, et essentielle à l’histoire cinématographique du pays, émerge avec la trilogie de Hrafn Gunnlaugsson, devenu réalisateur : When the Raven Flies (Hrafninn flýgur ; 1985), In the Shadow of the Raven (Í skugga hrafnsins ; 1988) et The White Viking (Hvíti víkingurinn ; 1991). Le premier est une adaptation de la saga d’Egill, le deuxième une réinterprétation de Tristan et Iseut, et le troisième une extrapolation de la saga de Njáll le Brûlé. Tous forment un ensemble thématique cohérent visant à élever le cinéma islandais au premier rang mondial. Pour ce faire, Gunnlaugsson adopte un style et une caractérisation de ses personnages proche de ceux observés chez Kurosawa ou Leone : protagoniste dissimulant ses émotions, notions de bien et de mal entremêlées, matérialisme rampant, héroïsme sanglant, et surtout motivations affiliées à la vengeance. Dans la plupart des cas, le protagoniste est un solitaire qui s’oppose à l’ordre établi et à la société, et faisant preuve d’une indifférence totale envers tout autre enjeu qui ne serait pas personnel. En effet, même quand le récit s’ouvre vers des problématiques plus larges (la christianisation de l’île dans In the Shadow of the Raven), les événements imposés au protagoniste ramènent inévitablement l’intrigue dans les gonds de ses tourments personnels. Le film, mettant en scène le retour au pays d’un Islandais prosélyte récemment converti au christianisme, oppose à son personnage principal une résistance farouche des païens, qui brûlent son foyer et assassinent sa famille. La douleur, qui donne naissance au besoin incontournable de vengeance, fait alors replonger temporairement l’homme dans l’invocation d’Odin et des autres dieux, car ces derniers lui accordent sans concession son droit de représailles, contrairement au Christ. L’on aura rarement fait meilleur exemple de la flexibilité intellectuelle dont font preuve les hommes lorsque les circonstances l’imposent. Dans The White Viking, où la question de la conversion prend une ampleur plus importante, l’intrigue s’ouvre sur une cérémonie de mariage païenne dédiée à la déesse Freya. Les festivités sont plus tard interrompues lorsque des missionnaires chrétiens attaquent le temple et le détruisent, tuant la majorité de ses occupants sur leur passage. Revenant sur la tentative de conversion forcée de l’île par le monarque norvégien Olaf Tryggvason, le film adopte une position résolument antichrétienne, associant le système de croyances polythéiste à une célébration de la vie, et l’adoption du monothéisme à une forme d’idolâtrie de la mort. Quoi que moins iconique car trop soucieux de construire une réflexion civilisationnelle, ce dernier volet offre une conclusion pertinente à la trilogie, et souligne l’impuissance téléologique de la conversion forcée d’un peuple.
Comme les westerns de Leone, les sagas de Gunnlaugsson ont un air de naturalisme étouffant : elles se déroulent aux frontières de la civilisation, sur une île isolée à la nature peu accueillante. En proie à l’influence de la société établie (la Norvège), les héros de ces films de Vikings islandais n’ont que faire des raids et des pillages. Pour eux, c’est la survie de leur personne, de leur honneur et de leur culture qui envahit le spectre des considérations thématiques. Derrière eux, les paysages sont à la fois âpres et renversants. Ils imposent leurs contraintes aux hommes sans restreindre leurs horizons et, à travers eux, ceux-là doivent se battre pour imposer leur singularité et renaître plus forts, quitte à y laisser leur vie.
Le réalisateur de La Mante rouge rempile ensuite avec Le Prince de Jutland (Gabriel Axel ; 1994), une adaptation de la légende d’Amled, prince dont les faits sont rapportés dans la Geste des Danois, et qui servira d’inspiration à William Shakespeare pour Hamlet. Fort d’un casting international et d’un matériaux de base encore peu exploré, Axel entreprend de replacer l’intrigue dans son contexte historique en invitant le spectateur à dresser des parallèles entre le récit d’origine et sa version anglaise, dans le but avoué de promouvoir un héritage culturel danois trop méconnu, et de l’en distinguer de sa version la plus populaire en revenant vers une épure structurelle plus fondamentale. Toujours au Danemark, le film en stop-motion Balladen om Holger Danske (Laila Hodell ; 1996), dont le titre se traduit littéralement par « La ballade d’Ogier le Danois », continue d’exploiter le folklore du pays avec une figure particulièrement iconique, qui en a autrefois symbolisé la force et la fierté nationale, bien que sa toute première mention littéraire ait lieu dans la Chanson de Roland. Le film reprend les grandes lignes de la légende sur le modèle de la fable, imaginant les origines païennes d’Ogier, pour ensuite se concentrer sur ses années formatrices, puis sa capture par Charlemagne, et leur opposition qui se transformera en alliance.
Le film indépendant au budget très resserré A Viking Saga – Son of Thor (Michael Mouyal ; 2008) est le premier à adapter une section de la Chronique des temps passés, un texte fondateur de l’histoire russe relatant des faits s’étant déroulés entre le IXe et le XIIe siècle, à une époque dominée par la dynastie des Riourikides, descendants des Varègues. Ce métrage ayant bien peu d’arguments en sa faveur (allant jusqu’à proposer une scène de danse du ventre chez les Vikings, c’est dire le niveau d’application…), on imagine sans mal que la superproduction russe d’Andrei Kravchuk à venir en proposera une adaptation autrement plus excitante.
Bien qu’appartenant au monde télévisuel, la série irlando-canadienne Vikings créée en 2013 par Michael Hirst mérite ici mention en raison de ses qualités techniques et de sa popularité. Librement inspirée de la saga contant la vie du chef viking Ragnar Lodbrok, la série réarrange les éléments légendaires des histoires afin d’en proposer une version synthétique, conservant les idiosyncrasies vikings ancrées dans la culture populaire, ainsi que leur portée mythique. Par exemple, la saison 1 attribue la découverte de Northumbria et l’anecdote du Préfet de Dorchester, qui confond les envahisseurs pour des marchands, à Ragnar, soit quelques décennies trop tard dans les faits. De même, la stratégie qu’adopte Ragnar pour s’infiltrer dans Paris à la fin de la saison 3 fut en réalité utilisée par son fils Björn lors du siège de Rome.
Comme stipulé précédemment, ce manque de fidélité historique (ou de fidélité aux sagas) n’a aucune importance dans le cadre de la diégèse qu’essaie de construire la série, car elle permet avant tout d’héroïser le protagoniste pour raviver sa légende dans la conscience populaire. Il ne s’agit donc de rien d’autre qu’une continuation de la tradition orale perpétuée des siècles durant par les différents acteurs de la civilisation viking, chacun ayant été susceptible de développer, modifier et faire évoluer ces légendes.
L’Histoire anti-évhémériste : des faits aux idées
L’évhémérisme est une théorie selon laquelle les dieux et héros appartenant au folklore d’une culture donnée auraient réellement existé, leurs faits d’armes ayant été soumis à un processus d’embellissement et de simplification (en d’autres termes, de mythologisation) après leur disparition. Or, la culture populaire, et tout particulièrement le cinéma, a tendance à adopter ledit processus lorsque l’histoire devient le sujet de fictions qui, répétées avec assez de force et d’insistance, imposent de nouvelles représentations du passé dans la conscience collective, donnant par là même naissance à une histoire fictionnalisée, une histoire mythologique moins factuelle ou véridique, mais plus représentative au niveau culturel. Il apparaît même que L’Edda en prose de Snorri Sturluson se caractérisait par ce mouvement descendant du mythe vers l’histoire, motivé par la reconfiguration du passé au service de l’histoire chrétienne :
« Son approche chrétienne et européenne constitue l’un des aspects marquants de l’œuvre de Snorri. Il ambitionne en quelques sortes de rendre son passé culturel d’origine appréhensible pour son présent chrétien en manœuvrant son rapport à l’histoire européenne et universelle. […] Encadré par une forme d’évhémérisme ambigu, le mouvement observé part de récits cosmogoniques et eschatologiques s’inscrivant dans le mythe, pour descendre ensuite vers des contes héroïque, puis vers l’histoire. »
– Joseph Harris, Speak Useful Words or Say Nothing: Old Norse Studies (Islandica)
Ainsi, la réappropriation par le cinéma d’événements autrefois folkloriques et ayant été déconstruits par les historiens, puis leur retransformation en récits iconiques, a un effet contraire à l’évhémérisme, les faisant repasser dans le domaine de la fable, de la légende culturelle symbolique. La fascination que la civilisation viking exerce sur un certain public moderne peut en partie s’expliquer par ses singularités, et son opposition éthique au monde chrétien qui a fini par prévaloir. Plus spécifiquement, le rapport à la mort des Vikings se définissait en opposition aux valeurs monothéistes, car tout guerrier mort au combat était promis à rejoindre Odin, dieu des dieux, au Valhalla, ce qui constituait la plus grande distinction pour un guerrier. Se replonger dans cette époque révolue à travers l’outil cinématographique permet finalement d’effleurer la résurrection de cette idée censée avoir été étouffée par le système christique, et donc de stimuler, une nouvelle fois, l’imagination à travers notre rapport au mythe des promesses d’un au-delà différent, plus glorieux, plus instinctif et plus primal.
Aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, le premier long-métrage explicitement viking produit aux États-Unis et faisant suite tardive au pionnier The Viking (Roy William Neill ; 1928) est une réalisation de Roger Corman ! Alors que l’homme est connu pour suivre les tendances et inonder le marché de séries B afin de profiter des modes, Corman se révèle ici clairvoyant et devance ses concurrents (même les Italiens, c’est dire) en sortant le film d’exploitation The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent en 1957. Dans celui-ci, les femmes vikings ne voyant pas leurs hommes revenir de la chasse décident de partir à leur recherche. Leur bateau échoue sur les rives d’un royaume ennemi, dirigé par un roi mégalomaniaque qui retient les hommes vikings prisonniers. Une fois libérés, ces derniers rentrent au pays avec leurs femmes, non sans rencontrer le fameux serpent des mers sur leur passage. Outre la production value abyssale, les interprétations involontairement comiques et les plages californiennes utilisées comme de supposés fjords, le film de Corman a sans doute le mérite de réintroduire l’idée des Vikings dans la culture cinématographique après plusieurs décennies, bien qu’il ne s’intéresse pas vraiment au folklore scandinave. Le film constitue surtout une occasion de faire parader des femmes guerrières peu vêtues devant la caméra (parfois avec des lunettes de soleil, pourquoi pas) dans le style des « films d’Amazones » alors très répandus. Il s’agit aussi d’une des rares instances du corpus à faire des femmes les têtes d’affiche (ici en inversant le poncif de la demoiselle en détresse), ce qui peut participer à l’idée reçue selon laquelle les femmes profitaient de privilèges équivalents aux hommes en Scandinavie médiévale. Or, si cette société était effectivement plus progressiste que d’autres sur certains points (droit de divorce sous certaines conditions, droit de prendre part au combat), la société viking demeurait fondamentalement patriarcale. Cela étant, la mise en avant des femmes chez Corman ne représente qu’un écran de fumée, car aucun personnage du film n’envisage qu’une société matriarcale puisse subsister, ni même exister.
La seconde très grande production après celle de Fritz Lang arrive sur les écrans l’année suivante avec Les Vikings (Richard Fleischer ; 1958), blockbuster américain porté par Tony Curtis et Kirk Douglas. Incarnation parfaite du mouvement ascendant du conte vers la légende s’inscrivant dans la conscience populaire, le film profite de décors et de costumes grandioses. Si l’histoire allie tous les ingrédients qui caractérisent les films de Vikings (rivalité fraternelle, vengeance, opposition des fois, expansionnisme, lutte sociale), elle y ajoute surtout une importante dose de romanesque, qui introduit les Vikings à un univers romantique et fantasmé, structurellement très proche des récits héroïques hollywoodiens archétypaux. Ainsi, la férocité des Vikings, découlant de leur adoration à Odin et à la guerre, constitue l’objet d’examen principal de la première partie du film, avant de basculer vers le triangle amoureux Einar-Erik-Morgana. Fleischer parvient ainsi à parader tous les aspects de la société scandinave, des lancers de haches festifs aux funérailles embrasées, sans pour autant les critiquer ni les cautionner. Le film constitue également une occasion pour le cinéaste d’aborder le rapport des Vikings avec la nature et la terre, car leur société est dépeinte comme ayant conquis l’ensemble de leur territoires, des montagnes à la mer. En découle alors leur désir de se rendre en Angleterre pour conquérir d’autres terres, ce qui témoigne d’un expansionnisme motivé uniquement par une sorte de nécessité existentialiste à laquelle ils ne peuvent pas résister : pour poursuivre leur(s) histoire(s), les Vikings doivent se tourner vers l’horizon. On touche alors d’une certaine manière à un déterminisme fictionnel influencé par l’histoire elle-même, et qui nourrit à son tour l’histoire inconsciemment comprise au niveau culturel. Pour citer Joseph Harris une nouvelle fois :
« Les auteurs [de sagas] voyant leurs propres horizons s’amenuiser lors des XIIIe et XIVe siècles, ils se sont évidemment intéressés à l’expansion qu’a connu le monde de leurs ancêtres, à l’époque des Vikings. Ainsi, la portée géographique des sagas peut en quelques sortes être interprétée comme la transformation de leur portée historique. »
Quelques années plus tard, le Royaume-Uni et la Yougoslavie coproduisent Les Drakkars (The Long Ships ; Jack Cardiff ; 1964), une adaptation très libre d’un roman d’aventure suédois populaire. Dans cette histoire, un groupe de Vikings renégats et un prince maure s’engagent dans une course au trésor pour retrouver un artefact d’une valeur inestimable. Bien que le métrage soit globalement considéré comme un échec (un film de cape et d’épée manqué), il parvient à retenir en filigrane quelques problématiques abordées par le livre d’origine, notamment en termes d’opposition des cultures. Ainsi, les affrontements continus entre les Danois et les Maures s’apparentent bien vite à une mise en parallèle des systèmes culturels, avec les Occidentaux d’un côté et les Orientaux de l’autre. Le film reste toutefois ambigu dès qu’il s’agit de déterminer quelle culture représente l’idée de civilisation, et quelle culture s’apparente au barbarisme. Ainsi, comme l’explique Donald L. Hoffman dans le recueil The Vikings on Film: Essays on Depictions of the Nordic Middle Ages : « Dès lors que l’on réalise que le barbarisme et la civilisation s’appuient de manière égale sur des fondements de cruauté, ce n’est plus vers des valeurs mais vers l’empathie qu’il convient de se tourner ; et pour accepter une culture, il ne s’agit plus de déterminer laquelle est la meilleure, seulement de savoir à laquelle on appartient. » Le film se conclut bien logiquement comme il s’ouvre : le regard fixé sur les aventures à venir. Produit pour profiter du succès du blockbuster de Fleischer (sur lequel Cardiff était directeur de la photographie), Les Drakkars se veut tout aussi romanesque, mais échoue malheureusement à insuffler un véritable souffle au récit. Il n’en reste pas moins important en cela qu’il perpétue les légendes d’exploration de la société viking, les faisant voyager par-delà les mers pour découvrir les plus grands trésors de l’humanité.
Bien qu’il ne concerne pas directement les Vikings, leurs descendants normands du XIe siècle jouent un rôle important dans Le Seigneur de la guerre (Franklin J. Schaffner ; 1965), un film reconnu comme étant l’une des représentations les plus fidèles du Moyen Âge, éloignée des embellissements hollywoodiens habituels. Ce long-métrage met en scène la défense d’un fief face aux invasions frisonnes, et s’évertue à aborder de nombreux aspects d’une époque extrêmement dangereuse et difficile. Le film prend la liberté de faire de la population normande un groupe païen, bien que la région ait été christianisée plusieurs siècles auparavant, peut-être pour mieux marquer la différenciation hiérarchique sur laquelle est bâtie la société représentée. De même, la production Hammer intitulée La Reine des Vikings (Don Chaffey ; 1967) n’a de viking que le nom, l’histoire se déroulant dans une Grande-Bretagne sous occupation romaine, bien avant que les Scandinaves ne descendent sur l’Europe.
Une œuvre plutôt ambitieuse mais désormais tombée dans l’oubli est Alfred le Grand, vainqueur des Vikings (Clive Donner ; 1969), une production britannique revenant sur un épisode de la vie du roi de Wessex ayant résisté à la grande armée païenne et stabilisé les différents royaumes saxons à la fin du IXe siècle. La volonté du réalisateur de créer un parallèle entre Alfred et la jeunesse des années 1960 donne lieu à certaines incohérences historiques (le roi est grandement déchiré entre un supposé désir de rejoindre le clergé et ses obligations politiques, faisant ainsi écho aux jeunes révolutionnaires prônant la paix par la force), et l’ennemi danois est généralement vu comme un antagoniste barbare uniforme stéréotypé (violant des nonnes avant de dérober leur or avec délectation), bien que la société viking de l’époque n’ait rien eu à envier aux Saxons sur le plan du développement politique. L’armée danoise est menée par Guthrum, un imposant et séduisant meneur d’hommes, dont la personnalité audacieuse (résultat de sa culture païenne libertaire) est en fort contraste avec celle d’Alfred le chrétien, qui rumine constamment sur son sort et n’agit que lorsqu’il est enfin poussé jusque dans ses retranchements. Le film présente tout de même plusieurs scènes marquantes, et notamment des plans aériens de batailles donnant la vedette aux stratégies militaires.
Le prochain essai d’aventure anti-évhémériste émergeant de la production anglophone intervient lorsque Michael Chapman, directeur de la photographie sur des films tels que Taxi Driver ou Raging Bull, entreprend de confectionner un récit médiéval s’inspirant du cadre et du ton des sagas. Malgré son budget limité et ses performances parfois discutables, The Viking Sagas (1995) est une œuvre qui renoue, au crépuscule du XXe siècle, avec la tradition de la littérature islandaise, sans toutefois essayer d’adapter un texte en particulier. Dans cette histoire, le jeune Islandais Kjartan demande à un viking expérimenté de lui apprendre à combattre, afin de défendre son honneur et celui de sa famille. Tourné en Islande avec de nombreux acteurs scandinaves, le film offre une représentation captivante de l’âge viking et choisit de se concentrer sur la mise en avant de valeurs spécifiques, qui auraient régi la société d’antan. Victime de ses qualités variables (photographie et décors à couper le souffle, opposés à une narration très inégale), l’œuvre ne parvient malheureusement pas à marquer le genre, bien qu’elle fasse le lien entre la dureté et la simplicité des films scandinaves d’Axel et Gunnlaugsson (âpreté de l’ambiance, naturalisme, brutalité des combats), et son pendant américain plus ampoulé.
Presque dix ans plus tard, la production sud-africaine dirigée par le cinéaste Paul Matthews (habitué des actualisations bon marché) s’essaie à la fresque mythologique avec un film sous-budgété, mais qui fait indéniablement preuve d’une certaine compréhension de la porté des légendes et des possibilités de leur application hybride à un engouement renouvelé dans les anciens mythes à travers le néo-paganisme et l’intérêt grandissant de la culture populaire pour le fantastique. Berserkers – Les guerriers d’Odin (2005) conte l’histoire de deux frères vikings obsédés par une légende impliquant une valkyrie damnée par Odin, et ne pouvant être sauvée que par un homme au cœur pur. Lorsque l’un d’eux succombe aux flammes divines, son frère supplie la valkyrie-vampire de lui sauver la vie, quitte à le transformer en berserker cannibale. Si le métrage se perd quelque peu en tentatives d’hybridation des genres, souffre de production values parfois faibles, et commet de trop grosses erreurs à force de compromis (le combat final dans une décharge publique du monde présent suffit presque à faire s’effondrer tout le film), il demeure tout de même une volonté de perpétuer la pertinence des légendes nordiques à travers un produit culturel sans inhibition conceptuelle.

La même année, Le sang des Vikings (Blood of Beasts ; David Lister ; 2005) tente sans grand succès de transposer la fable de la belle et la bête à la période viking, mais l’amateurisme général de l’entreprise la fait immédiatement sombrer dans l’oubli. Les guerriers nordiques font une apparition notable dans le film d’animation irlandais Brendan et le secret de Kells (Tomm Moore, Nora Twomey ; 2009) qui, en raison du point de vue d’un jeune garçon celte, apparaissent presque comme des formes abstraites menaçantes. Surtout, ils appartiennent à un monde en transition, où les passages entre les réalités sont minces, facilement traversables. Le chaos dans lequel l’Irlande est plongée donne à voir la lutte entre les êtres pré-chrétiens mystiques, tels que la divinité celte Crom Cruach ou les Vikings, et une forme de christianisme englobant certains aspects païens, comme la fée Aisling, annonciatrice d’une résistance du folklore traditionnel dans la conscience populaire irlandaise.
Enfin, trois productions britanniques viennent conclure le tour d’horizon des films de Vikings anglophones. Hammer of the Gods (Farren Blackburn ; 2013) plonge les Vikings en territoire saxon, qu’ils doivent traverser pour retrouver leur frère exilé et prétendant au trône. Le film, relativement efficace, mêle brutalité et révérence en sa mythologie pour faire du protagoniste le héros soumis à un parcours transformatif, qui doit à la fois faire face aux ennemis étrangers et aux démons intérieurs qui menacent de détruire son clan. Le beaucoup moins convaincant A Viking Saga: The Darkest Day (Chris Crow ; 2013), renommé Drakkar en français, adopte un décor similaire mais inverse son point de vue, faisant des moines chrétiens les héros d’une quête constamment mise en péril par l’envahisseur nordique. Viking – L’âme des guerriers (Viking: The Berserkers ; Antony Smith ; 2014), quant à lui, se résume à une course poursuite en forêt entre des Vikings grossièrement stéréotypés et des esclaves saxons offerts en sacrifice rituel. Ces trois films font état, à des degrés divers, de la fascination pour l’image excessivement violente des Vikings, qui semble avoir récemment pris d’assaut une certaine frange du public pop culturel.
Impossible de prétendre à une exploration digne de ce nom sans repasser par le cinéma italien, qui s’offre dans les années 1960 quelques aventures de Vikings indépendantes des adaptations de sagas. Précisons immédiatement que le métrage espagnol El príncipe encadenado (Luis Lucia ; 1960), retitré King of the Vikings aux États-unis, est une adaptation de la pièce de théâtre La vie est un songe, qui se déroule dans une Pologne médiévale fictive. Le film est désormais très difficile à trouver, et bien qu’il soit parfois cité comme faisant partie du corpus viking, il est présentement impossible de corroborer cette hypothèse (quoique le titre américain et l’affiche du film puissent effectivement concorder). Il convient donc de se tourner ensuite vers Le dernier des Vikings (L’Ultimo dei Vichinghi ; Giacomo Gentilomo ; 1961) qui, malgré le talent de son réalisateur (et l’intervention non créditée de Mario Bava), se révèle être un produit de seconde zone plutôt médiocre, ayant très mal vieilli et souffrant d’une intrigue linéaire peu engageante. Celle-ci met en scène deux frères vikings revenant chez eux après dix ans passés à voyager, et qui découvrent que le trône de leur père a été usurpé. S’en suit une reconquête de leurs terres, alors sous le contrôle d’envahisseurs désireux de les faire disparaître à jamais. Le film tente, dès son titre, d’insuffler un mouvement nationaliste eschatologique à son récit, mais les qualités techniques et le budget sont tout simplement insuffisants pour y parvenir.
S’en suit, toujours de la main de Mario Bava (et cette fois de manière bien plus convaincante), le remake italien du film étalon de Richard Fleischer. La ruée des Vikings (Gli invasori ; 1961), souvent considéré comme le film de viking italien le plus abouti, respecte la structure de son modèle en faisant s’opposer deux frères séparés dans leur prime jeunesse, l’un grandissant en Scandinavie, l’autre en Angleterre. Bénéficiant de décors, de costumes et d’une photographie sans pareilles en Italie, le film s’impose très clairement comme un incontournable assez unique dans la carrière du cinéaste, qui se surpasse pour créer une aventure palpitante et haute en couleurs. Quoique loin du ton baroque habituellement employé par Bava, La ruée des Vikings contient son lot de scènes marquantes, de la grande bataille d’ouverture à l’affrontement naval, en passant par une danse ritualiste fantasmagorique. On remarque surtout que le même attrait à la culture scandinave médiévale habite le film, comme c’était le cas dans le blockbuster américain dont il s’inspire et, en dépit de toutes les imprécisions historiques parcourant l’œuvre, participe puissamment à l’identité des Vikings dans la conscience populaire.
La même année, Les Tartares (I tartari ; Richard Thorpe, Ferdinando Baldi) tente de prétendre au titre de grande fresque épique et de choc des civilisations. Lorsque le prince viking Oleg refuse d’aider les Tartares à éliminer des tribus slaves et tue leur chef, le frère de ce dernier (Orson Welles dans un rôle improbable) fait serment de laver cet affront par le sang. Les intrigues amoureuses et les promesses sur l’honneur font patienter (entre autres plans interminables sur des chevaux au galop ou un banquet dansant libidineux quelque peu gratuit) jusqu’à l’affrontement final, qui lui-même ne reste pas dans les annales. Principalement critiqué pour son interprète principal, Victor Mature, considéré comme trop peu semblable aux Vikings d’antan et trop peu habile en tant qu’acteur, le film ne marque pas les esprits et se contente de proposer une représentation inhabitée des guerriers nordiques.
La production Les Vikings attaquent (I normanni ; Giuseppe Vari ; 1962) réutilise des séquences tournées par Mario Bava à l’occasion de La ruée des Vikings, en transposant cependant l’intrigue quelques siècles plus tard, après le retrait des pilleurs scandinaves de l’Europe occidentale. À ce titre, le film ne traite pas stricto sensu des Vikings, mais il en a toutes les caractéristiques structurelles et esthétiques. Bava, enfin, conclut le cycle italien avec Duel au couteau (I coltelli del vendicatore ; 1966), un film tourné en six jours pour sauver du naufrage des producteurs désespérés, et apposant la grille viking sur une histoire reprenant l’essentiel du western américain L’homme des vallées perdues. Si le métrage ne participe donc que très superficiellement à l’étendue du corpus, abandonnant tout souci de représentation pour se concentrer sur son histoire de vengeance archétypale à la frontière de la civilisation, il prouve une fois de plus l’adaptabilité des poncifs concernés à une certaine forme d’hybridité.
Les autres nations d’Europe, et plus particulièrement la Scandinavie, ne sont bien entendu pas en reste lorsqu’il s’agit d’imaginer de nouvelles aventures dans la tradition viking. C’est par exemple ce que fait la coproduction suédo-dano-yougoslave Här kommer bärsärkarna (Arne Mattsson ; 1965), un film au faible budget n’ayant visiblement jamais été montré ailleurs que dans les trois pays en question. Dans cette amusante série B, un roi scandinave devant de nombreuses dettes à un voisin vend ses deux brutes de fils complètement idiots à un émissaire byzantin à la recherche de gladiateurs. Le plan capote évidemment en raison de la stupidité crasse des deux individus, qui parviennent tout de même à rentrer au pays avec l’une des maîtresses de l’empereur romain, non sans avoir d’abord semé le chaos sur leur passage. Le ton adopté est essentiellement humoristique et second degré (la bande son jazzy anachronique est à ce titre éloquente), ce qui permet de faire pardonner le manque de moyens, et d’apprécier pleinement l’efficacité avec laquelle les décors d’époque sont imaginés, en particulier le fort convaincant village des Vikings. Malgré tout, il convient de remarquer que ce film constitue la première réelle tentative de percée dans le genre par des pays nordiques, les deux seules autres productions s’intéressant au lointain passé médiéval du nord étant Sampo (Aleksandr Ptushko ; 1959) et La Source (Jungfrukällan ; Ingmar Bergman ; 1960), or aucune des deux ne met en scène des Vikings à proprement parler.
En 1985, la Norvège et l’URSS coproduisent une adaptation d’un roman soviétique avec le film Trees grow on the stones too (Dragens fenge ; Stanislav Rostotsky, Knut Andersen), dans lequel un orphelin des plaines russes est capturé par une tribu viking, puis devient progressivement l’un d’eux, avant de tomber amoureux d’une jeune femme déjà promise à quelqu’un d’autre. Sans être une œuvre d’exception, celle-ci parvient à invoquer une image plutôt réaliste des Vikings, de leur société et de leur vie dans les fjords norvégiens. Malheureusement, les dialogues sans fin et le rythme globalement lent de cette romance contrariée auront raison de la plupart des spectateurs, malgré les rares scènes de bataille amusantes (à défaut d’être crédibles).
De son côté, la production familiale norvégienne Sigurd Drakedreper (Knud W. Jorfald, Lars Rasmussen ; 1989) met en scène un Viking adolescent nommé en hommage au héros des légendes qui doit, à son corps défendant, devenir un valeureux guerrier, comme le sont son frère et son père, le chef du village. Sa nature frêle et ses intérêts inadaptés à la vie d’alors en font un outsider a priori inadéquat à la gestion de son clan, mais les événements le pousseront bien entendu à accepter son destin, non sans imposer sa personnalité. L’entreprise aura été allègrement imitée par les studios Dreamworks avec Dragons (Chris Sanders, Dean DeBlois ; 2010) et le parodique Ronal le Barbare (Thorbjørn Christoffersen, Kresten Vestbjerg Andersen ; 2011), sans toutefois parvenir à retransformer l’essai tant ce métrage norvégien sans prétention s’impose aisément comme l’un des meilleurs films de Vikings pensés pour le jeune public. Loin d’embellir ou de se montrer excessivement critiques à l’égard de leur héritage culturel, Jorfald et Rasmussen décident de dépeindre un Moyen Âge authentique dans son organisation sociétale, présentant clairement les différentes strates de population composant la civilisation viking, y compris les esclaves (ici au travers d’un garçon kidnappé en Irlande, destination de choix pour les raids scandinaves de l’époque). De même, la tension martiale du récit est motivée par les rivalités claniques gouvernant la société, et le protagoniste est évidemment soumis à d’importantes pressions sociétales. Bien que le film reste accessible aux enfants, sa violence se trouve dans sa retranscription honnête des valeurs du passé, qui n’essaie par exemple pas de diaboliser l’esclavage ni d’enjoliver des pratiques qui sont parfois méprisées de nos jours.
Encore meilleur parmi les tentatives scandinaves, on compte également l’excellent The Last Viking (Den Sidste Viking ; Jesper W. Nielsen ; 1989), qui se concentre sur la revanche que prend un jeune Viking dont le village est ravagé par un monarque fou et tyrannique. S’attelant à représenter les conflits que doivent surpasser les personnages en temps de guerre civile, le réalisateur adopte une approche visuellement sobre mais psychologiquement brutale, qui entraîne le protagoniste de sa position sociale privilégiée aux tréfonds de la condition humaine lors de son combat pour sa survie. Nielsen parvient ainsi à passer d’un ton à l’autre avec une rapidité et une efficacité rarement égalées, enchaînant par exemple une scène humoristique puérile à la réalisation par le héros que sa mère doit utiliser son corps pour survivre, que son esclave a été brutalement violée, ou que son frère se fait torturer. D’épreuve en épreuve, le film conserve fermement le point de vue de son jeune protagoniste, sans jamais lui épargner les retombées de sa situation. La fin plus amère que douce vient planter le dernier clou à un scénario d’une habileté et d’une intelligence rares. Aucune unité de temps ou de lieu n’est explicitement donnée par le film, mais les costumes, les armes et les bateaux, ainsi que l’absence de tout signe de monothéisme (l’apparence du roi fou faisant même plutôt référence à une forme de paganisme) laissent penser que le récit se déroule quelque part en Scandinavie avant l’aube du second millénaire. Au final, The Last Viking constitue probablement l’un des meilleurs films pour enfants du corpus (voire l’un des meilleurs films tout court), trouvant sa plus grande force dans les hors champs et les non-dits douloureux, et dans une écriture remarquable.
Le réalisateur Jerzy Hoffman, qui avait déjà exploré l’histoire polonaise du XVIe siècle (dans With Fire and Sword ; 1999), retourne à nouveau dans le passé, cette fois plus lointain, avec le remarquable When the Sun was a God (Stara basn. Kiedy slonce bylo bogiem ; 2003). Le film, basé sur un roman populaire du XIXe siècle, situe son récit dans la Pologne pré-chrétienne, à l’époque où les différentes tribus polanes indépendantes sont menacées par l’ambitieux et tyrannique Popiel, monarque tentant par tous les moyens (actes familicides compris) de subjuguer la région à son joug. Ce dernier passe un marché avec les Vikings pour assurer sa victoire et écraser tout résistance. C’est sans compter sur le héros solitaire Siemovit, qui galvanise la force paysanne et parvient à mener la rébellion, repoussant les Scandinaves et faisant déchoir le tyran. Si le film se concentre principalement sur l’identité polonaise et la nécessité pour ce peuple de s’élever contre tout usurpateur du pouvoir, les nordiques deviennent le centre du récit pendant une partie du troisième acte, lors duquel ils sont majoritairement dépeints comme de prodigieux guerriers en quête de nouvelles terres. Le film fait finalement preuve de déférence à leur égard en leur accordant une scène de funérailles traditionnelles.
En 2006, la France et le Danemark collaborent à l’élaboration du film d’animation Astérix et les Vikings (Stefan Fjeldmark, Jesper Møller), une adaptation de la bande dessinée Astérix et les Normands, qui propose de mettre en scène un groupe de guerriers nordiques s’aventurant en Gaulle plusieurs années avant Jésus Christ. L’anachronisme étant volontaire, l’œuvre laisse entendre que les descendants des Scandinaves en question envahiraient sans doute la région à l’avenir (ce qu’ils feront donc 900 ans plus tard) et multiplie les clins d’œil historiques pour stimuler l’attention de son public. La représentation qui est faite des Vikings se révèle ici être un exemple idéal de symboles immédiatement identifiables par le jeune public visé : casques à cornes, gros muscles, cheveux blonds, barbes, navires, haches, habitat enneigé, goût de la bataille, bref, tous les stéréotypes imaginables sont rassemblés pour créer une figure hautement reconnaissable au premier coup d’œil.
Les productions familiales s’enchaînent ensuite quelques temps, avec notamment Timetrip: The Curse of the Viking Witch (Vølvens forbandelse ; Mogens Hagedorn ; 2009), dans lequel une sorcière scandinave païenne maudit un chrétien qui vit jusqu’à nos jours et construit une machine à voyager dans le temps. Il demande donc à un adolescent et sa petite sœur de se rendre dans le passé pour y récupérer un artefact susceptible de briser l’enchantement. La même année, le réalisateur Michael Herbig confectionne Vic le Viking (Wickie und die starken Männer), une adaptation du dessin animé nippo-européen du même nom, datant des années 1970, et partant d’un principe similaire à celui de Sigurd Drakedreper. Sa suite Vic le Viking 2 : Le marteau de Thor (Wickie auf großer Fahrt ; Christian Ditter ; 2009) adopte un ton humoristique enfantin identique, sans qu’aucun des deux ne fasse réellement preuve d’intelligence ou d’intérêt particulier. On peut également mentionner le récit d’aventures archéologiques Le secret du Ragnarok (Gåten Ragnarok ; Mikkel Brænne Sandemose ; 2013), une production familiale compétente et tirant pleinement parti de paysages nordiques époustouflants, bien qu’elle ne prenne finalement que très peu de risques avec le genre, se contentant d’en agrandir les rangs de manière passive.
Le film norvégien Flukt (Roar Uthaug ; 2012), grossièrement retitré Dagmar – l’âme des Vikings en France, n’a en fait rien à voir avec lesdits Vikings, l’histoire se déroulant au XIVe siècle, soit environ trois cent ans après leur disparition. Le film demeure cela dit excellent, et constitue une alternative idéale au médiocre Viking – L’âme des guerriers (Antony Smith ; 2014) pour quiconque souhaiterait mettre la main sur un survival médiéval minimaliste et nerveux. Il vaudra également mieux en rester là et éviter de s’attarder trop longtemps sur le film suisse Northmen – Les derniers Vikings (Northmen – A Viking Saga ; Claudio Fäh ; 2014), un autre survival violent, enchaînant un nombre incommensurable d’invraisemblances à la minute dans le but de faire des Scandinaves en question des guerriers à la limite de l’invincibilité et du surhumain. Une volonté d’héroïsation à outrance, sans doute, qui aurait pu donner lieu à un métrage intéressant si l’idéalisation avait été plus mesurée.
Que tirer de ce tour d’horizon à deux mouvances ? Les thèmes récurrents qui habitent le corpus des films de Vikings sont multiples et interconnectés, l’un n’allant que rarement sans les autres. Le concept clé du genre est sans doute celui de la vengeance, qu’il s’agisse d’un conflit personnel entre individus ou d’un châtiment attribué en représailles à un événement sociétal ou culturel. En effet, de la vengeance matricielle de Kriemhild dans Die Nibelungen (Fritz Lang ; 1924), à la revanche annoncée de Vladimir de Kiev sur son traître de frère Iaropolk dans Viking (Andrei Kravchuk ; 2016), en passant par la volonté des frères rivaux Erik et Einar de venger la mort de leur père dans Les Vikings (Richard Fleischer ; 1958), le thème de la vengeance se retrouve d’un bout à l’autre du corpus, se faisant souvent moteur du récit et motivation principale des héros vikings (elle est même au centre de la trilogie du corbeau de Hrafn Gunnlaugsson). Cela découle sans aucun doute du concept d’honneur et d’obligation morale régissant la vie des personnages (des Vikings comme, souvent, de leurs adversaires paneuropéens), qui se sentent tenus de défendre leur honneur familial, clanique ou culturel.
Cela donne souvent lieu au second thème : l’opposition spirituelle qui distingue le paganisme de la religion chrétienne ayant fini par conquérir la civilisation viking. La conversion, cependant, s’étant faite au prix de trois siècles de combats, de souffrance et de morts, il n’est pas rare de retrouver une confrontation religieuse au sein de ces films, et ce de façon explicite dès Arnljot (Theodor Berthels ; 1927), dans lequel le sort des personnages principaux est justement scellé par la guerre des religions. Prenant racine dans l’histoire avérée comme dans la légende (les fils de Ragnar Lodbrok sont restés dans la postérité pour avoir levé la grande armée païenne sur l’Angleterre du IXe siècle), cette opposition constitue le cœur des déchirements émotionnels et spirituels vécus par les personnages ici dépeints, ou tout simplement de leur motivation première. Le thème se retrouve ainsi dans The Viking (Roy William Neill ; 1928), qui fait de la conversion au monothéisme sa justification à l’ascendance viking de la civilisation américaine. Même Fritz Lang, dans son invariable capacité à nuancer son approche, n’a pas pu faire autrement que de livrer un film qui oppose la plus grande légende germanique aux forces d’invasion des Huns, les barbares « autres ». Friedrich Engels avait synthétisé l’attrait et la symbolique de Siegfried de la manière suivante :
« Pourquoi la légende de Siegfried demeure-t-elle si puissante ? [C’est qu’il] représente la jeunesse allemande. Elle s’adresse particulièrement à ceux dont le cœur n’a pas encore été dompté par l’oppression de la vie. Au final, nous avons tous soif d’action et de résistance contre tout ce qui est conventionnel. »
Ainsi, Siegfried aurait été le parangon de la hardiesse, du héros chrétien victorieux. Et pourtant, même le christianisme enveloppant le monde de Siegfried est teinté de couleurs païennes, de la forge d’une épée symbolique (reste wagnérien d’une entreprise sinon moins romantique) à l’affrontement avec un dragon, en passant par la présence de nains, tout l’univers du héros est un héritier de la structure mythologique teutonique et scandinave. Cela s’explique par le fait que si le texte médiéval d’origine, datant probablement du Ve siècle, se rapprochait plus de la chevalerie, son adoption subséquente par les pays scandinaves (pas encore christianisés) s’est accompagnée d’une injection mythologique et fantastique. L’appartenance du film de Lang à une tradition weimarienne de résurrection et de popularisation des anciens mythes en a donc fait le catalyseur logique des éléments païens ayant survécu dans la conscience populaire, et de nombreux films médiévaux en tireront leur inspiration structurelle, thématique ou esthétique. Une bonne partie des films du corpus aborde la question de la foi, mais certains sont tout particulièrement éloquents, comme Alfred le Grand, vainqueur des Vikings (Clive Donner ; 1969), qui fait de cette différence religieuse le cœur émotionnel de l’affrontement entre Alfred et Guthrum, ainsi que la raison se cachant derrière leurs personnalités diamétralement opposées. Même Ingmar Bergman, avec La Source (1960), comprend l’importance de la problématique, et parvient à la traiter de façon organique dans un récit habité par les symboliques. Il transforme ainsi ses personnages en incarnations d’idées abstraites et explore la difficulté culturelle (presque biologique) qu’ont les Suédois du XIVe siècle à se défaire des mœurs descendant de leur héritage païen.
Mais l’importance de cet affrontement entre systèmes de croyance va beaucoup plus loin. Il n’est en effet pas anodin d’observer que les auteurs des sagas, ceux qui les ont écrites, mises sur papier, immortalisées dans l’Histoire, étaient tous chrétiens, et se sont tous intéressés de façon particulière aux siècles de transition amenant leur société païenne à s’intégrer à la pensée monothéiste qui dominait déjà le continent. C’est parce que ces auteurs ont perçu que leur monde avait été irrémédiablement transformé lors de cette période de mutations, et que c’est lors de celle-ci que les figures mythologiques des uns et des autres se sont sans le moindre doute réellement affrontées dans la guerre de l’identité culturelle nordique.
« Le christianisme, caractérisé par des fondements fortement historiques, une orientation résolument téléologique, et un système englobant de relations historiques, aura inévitablement donné lieu à une nouvelle conception du passé, et donc nécessairement du futur. »
– Joseph Harris, Speak Useful Words or Say Nothing: Old Norse Studies (Islandica)
En effet, tout porte à croire que les sociétés européennes pré-chrétiennes se méfiaient de l’archivage historique auxquels se sont plus tard prêtés les moines, et que leur rapport à l’Histoire était tout autre, plus symbiotique et moins empirique. C’est là que se situe la tension la plus exaltante du genre : lorsque le héros scandinave décide d’adopter le christianisme, il ne le fait souvent ni par conviction, ni par tactique politique, mais parce qu’il prend conscience d’une possibilité de postérité de martyr historique plus définitive (à l’instar de Leif Ericsson dans The Viking de Neill) ; ou, s’il rejette au contraire cette foi, ce n’est pas non plus car il s’inquiète du sort de sa société païenne, mais parce qu’il souhaite entrer dans la légende plutôt que dans l’Histoire (comme Beowulf dans le film de Zemeckis). Plus intense encore est la force narrative métadiégétique traduisant le glissement du héros légendaire vers une histoire factuelle, comme on peut le voir dans la série Vikings, qui soumet Ragnar Lodbrok à cette transition progressive. Hésitant entre sa foi polythéiste traditionnelle et l’attrait du dieu chrétien, Ragnar passe petit à petit – et uniquement au sein du récit, bien entendu – de la parfaite figure des sagas légendaires (force païenne quasi-surnaturelle, mystérieuse, insaisissable), au sujet d’une saga royale aux nombreux témoins (il devient lui-même roi et agit de moins en moins en héros, en particulier lors du siège de Paris en fin de saison 3), qui apprennent lentement à ignorer la légende pour mettre à jour l’homme.
Enfin, dernière étape facultative pour le héros viking : ce que Derek Elley appelle la « régénération morale » dans son livre The Epic Film – Myth and History, et qui revient à faire subir au protagoniste une transformation personnelle, émotionnelle ou spirituelle ; souvent, le Viking trouve le moyen d’embrasser son destin grandiose ou se convertit au christianisme. Le destin et la régénération sont d’ailleurs généralement liés de près, comme l’illustrait Thea von Harbou lorsqu’elle parlait de Die Nibelungen, qui selon elle était « conçu pour souligner l’inexorabilité avec laquelle la culpabilité primordiale mène à l’expiation ultime ». En d’autres termes, un destin forgé dans la roche, guidé par quelque déité qui aurait décidé de faire de tel homme un héros et de tel autre son ennemi, un destin qui mène inexorablement à la renaissance, sinon du protagoniste, au moins du monde qui l’entoure (voir la transformation de l’épouse Kriemhild en vengeresse, ou celle de l’esclave Erik en roi dans Les Vikings). Et quoi de plus logique, finalement, pour un peuple dont l’existence a été façonnée des siècles durant par la croyance que jamais rien ne pourrait enrayer le Ragnarök, et que la fin des temps serait également synonyme de renaissance, de « régénération » mondiale ?
Frontière viking et influence globale
Au-delà de tous ces thèmes communs au corpus, l’on ne saurait échapper à une ultime problématique indissociable de la représentation des Vikings dans la culture populaire : celle de leur propre frontière. La première frontière, celle qui amena les Vikings sur les rivages islandais et groenlandais, est passée sous silence. C’est l’autre frontière qui intéresse les conteurs, celle qui s’étend par-delà l’océan. La question de la découverte de l’Amérique par les explorateurs nordiques n’appartient plus au domaine de la spéculation, car il est désormais avéré que des voyageurs scandinaves ont établi une colonie – si éphémère eut-elle été – sur les terres qu’ils nommaient Vinland. Le fait fascine depuis longtemps les Américains comme les Scandinaves, qui voient là l’opportunité de remettre en question l’importance historique de Christophe Colomb, et d’imaginer une autre généalogie aux États-Unis, plus foncièrement mythologique, plus riche historiquement parlant, et surtout potentiellement lavée des retombées génocidaires de l’Histoire jusqu’alors officielle. Des personnalités telles que Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson – qui avait même proposé à l’assemblée de Virginie de rendre obligatoire l’étude du vieux norrois – commencent à distiller l’intérêt pour le sujet dans l’inconscient américain. L’ampleur du phénomène s’accentue avec les premières fictions, et particulièrement les poèmes d’Henry Longfellow, de John Greenleaf Whittier et de James Russel Lowell, et culminera sans doute avec la commémoration du Leif Ericson Day. Parmi les œuvres les plus parlantes sur la mentalité entourant le sujet à l’aube du XXe siècle, il convient de citer la trilogie de romans vikings extrêmement populaires de l’auteure américaine Ottilie Liljencrantz, dont le projet thématique peut être ainsi résumé :
« L’objectif global de Liljencrantz dans sa trilogie revient à représenter les Vikings en tant que race supérieure dotée d’une mission divine et d’un esprit indomptable, menée par le grand Leif Eriksson et son zèle missionnaire. La supériorité raciale des Vikings est clairement mise en contraste avec la vulgarité et le caractère grotesque des indigènes qu’ils rencontrent, et dont les tactiques sournoises et la violence extrême mènent finalement à l’expulsion des nobles colonisateurs blancs. Le chef des Vikings compare cette retraite forcée à une punition divine engendrée par ceux parmi ses comparses qui n’ont pas su contenir leur instinct animal. [Liljencrantz] avait à cœur de transmettre un message crédible quant aux valeurs chrétiennes caractérisant les pères fondateurs scandinaves de l’Amérique, tout en diffusant un subtil avertissement à l’encontre des dangers liés au métissage. »
– Martin Arnold, Thor: From Myth to Marvel
Comme évoqué précédemment, The Viking (Roy William Neill ; 1928) adopte la même orientation, pour la bonne raison qu’il s’agit de l’adaptation du premier roman de ladite trilogie, The Thrall of Leif the Lucky: A Story of Viking Days. Malgré l’absence de dialogues, le métrage est assez populaire pour justifier une ressortie version comédie musicale sous le titre The Private Life of Leif Ericson, et représente à ce jour l’une des tentatives historiographiques américaines les plus remarquables (le fait que les dernières notes de la bande originale du film se rapprochent de l’hymne américain n’a rien d’anodin).
Il faut donc ensuite attendre plusieurs décennies pour que le cinéma se décide à réinvestir ce récit. Erik le Viking (Erik il Vichingo ; Mario Caiano ; 1965) reprend l’essentiel des sagas contant la découverte de Vinland par les Scandinaves tout en accentuant la dimension héroïque de son cadre narratif. Le film se concentre sur Erik, le neveu du chef Viking Thorvald, qui reçoit la moitié de l’héritage de la part de son oncle, ce qui ne manque pas de rendre son cousin Eylof jaloux. Erik est chargé par son oncle mourant de partir en quête de nouvelles terres, afin que son clan puisse échapper au règne du royaume danois, tandis qu’Eylof demeure au pays. L’expédition atteint Vinland, en dépit de tentatives de sabotage par les hommes d’Eylof . Une fois installés dans cette région – qu’on nous présente comme subtropicale –, une idylle naît entre Erik et la fille du chef amérindien. Les autochtones sont représentés de manière moins ouvertement critique qu’en 1928, mais un prétendant local à la jeune femme, jaloux, s’allie aux traîtres nordiques pour se débarrasser d’Erik. La situation dégénère au point d’entraîner la mort de la jeune Amérindienne, et les Vikings, désabusés, abandonnent leur colonie pour rejoindre la Scandinavie, où Erik expose les machinations de son cousin et monte finalement sur le trône. Plusieurs monologues et échanges sont trop chargés politiquement parlant pour complètement ignorer le sous-texte de guerre froide parcourant le film, qui multiplie les promesses de liberté à l’Ouest et les rappels de la tyrannie caractérisant l’Est.
Un film à peu près inexplicable émerge plusieurs années plus tard sous le titre Thorvald le Viking (The Norseman ; Charles B. Pierce ; 1978), et accumule les idioties à un rythme effréné : des anachronismes évidents (casques à cornes à tout va, Amérindiens Iroquois quelques siècles trop tôt, etc.), un ton faussement épique avec narration solennelle et répliques parodiques (l’affiche donne aussi le ton), un Viking africain portant la langue coupée d’un Scandinave autour du coup mais accompagnant tout de même l’expédition et cyniquement nommé Thrall (le mot norrois qui signifie « esclave »), un sorcier soit-disant mystérieux, des morts causées par des flèches dans le postérieur, des montages de Vikings courant sur la plage au ralenti, une utilisation en boucle de la même musique orchestrale, des acteurs horribles (Lee Majors avec moustache des années 70, des Blancs jouant des Indiens) ; bref, tout y passe et plus encore dans ce film s’intéressant à un groupe de nobles Nordiques voyageant vers Vinland pour secourir leur roi trahi et capturé par les indigènes barbares.
À l’autre extrémité du spectre se trouve Killian’s Chronicle: The Magic Stone (Pamela Berger ; 1994), un film à petit budget, écrit et réalisé par une médiéviste enseignant au Boston College. Se basant sur les sagas elles-mêmes, l’une desquelles (celle d’Éric le rouge) mentionnant au passage que Leif Ericson est envoyé vers l’Ouest en compagnie de deux esclaves écossais, Berger décide de changer la dynamique en faisant d’un esclave irlandais le protagoniste de son film. Le jeune homme, précieux pour les Vikings en raison de sa connaissance de la navigation à l’aide d’une pierre de soleil, arrive en Vinland avec un groupe de Scandinaves, qui assassinent sa sœur presque immédiatement lorsque la fratrie essaie de s’échapper. Suite à un malentendu lors d’une tentative d’échange commercial, les Vikings et les indigènes se montent les uns contre les autres, et Killian prend le parti des Amérindiens dans l’espoir de regagner sa liberté et potentiellement de rejoindre son Irlande natale. Tombant ensuite amoureux d’une autochtone, il participe à la résistance contre les Scandinaves, qui sont finalement vaincus. Le film se caractérise par un souci important du détail et en cela, il s’agit peut-être de l’incarnation la plus historiquement fidèle à la réalité de notre corpus. Bien que son sujet ne soit pas spécifiquement les Vikings, ces derniers occupent une place importante du récit, et sont perçus à travers les yeux de leur esclave celte. Tantôt accommodants, tantôt incroyablement violents (la légende du berserker est ici expliquée à travers l’ingestion d’amanites tue-mouches), les Vikings sont présentés comme des explorateurs marchands ayant bien peu d’estime pour les habitants de Vinland. Leurs adversaires, les Micmacs, sont au contraire victimes de leur passivité et de leur utopisme exacerbé, du moins jusqu’à leur rébellion. Il apparaît clair que Berger ambitionne de proposer une nouvelle vision du premier contact entre l’Europe et l’Amérique, et son approche tripartite se révèle partiellement payante lorsqu’il s’agit de nuancer la problématique de l’altérité et de l’adaptabilité de l’humain à d’autres cultures. La décision de se porter sur un héros irlandais plutôt qu’écossais est également l’occasion de rappeler une autre légende relative à la découverte de l’Amérique (par le moine irlandais Saint Brendan), et la culture amérindienne des Micmacs est explorée en profondeur. Malgré ses importantes limitations techniques (aucune virtuosité cinématographique ne vient élever le récit au delà de l’illustration, tous les affrontements sont décadrés ou en hors-champ, etc.), Killian’s Chronicle s’impose, par son travail de recherche appliqué, comme une fiction ludique destinée aux plus curieux.
La célébration millénaire de la découverte de Vinland est marquée par la sortie du film d’animation Leif Ericson (Phil Nibbelink ; 2000), écrit, réalisé et animé par un seul homme après son retrait des grands studios avec qui il collabore quelques années auparavant. Souffrant d’une animation très limitée, de décors pauvres et de mouvements saccadés, le film présente un scénario prenant ses libertés avec le sagas pour faire de Leif un enfant qui doit émigrer au Groenland avec son père, Erik le rouge, après que ce dernier est banni d’Islande. La découverte de Vinland est le résultat de péripéties n’étant pas réellement liées à un profond désir d’exploration, mais plutôt à une coïncidence intervenant en raison de machinations d’un Viking cupide convoitant les biens d’Erik. La fin de l’histoire laisse toutefois entendre que plusieurs bateaux partent s’installer en Amérique alors que Leif demeure au Groenland. Il est intéressant de remarquer que le christianisme est complètement occulté en faveur d’une version quelque peu spiritualiste de la mythologie nordique, qui transforme inexplicablement le loup Fenrir en esprit-totem protecteur. Si le recit est peut-être efficace avec les plus jeunes, il échoue à poser de véritables problématiques à son sujet, qui est déroulé avec trop peu de conflits et d’enjeux pour véhiculer une quelconque tension.
Il faut croire que le jusqu’au-boutisme de Charles B. Pierce manquait cependant à certains et que ces derniers ont souhaité corriger le tir avec Pathfinder (Marcus Nispel ; 2007). Officiellement, le film se voudrait un remake du long métrage norvégien Le passeur (Nils Gaup ; 1987), qui se concentre sur un jeune Lapon dont le village a été annihilé par les Tchoudes, des descendants rus des Vikings, et qui, feignant de les mener au prochain village, les conduit jusqu’à un piège. Le film de Nispel en reprend vaguement l’idée et l’arc global, mais les similitudes s’arrêtent là. Dans celui-ci, des Scandinaves accostent en Amérique et détruisent tout sur leur passage. Le fils du chef refuse de tuer une enfant indigène et est par conséquent abandonné par les siens en raison de sa couardise. Il est élevé parmi les Amérindiens, qu’il doit défendre vingt ans plus tard lorsque les Vikings reviennent semer la terreur. Le film ne prend aucune demi-mesure, se dédouane de toute vraisemblance historique et noie son peu de substance dans un enchaînement de combats mal filmés, sans aucune notion de cadrage. Les Vikings en question sont donc immenses, bestiaux, féroces. Il portent tous des armures lourdes, des casques à cornes plus fantaisistes les uns que les autres, montent tous à cheval, et tuent semble-t-il par pur plaisir, ne faisant même pas montre d’une velléité marchande. Outre l’avalanche de clichés, il n’est pas difficile d’imaginer que nombre de spectateurs auront trouvé la proposition grotesque : qui donc traverserait l’Atlantique avec un bateau surchargé d’armes et de chevaux, simplement pour trouver un nouveau terrain de chasse sportive ? Les hommes, quels qu’ils soient, avaient d’autres préoccupations il y a mille ans, et l’improbabilité extrême du concept empêche le film de s’accaparer une quelconque légitimité, d’autant plus que son déroulement entier se base sur une promesse d’action non tenue. Ces Scandinaves auraient, pourquoi pas, pu devenir des abstractions au service d’une idée (comme c’est le cas dans Brendan et le secret de Kells), mais le manque total d’iconisation ou de sens de la dramaturgie les en empêche. Face aux envahisseurs nordiques (clairement identifiés comme « autres », étant les seuls à parler une langue étrangère) se trouvent donc les Amérindiens et leur parfait anglais, qui souffrent encore une fois du syndrome des hippies pacifistes incapables de se défendre sans l’intervention (ne parlons pas d’aide, puisqu’il s’occupe de tout) du jeune Scandinave qu’ils ont adopté. D’aucun pourraient s’imaginer que le film propose une réflexion sur l’identité et le choix culturel s’offrant au protagoniste. Même pas.
S’en suit un film indépendant sans aucun budget : Severed Ways: The Norse Discovery of America (Tony Stone ; 2007), qui se concentre sur les tribulations de deux Vikings abandonnés par leur groupe en 1007, sur le nouveau continent. Les scènes interminables de découpe de bois en forêt et de randonnées sur la côte sont accompagnées de morceaux de heavy metal, avec headbanging occasionnel gratuit, et rares dialogues en vieux norrois. L’approche survivaliste apporte probablement une dimension inédite au problème, mais peu est fait pour explorer cette dernière au-delà d’actions somme toute banales (défécation dans les bois, construction d’abris, égorgement de poulets). Le métrage avance par chapitres, et s’attarde longuement sur le sujet religieux en suggérant la présence accidentelle de moines irlandais en Amérique. Si l’un des Scandinaves se délecte de les trucider et de brûler leur église de fortune (aux sonorités du black metal), l’autre est moins belliqueux envers les monothéistes, qui l’intriguent. Le récit tente de proposer quelques problématiques, mais l’approche globale est trop minimaliste et formellement bancale pour inciter tout réel intérêt. En résulte un film très étrange, techniquement approximatif, et conceptuellement indécis, qui reprend plusieurs des thèmes enracinés par ses aînés, sans toutefois parvenir à se les approprier de façon organique.
Il revient donc à Valhalla Rising – Le guerrier silencieux (Nicolas Winding Refn ; 2009) de clore l’exploration de la découverte du nouveau monde, non sans prendre quelques détours métatextuels bien pensés. Réalisée de telle manière qu’elle appartient d’emblée à la catégorie des « films d’auteurs », cette œuvre à la fois violente et contemplative constitue une proposition de relecture du crépuscule du système de croyance nordique, qui transforme ses lieux et personnages en symboles à la portée plus englobante. Par conséquent, les Vikings ici mis en scène servent plus de réceptacles allégoriques que de véritables personnages et, si le film de Refn paraît hermétique à certains spectateurs, c’est parce qu’il élève l’ensemble des problématiques du corpus à un niveau de discursivité plus abstrait, s’imposant sans aucun doute comme l’occurrence la plus ouvertement analytique du genre et de la période historique correspondante.
Les films de « frontière viking » ont cela de particulier qu’ils entretiennent un rapport différent avec l’altérité. En effet, si les œuvres se déroulant en Europe médiévale peuvent servir de métaphores aux possibilités d’intégrations, et celles au Moyen Orient (comme Les drakkars ou Les tartares) comme allégorie du choc des civilisations, la découverte scandinave de l’Amérique ne suppose jamais aucune de ces problématiques au niveau civilisationnel, car si des individus sont parfois susceptibles de se fondre avec succès dans la culture étrangère, il ne s’agit jamais d’une possibilité sociétale englobante, comme la plupart des films concernés le suggèrent. Preuve en est, l’expédition doit s’en aller et abandonner un unique couple européen sur le nouveau monde dans The Viking, la seule Amérindienne potentiellement amoureuse d’un Scandinave dans Erik le Viking trouve la mort, une seule femme indigène accompagne les Nordiques s’en allant victorieux dans Thorvald le Viking, seul l’ancien esclave irlandais parvient à embrasser la culture locale dans Killian’s Chronicle, la découverte du nouveau continent passe complètement sous silence ses habitants dans Leif Ericson, une incompatibilité totale sépare les Amérindiens pacifiques des Vikings quasi-inhumains de Pathfinder, et les cultures n’échangent jamais autre chose que des coups dans Severed Ways.
Ceci étant, il existe une autre frontière relative aux films de Vikings. Non pas celle qui les transporte par-delà l’océan, mais celle qui les fait apparaître dans des régions où on ne les attend pas. Il existe ainsi de rares productions internationales tout à fait surprenantes de part leur existence même. Parler d’un film de Vikings japonais, turc ou malaisien, c’est un peu comme imaginer un film français se réclamant du chanbara ou revenant sur la vie de Hang Tuah : ça n’aurait a priori pas beaucoup de sens. C’est parce que, la plupart du temps, ça n’en a pas. L’anime japonais de référence Horus, Prince du Soleil (Taiyou no ouji Horusu no daibouken ; Isao Takahata ; 1968) se déroule certes quelque part dans une contrée nordique imaginaire ressemblant à la Scandinavie, mais l’histoire demeure une adaptation des sagas yukar se rapportant à la tradition orale des Aïnous. Le changement de décor reste ainsi relativement superficiel, et ne donne pas lieu à une quelconque exploration des spécificités culturelles de l’Europe du Nord, bien que l’identité visuelle de l’œuvre soit assez élaborée pour y correspondre (vêtements, bateaux, environnements, etc.). Le film turc Tarkan contre les Vikings (Tarkan Viking kani ; Mehmet Aslan ; 1971) constitue quant à lui une adaptation de la bande dessinée populaire mettant en scène le héros-titre. Partant d’une théorie irrédentiste qui vise à faire des Huns les ancêtres légitimes des Turcs contemporains, l’univers de Tarkan s’inscrit dans une logique nationaliste embrassant sans retenue les codes de la fantasy et de la science-fiction. Appartenant à une série de cinq films, cet épisode opposant le héros hunnique aux Vikings contient, on s’en doute, de nombreux partis pris discutables. Il fait notamment se rencontrer les Huns commandés par Attila, les Vikings et des représentants de l’Empire chinois convoitant la demoiselle en détresse du récit. Les Scandinaves, qui arborent des costumes dépassant de loin toute notion de crédibilité, sont représentés comme des hommes cruels, malveillants et en qui on ne peut accorder aucune confiance. Et si quelques notions nordiques (comme Odin) subsistent, tout espoir est perdu lorsque les Vikings entraînent une pieuvre géante à se battre à leurs côtés. Un nanar qui ne peut que plaire aux amateurs du genre.
La plus récente tentative internationale nous provient de Malaisie (en coproduction avec les États-Unis) : Vikingdom : L’éclipse de sang (Yusry Abdul Halim ; 2013) se présente comme une entreprise luxueuse pour sa modeste industrie nationale, employant des acteurs américains et accumulant fonds verts et images de synthèse discutables. L’intrigue est surtout composée d’un mélange complètement improbable d’éléments mythologiques tirés des traditions nordiques, celtes et chrétiennes. Pour rester bref, le dieu Thor envisage de réunir trois reliques pour ouvrir le passage entre le Valhalla, Midgard et Helheim lors d’une éclipse, afin de punir les hommes après que ces derniers aient massivement abandonné les dieux nordiques en faveur du Christ. Si l’ensemble a de gros airs de série B avec histoire partant dans tous les sens, décors minimalistes et quelques perruques problématiques, le film n’hésite pas à réinventer les relations entre entités mythiques pour créer un univers amalgamé entrainant. Alors certes, Vikingdom finit plus par ressembler à une fanfic écrite sous l’influence de champignons, mais son approche est tellement premier degré que le film s’impose finalement comme une occurrence légitime de passation des légendes Scandinaves, dans une aventure semblant éviter tout parallèle avec son contexte de production.
Impossible, enfin, de terminer sans évoquer rapidement l’influence qu’a joué et que joue encore la mythologie nordique (et par extension, les films en étant dérivés) sur le cinéma en général. Superficiellement, ces légendes ont en effet pénétré le genre de l’horreur à des degrés divers : dans le slasher Berserker: The Nordic Curse (Jefferson Richard ; 1987), un groupe de jeunes étudiants se rend en forêt pour un week-end libertin, avant d’être confronté à un assassin d’apparence viking millénaire, qui est lui aussi un produit de l’arrivée de Scandinaves médiévaux en Amérique. La venue des Vikings en Vinland est à nouveau invoquée dans Le rocher de l’Apocalypse (The Runestone ; Willard Carroll ; 1991), un thriller horrifique appartenant bien plus aux années 1980 que 1990, dans lequel le loup mythologique Fenrir avait été emprisonné dans une rune enterrée en Pennsylvanie. Les archéologues qui la découvrent relâche ainsi l’esprit du loup dans la nature, qui se lance dans une série de meurtres aléatoires supposés annoncer rien de moins que le Ragnarök ! De son côté, Lost Colony (Wraiths of Roanoke ; Matt Codd ; 2007) revient sur la mystérieuse disparition de la colonie britannique de l’île Roanoke au XVIe siècle en la justifiant par la présence de spectres liés à des guerriers vikings incapables de rejoindre le Valhalla. La persistance de l’association des runes nordiques et du nazisme survit encore par intermittence, par exemple dans le film Blood Creek (Joel Schumacher ; 2009), qui fait d’une rune scandinave l’objet d’étude et de convoitise d’un nazi-zombie souhaitant déclencher une guerre occulte. Citons enfin Thale (Aleksander L. Nordaas ; 2012), un film d’horreur à très petit budget s’inspirant de la légende des huldres du folklore norvégien.
Cependant, le genre a surtout joué un rôle pivot dans le développement de l’heroic fantasy. Il suffit en effet de remarquer que nombre de créatures fantaisistes se retrouvent dans la mythologie nordique et les sagas : les elfes, les nains, les géants, les dragons et les sorciers font désormais partie de la culture populaire mondiale, tandis que les œuvres de référence des genres épiques et héroïques reposent souvent sur une structure dynastique, que l’on retrouve par exemple dans la Völsunga saga. Les mythologies grecques, celtes et nordiques constituent désormais la source de la vaste majorité du folklore culturel occidental, qui continue d’être exploité dans tous les formats. Les mythes nordiques occupent une place de choix dans l’imaginaire depuis leur réappropriation par les romantiques allemands, comme Friedrich de La Motte-Fouqué, dont la version des Nibelungen influencera celles de Friedrich Hebbel et Richard Wagner. Ce n’est en outre pas un hasard si quelqu’un comme J.R.R. Tolkien a travaillé dans sa jeunesse à traduire le poème de Beowulf, et qu’il a même composé une variante de la Chanson des Nibelungen !
Et quel meilleur film que Conan le barbare (John Milius ; 1982) pour illustrer l’empreinte du folklore nordique sur le genre ? Du premier au dernier plan, le long métrage culte de Milius transpire la mythologie, et particulièrement la mythologie nordique. Le protagoniste de l’adaptation a même été façonné, de l’aveu même du réalisateur qui avait toujours souhaité concevoir un film de Vikings, pour incarner un héros légendaire nord-européen. Dès lors, les similitudes se font évidentes : Conan est un homme devenu orphelin très tôt, avant d’être réduit en esclavage, puis de s’émanciper et d’occire un énorme serpent. Est-il encore utile de préciser qu’il s’agit là du parcours exact, à un dragon près, du héros Siegfried ? Le début du film est par ailleurs marqué par une scène qui rappelle l’épisode de la forge d’une épée dans Die Nibelungen, et le fétichisme de l’arme parcourant le récit descend directement d’une approche adoptée dès le poème consacré à Beowulf. On apprend également que la tribu capturant Conan est celle des Vanir (un nom issu directement du panthéon scandinave), ou encore que les têtes de dragons ornant la roue de la douleur sont des répliques de celles trouvées sur le bateau de Gokstad. L’influence même de Conan le barbare, son caractère de syncrétisme définitif, en a fait une référence incontournable du cinéma héroïque, et peut-être l’exemple le plus parlant de l’infiltration des codes du film de Vikings dans la culture populaire.
Conclusion
Outre les documentaires, qui forment un corpus à part entière, certains films plus ou moins liés à cette étude en termes géographiques, chronologiques ou thématiques n’ont pas été abordés dans l’article, parfois en dépit d’un souhait ardent. Cela s’explique par le fait qu’il existe des œuvres se déroulant quelques dizaines d’années avant ou (surtout) après l’existence de la civilisation viking à proprement parler, or l’approche et les thématiques liées aux récits portant sur les peuples nordiques d’époques ultérieures diffèrent de manière considérable. La disparition des Vikings marque en effet l’extinction définitive de la pratique étendue du paganisme nordique, même si de petits groupes polythéistes peuvent avoir subsisté dans certaines régions. Par conséquent, le thème portant sur l’opposition des fois a de grandes chances d’être absent. Il en va de même de la problématique de la frontière, qui n’interviendra plus dans l’histoire nordique après l’épisode ericsonien aux alentours de l’an 1000. Et même si la vengeance est un concept universel, il ne suffit pas à lui seul à rattacher un long métrage à un genre. Ainsi, des films comme Eye of the Eagle (Ørnens øje ; Peter Flinth ; 1997), Ikíngut (Gísli Snær Erlingsson ; 2000) ou The Last King (Nils Gaup ; 2016) ne correspondent plus à la période viking, et constituent donc plutôt des films sur la Scandinavie médiévale. D’autres films demeurent tout simplement introuvables et, lorsque l’inclusion d’informations à partir de sources secondaires n’était pas strictement nécessaire, il a été décidé de les laisser de côté (qui a vu The Demon’s Daughter de John McTiernan ?).
Enfin, une partie des films traités ici sont très difficilement disponibles, n’existant parfois que dans des éditions DVD rares, sans pistes ni sous-titres autres que leurs langues d’origine, tandis que d’autres se cachent dans les tréfonds d’Internet, possiblement dans des versions de diffusion télévisées piratées. Cet état de fait s’applique particulièrement aux titres scandinaves, et témoigne, s’il était encore besoin, qu’un traitement autre que l’embellissement héroïque n’attire pas vraiment les distributeurs anglophones ou francophones, pensant sans doute que le public ne serait pas intéressé. Les films en question ont été visionnés, lorsque cela était possible, dans leur langue d’origine, puis compris en corrélant narration visuelle et sources secondaires (c’était par exemple le cas de Här kommer bärsärkarna).
Pourquoi, donc, les films de Vikings sont-ils toujours là ? L’altérité de l’ancienne culture nordique par rapport à l’uniformisation chrétienne a ramené les vieux mythes du Nord sur le devant de la scène. Leur forme et leur contenu en font un vecteur puissant de problématiques variées, de l’identité des peuples aux tensions religieuses parcourant les sociétés, en passant par leur utilisation allégorique au service d’initiatives culturelles diverses. Ils continuent de fasciner parce qu’ils regroupent toutes les contradictions : s’agissait-il de marchands et navigateurs habiles au développement politique avancé, ou de guerriers sauvages indomptables ayant massacré la moitié de l’Europe ? Les historiens et archéologues ont bien entendu la réponse à cette question, mais au cinéma, la véracité historique importe guère. Les Vikings sont ce que nous avons besoin qu’ils soient : des explorateurs évangélistes hors pairs (The Viking), des héros d’épopées primordiales (Beowulf), des pop stars glamour d’Hollywood (Les Vikings), de nobles païens regrettés (The White Viking), des brutes à la violence incommensurable (Pathfinder), ou tout simplement des êtres humains évoluant dans une société complexe qui nous intrigue toujours (The Last Viking).
Pour leur accorder leur statut, les auteurs ont pu opter pour deux solutions, à savoir la retransmission des mythes d’antan (mouvement descendant), plus fondamentale, plus primordiale, ou la réinterprétation fictive d’événements passés les faisant remonter vers la légende (mouvement ascendant), plus proche de nous, plus apte à encourager l’historiographie. La pluralité et la persistance du genre laissent entendre que les guerriers d’Odin réservent encore quelques surprises à l’imaginaire culturel européen, et si certaines séries B feraient parfois mieux de rester coites, toutes les itérations cinématographiques des Vikings ont au moins cela de sensé qu’elles en perpétuent la légende à travers leur immortalité culturelle.
* Sources :
Arnold, Martin. Thor: From Myth to Marvel. Bloomsbury Academic : 2011.
Elkington, Trevor et Nestingen, Andrew. Transnational Cinema in a Global North: Nordic Cinema in Transition. Wayne State University Press : 2005.
Elley, Derek. The Epic Film: Myth and History. Routledge Kegan & Paul : 1985.
Finke, Laurie et Shichtman, Martin. Cinematic Illuminations: The Middle Ages on Film. Johns Hopkins University Press : 2009.
Fors, Andrew Peters. The Ethical World-Conception of the Norse People. Leopold Classic Library : 2015.
Harris, Joseph. Speak Useful Words or Say Nothing: Old Norse Studies (Islandica). Cornell University Library : 2009.
Harty, Kevin J. The Vikings on Film: Essays on Depictions of the Nordic Middle Ages. McFarland : 2011.
Lunde, Arne. Nordic Exposures: Scandinavian Identities in Classical Hollywood Cinema. University of Washington Press : 2011.
Mabire, Jean. Légendes de la Mythologie Nordique. Ancre de Marine : 2012.
Wawn, Andrew. The Vikings and the Victorians: Inventing the Old North in Nineteenth-Century Britain. D.S. Brewer : 2002.
Vous ne parlez pas d’une (bonne) série TV : The last Kingdom/Le dernier Royaume, qui suit (jusqu’ici) assez fidèlement le texte de Bernard Cornwell : Saxon Stories. On y relate les relations conflictuelles entre le roi Alfred et les Danes, avec comme héros Uhtred de Bebbanburg, un seigneur Angle élevé par le clan de Ragnar Le jeune, et qui hésite entre les deux cultures et leurs deux visions du monde assez inconciliables.
Et bravo pour votre analyse très fouillée !
J’aimeJ’aime