Life : sublimation de l’horreur spatiale
Dans son exploration de l’horreur cosmique, LIFE renoue avec les idées archétypales du genre pour recadrer les peurs existentielles qu’elles soulèvent.
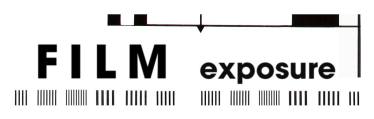 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Dans son exploration de l’horreur cosmique, LIFE renoue avec les idées archétypales du genre pour recadrer les peurs existentielles qu’elles soulèvent.
 Les formules préfabriquées proclamant que Life constitue un croisement entre Alien et Gravity, ou quelque autre film semblant comprendre des similarités plastiques, suffisent-elles à réellement appréhender le dernier représentant en date de ce genre de films trop rares et trop rarement bons que sont les horreurs spatiales ? Il faut avouer que la tentation d’ignorer sa sortie était assez forte, la bande-annonce laissant présager d’un film extrêmement dérivatif, porté par un réalisateur aux travaux pas toujours convaincants. Grand bien nous en a donc fait de répondre à l’appel de la curiosité, Life se révélant être certes inégal et perfectible, mais aussi et surtout une belle plongée dans les méandres de l’horreur cosmique.
Les formules préfabriquées proclamant que Life constitue un croisement entre Alien et Gravity, ou quelque autre film semblant comprendre des similarités plastiques, suffisent-elles à réellement appréhender le dernier représentant en date de ce genre de films trop rares et trop rarement bons que sont les horreurs spatiales ? Il faut avouer que la tentation d’ignorer sa sortie était assez forte, la bande-annonce laissant présager d’un film extrêmement dérivatif, porté par un réalisateur aux travaux pas toujours convaincants. Grand bien nous en a donc fait de répondre à l’appel de la curiosité, Life se révélant être certes inégal et perfectible, mais aussi et surtout une belle plongée dans les méandres de l’horreur cosmique.
Dans un futur très proche, l’équipe d’astronautes occupant la station spatiale internationale se prépare à réceptionner un module revenant de Mars avec des échantillons. Ses membres, qui comptent le médecin David Jordan (Jake Gyllenhaal), l’envoyée du CDC Miranda North (Rebecca Ferguson), le microbiologiste Hugh Derry (Ariyon Bakare), le technicien Rory Adams (Ryan Reynolds), le pilote Sho Murakami (Hiroyuki Sanada – déjà Commandant du vaisseau dans Sunshine) et le capitaine Ekaterina Golovkina (Olga Dihovichnaya), anticipent avec excitation les potentielles découvertes que permettront leur analyse. Très vite, la nouvelle d’une forme de vie martienne se propage : les astronautes ont à bord de la station un organisme extra-terrestre aux propriétés incroyables. Baptisé « Calvin » par des élèves terriens tirés au sort, l’être en question présente une croissance et un comportement qui finira par mettre en danger tout l’équipage, si ce n’est plus…
Laissant ses intrigues pédestres et oubliables derrière lui, le réalisateur suédois Daniel Espinosa prend son envol avec Life, un film écrit par Rhett Reese et Paul Wernick. Le duo, connu pour ses scénarios reposant sur un humour méta répétitif (Zombieland, GI Joe: Retaliation, Deadpool), change ici totalement de registre. Le passage à un script premier degré semble leur avoir fait le plus grand bien, ces derniers parvenant à mettre en place un cadre immersif habité de personnages rapidement identifiables. Ils s’attaquent ainsi au genre de l’horreur spatiale, placé au firmament du cinéma et largement codifié par Alien, puis habilement augmenté avec The Abyss, Sunshine et, dans une moindre mesure, Starship Troopers. Même en considérant l’œuvre fondatrice d’Andreï Tarkovski, Solaris, et l’immense The Thing de John Carpenter, comme en faisant partie, ce genre semble se caractériser par une indéniable pauvreté en grands films de qualité. Face à eux, les quelques exemples datant des années 1950 souffrent désormais (pour la plupart) d’une approche esthétique trop pulp et d’un traitement superficiel, tandis que les nombreuses séries Z produites en continue depuis les années 1980 constituent malheureusement la majeure partie du corpus (de Creature, Star Crystal et Galaxy of Terror, jusqu’à Doom et Apollo 18).
Entamant son long-métrage par un habile plan-séquence qui nous présente à la fois la station, son équipage et leur mission actuelle, Espinosa fait immédiatement preuve d’une ambition assurant à son film d’appartenir au haut du panier. Sa réalisation est, pour l’essentiel, maîtrisée. Choisissant de rester proche des personnages, il limite les plans orbitaux de la Terre pour se concentrer sur l’intérieur confiné de la station, qu’il transforme progressivement en espace à la fois claustrophobique et labyrinthique. Quoi que semblant flotter avec les personnages (eux-mêmes en apesanteur continue), sa caméra objective offre des plans stables et fluides.
Le film s’avère être, en termes de divertissement, un thriller horrifique globalement efficace, qui ne réinvente certes rien, mais traite son sujet avec une déférence louable et une générosité agréable. Il s’agit donc probablement du meilleur travail du tandem Reese/Wernick, malgré quelques facilités d’écriture handicapantes, qui menacent parfois de faire perdre au film son élan ; on pense en particulier à un stratagème utilisé par Calvin pour se cacher aux deux tiers du métrage, puis au retournement de situation final, logique mais fort mal amené. D’autres détails sont susceptibles de déplaire aux amateurs de science, notamment l’utilisation d’un lance-flammes sur l’ISS (rien de pire que le feu dans l’espace), la faiblesse étonnante des protocoles de sécurité sur la station (le système d’aération du laboratoire connecté directement avec celui des autres zones…), et ainsi de suite.
Life se démarque dès le départ par la décision des scénaristes de placer l’histoire dans un futur imminent, atténuant la dimension spéculative pour se concentrer sur les conséquences d’un événement présenté comme possible d’ici quelques années à peine. Surtout, il donne à son extra-terrestre une origine martienne, amplifiant l’aspect plausible du scénario. Le personnage de Hugh Derry, le biologiste, spécule cependant que Calvin n’est pas forcément originaire de Mars, mais qu’il pourrait être la raison de l’absence d’autre vie sur la planète rouge. On effleure ainsi timidement l’aspect mythologique d’une Mars (anciennement) habitée, déjà amplement exploré au cinéma (Himmelskibet, Mission to Mars, Ghosts of Mars, John Carter).
Et puis il y a bien sûr le concept de Calvin lui-même, qui a tout pour ravir les amateurs de science-fiction audacieuse. Créature singulière, non-anthropomorphe (c’est assez rare au cinéma pour être souligné), aux capacités d’évolution sidérantes, Calvin est décrit comme une sorte de survivant millénaire, dont la constitution lui permet de traverser les âges et les épreuves au niveau cosmique. Arborant d’abord une apparence proche de certains êtres évoluant dans nos fonds marins, l’extra-terrestre finira pas prendre une forme aux contours délicieusement lovecraftiens.
Attention : le texte qui suit révèle des éléments clés de l’intrigue. Il est fortement conseillé d’avoir vu le film avant d’en continuer la lecture.
Cette appartenance au corpus lovecraftien tient non seulement de son image, mais pas uniquement. En effet, ses similarités au panthéon cthulhien sont nombreuses : son origine remonte à des temps immémoriaux, sa composition moléculaire demeure partiellement inexplicable, ses actions ne sont déterminées par aucun concept de bien ou de mal, sa perception de l‘humanité est dénuée de toute émotion, son mode de croissance implique la destruction d’autres formes biologiques, sa capacité de survie dépasse l’entendement, et son arrivée sur Terre serait synonyme d’extinction. Le film évoque à ce titre The Thing car l’être auquel les humains sont confrontés présente des caractéristiques comparables et constitue une menace aux retombées identiques (la trilogie du chaos de Big John explorait par ailleurs de nombreux thèmes rappelant les écrits de Lovecraft). Le film de Carpenter étant un excellent modèle, la tension parcourant Life est usante, palpable, envahissante, à ceci près qu’ici, aucune paranoïa interpersonnelle n’entre en jeu. L’aspect complètement « autre » de Calvin sera légèrement atténué sur la fin lorsque celui-ci développe une sorte de visage permettant de focaliser l’attention. Il s’agit d’une évolution peu logique mais pardonnable, la volonté de créer une créature iconique (et donc un minimum identifiable) se faisant sentir. Reste un problème de taille engendré par un incompréhensible choix du cinéaste : les quelques plans en vue subjective de l’alien navigant dans la station rétrécissent considérablement l’écart cognitif le séparant des humains. L’absence totale de tels plans aurait permis de cimenter son altérité absolue.
Par son apparence initiale informe, Calvin fait quelque peu penser à la créature gluante de The Blob, ainsi qu’à quelques descriptions d’aliens échinodermes dans les textes The Whisperer in Darkness et The Shadow out of Time de Lovecraft. Sa nature d’alien-tout, de corps-cerveau, remonte cependant au moins à H.G Wells et sa Guerre des mondes, roman dans lequel le narrateur évoque des envahisseurs dont les machines semblaient n’être qu’un prolongement organique de leurs corps tentaculaires. Cette image de l’octopode à l’intelligence supérieure persiste ainsi jusque dans Life (après avoir été très timidement effleurée dans Europa Report).
Une critique récurrente adressée au film concerne ses personnages, parfois qualifiés de peu attachants ou interchangeables. C’est en partie vrai, mais cela s’explique par le choix d’utiliser des personnages-fonction dont l’importance se révèle beaucoup mieux au niveau de l’hyperstructure narrative plutôt qu’au niveau immédiat. En d’autres termes, l’enjeu se trouve dans leur objectif global (empêcher Calvin d’atteindre la Terre) et non dans leur sort personnel. Les membres de l’équipage présentent tout de même des divergences utiles, qui rendent le script assez vivant. Hugh Derry et Rory Adams se révèlent être les individus les plus émotifs et donc les plus susceptibles de commettre des erreurs. Leurs amis sont plus pragmatiques mais, comme le démontre le film, un comportement d’équipe majoritairement rationnel peut être mis à mal par une minorité de réactions émotionnelles, qui mènent à la défaite du groupe.
David Jordan, interprété par Gyllenhaal, constitue probablement le personnage le plus intéressant car il se définit très facilement en quelques traits : sa fascination sans borne pour l’espace et le fait qu’il préfère vivre à bord de l’ISS plutôt que sur Terre, alliés à son pragmatisme professionnel, en font un parfait archétype du scientifique romantique compétent. Ce n’est notamment pas le cas de ses coéquipiers, dont la personnalité va du scientifique hanté par son désir de transcendance (Derry) à l’experte utilitariste dénuée de toute pensée métaphysique (North), en passant par les figures héroïques prototypiques et finalement impuissantes (les trois autres, dont le sacrifice est louable mais sans effet). Il n’est donc pas surprenant de découvrir qu’en fin de métrage, c’est Jordan qui se porte volontaire pour se « confronter » seul à Calvin. L’opposition des deux entités (l’explorateur romantique et la manifestation cosmique d’un chaos primal) renvoie et répond à une figure littéraire popularisée par Edward Bulwer-Lytton dans son roman Zanoni, au cours duquel le personnage éponyme, un immortel sur le chemin de l’éveil spirituel ultime, abandonne son éternité au nom de l’amour (l’humanité étant, on le comprend, incompatible avec l’immortalité). Souhaitant prendre sa place, un noble Anglais nommé Glyndon devient le nouveau disciple du maître de Zanoni et tente à son tour d’atteindre l’illumination. Son impatience indomptable, cependant, le mène face à face avec « le Gardien du Seuil » (the Dweller at the Threshold), une entité horrifique veillant sur le passage entre les mondes de perception. Si cette création a fait couler beaucoup d’encre dans les bureaux de psychanalyse, il s’agit surtout pour nous d’un archétype fictionnel représentant tangiblement une horreur métaphysique associée à la découverte d’une réalité que l’humain n’est pas prêt à assimiler. Or Life fait écho – probablement inconsciemment – à ce mécanisme en attribuant au personnage de Derry le rôle d’un Glyndon, puis en opposant directement, dans son dénouement, la figure zanonienne (Jordan) à celle du gardien du seuil (Calvin) pour redonner vie, de manière exaltante, à ce moment héroïque entre tous où l’homme obsédé par l’immensité cosmique se mesure, au péril de sa vie, à l’incarnation d’un cosmos horrifique dans ce qu’il a de plus insondable.
Vers la moitié du film, le biologiste Hugh Derry explique à ses compagnons que Calvin ne ressent aucune haine – ni aucune autre émotion – à leur égard, mais qu’il se contente de faire ce qu’il faut pour survivre. Mis en parallèle au titre du film, ce rappel permet d’établir que sans mort, il n’y aurait aucune vie, et vice versa. La vie est un processus destructeur par nature, qui n’aurait d’ailleurs aucune valeur spéciale si elle était éternelle. Or c’est précisément ce désir indomptable du perfectionnement de la vie qui mène l’humanité à sa ruine. On le comprend lorsque Derry révèle qu’il souhaite découvrir de nouvelles formes de vie dans l’espoir de révolutionner la médecine et, à terme, de remarcher (ou au moins d’offrir cette possibilité aux futurs handicapés). Impossible, alors, de ne pas penser à la synthèse que Brian Stableford propose avec son essai The Cosmic Horror, dans l’ouvrage Icons of Horror and the Supernatural :
« La fiction lovecraftienne est, par essence, une fiction dans laquelle l’horreur émerge d’une connaissance que l’on ne devrait pas posséder. Ce savoir ultime provient en effet d’espaces incompréhensibles, et son horreur n’est pas liée aux maux superficiels de l’existence humaine. Il s’agit ‘‘d’assauts du chaos’’, et non de simples apparitions ou fantômes. »
Incapable de se soumettre aux phénomènes naturels qui contredisent son dessein (Calvin, encore inoffensif, entre en hibernation après quelques jours de croissance), Derry force la créature à se réveiller en lui assénant plusieurs chocs électriques, ce qui déclenche la chaîne d’événements destructeurs subséquents. Life repose donc sur une idée devenue assez rare aujourd’hui, qui met en garde contre la recherche de bonds abrupts dans l’évolution humaine et le manque de maturité de notre espèce, qui voudrait devenir ce qu’elle n’est pas. Loin toutefois d’être un film anti-exploration, il peut être vu comme pro-évolution humaine avant tout, défenseur d’une exploration prudente. Espinosa démontre avec son film que dans l’espace, ce qui est humain est périssable ; et ce qui est immortel n’est pas humain. Si l’homme ne cessera jamais de vouloir explorer le cosmos, il ne doit pas s’attendre à y trouver l’immortalité (à moins, peut-être, d’y laisser son humanité ?). Pour accepter cette réalité, les personnages et le spectateur doivent donc faire face à ce que l’on appelle une « horreur cosmique ». Pour citer à nouveau Stableford :
« Pour Lovecraft, […] les racines de la terreur cosmique sont très anciennes. Il en trouve les échos dans le folklore millénaire, et l’associe à un culte païen théorique de “vénérateurs nocturnes”, dont les “rites de fertilité révoltants” ont été occultés par des formes de religions plus organisées, et ce même avant que le Christianisme ne vienne conclure le processus. […] Sa thèse fondamentale admet que le progrès social et technologique, commencé aux temps anciens, a facilité la répression de la conscience liée au fait que le macrocosme dans lequel le microcosme humain existe est à la fois immense et dangereux, alors que nos ancêtres les plus reculés ne pouvaient échapper à cette compréhension. Lovecraft décrit toute forme de religion, qu’elle soit païenne (il mentionne spécifiquement le druidisme et le paganisme gréco-romain) ou chrétienne, comme faisant partie de ce mécanisme répressif : un déni calculé de l’atrocité primordiale de la vérité cosmique par le biais de l’invention et de l’invocation de dieux qui, sinon complètement bénins, peuvent être flattés et apaisés. Selon Lovecraft, les œuvres fantastiques modernes les plus artistiques et efficaces renvoient à une sensibilité plus ancienne, non en tant que croyance véritable, mais sous la forme d’une réponse esthétique. »
Cette définition de l’horreur cosmique conduit inéluctablement à opposer l’esprit humain à une réalité qui le dépasse totalement, or ce qui dépasse l’entendement rejoint, en philosophie de l’esthétisme, la supplantation de la beauté par le sublime. Dans son essai Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, le philosophe Edmund Burke (dont les théories opposées aux Lumières ont grandement influencé le développement du romantisme) explique que le sublime peut jaillir de situations impliquant, entre autres, des notions telles que le danger, la vacuité, les ténèbres, la solitude, le silence, l’immensité ou des épreuves insurmontables. Tant de notions associées à l’espace, dimension que l’homme rêve de dompter mais qu’il ne sait encore qu’effleurer. Il s’agit donc d’une sensation proche de l’émerveillement mais dont les retombées émotionnelles et anthropologiques sont symétriquement différentes. Celle-ci se retrouve dans ce que tout un chacun ressent face à l’immensité sidérale et, plus directement dans le film qui nous intéresse, par ce que ressent le biologiste Hugh Derry au début du film – et dans une moindre mesure ses collègues – vis-à-vis de Calvin).
Dans la fiction horrifique, ce recours au sublime face à l’insaisissable est compris par Maria Beville (dans son livre The Unnameable Monster in Literature and Film) comme « la représentation artistique de l’Autre absolu – une manifestation externe à la subjectivité personnelle et culturelle ». En d’autres termes, et contrairement aux autres monstres du corpus horrifique qui arborent nombre de motifs freudiens ou jungiens, la créature innommable (ou mal nommée dans le cas de Calvin) constitue une réalité indépendante à l’existence humaine, et la renvoie par conséquent à sa propre insignifiance. Life, comme toute horreur spatiale qui se respecte, repose sur la volonté de manifester une réalité qui échappe à l’humain à travers deux axes : l’exploration spatiale pour sonder l’inconnu, ainsi que son excroissance philosophique, à savoir l’expression sublime de l’horreur pour décrire l’ineffable. Calvin, dans son évolution partant de l’émerveillement et s’achevant avec l’annonciation d’une extinction planétaire, invoque donc le rapport de l’homme à son univers, et le met face à une réalité qu’il aurait, selon la théorie lovecraftienne, enfouie sous des couches successives de croyances (paganisme organisé, monothéisme, scientisme) depuis des millénaires.
Passés les incontournables du genre déjà cités en début d’article, seuls quelques titres viennent à l’esprit quand il s’agit d’horreur cosmique au cinéma. Même des productions tenant formellement la route comme Pandorum n’osent pas aborder réellement la problématique, et se cantonnent à une horreur psychologique de surface (les mutants du vaisseau représentant le reflet difforme de l’humanité propulsée si loin de son berceau). Event Horizon jouissait certes d’une idée absolument formidable, qui embrassait complètement le concept d’horreur cosmique, mais son exécution monotone en faisait un objet assez décevant. En outre, au-delà d’inévitables ressemblances mécaniques, le film d’Espinosa n’a donc que peu de liens thématiques avec le chef d’œuvre de Ridley Scott tant cité par la presse. Certes, les deux se déroulent dans l’espace et mettent en scène une créature extra-terrestre meurtrière, mais le système narratif dans lequel celles-ci évoluent – sans compter leur conclusion substantielle – ne pourraient être plus diamétralement opposés. Le premier, se projetant dans un avenir lointain et intangible, mettait en scène un groupe de transporteurs commerciaux luttant pour leur propre survie dans un environnement où tout se rapportait symboliquement à la problématique de l’intégrité humaine ; le second, inscrit dans une proximité temporelle palpable, s’intéresse à un groupe d’explorateurs et de scientifiques luttant bien plus pour la survie de leur espèce que pour leur personne.
Si la sublimation d’Alien était d’ordre sexuel, celle de Life n’est autre qu’ontologique, Espinosa substituant la dimension organique et viscérale de son modèle (qui subsiste toutefois dans le sadisme certain qui caractérise le sort des personnages) pour des considérations plus larges, moins directement saisissantes au niveau émotionnel mais tout à fait pertinentes sur le plan civilisationnel. En outre, fort rares demeurent les films qui ont su explorer les couloirs de l’horreur spatiale sans tomber dans l’amateurisme ou dévier dans un occultisme un peu opaque. Life, dans ses moments les plus réussis, s’impose comme une interprétation rationnalisée de l’effroi primal se cachant derrière l’émerveillement lié à la découverte de l’inconnu sidéral. Que son décor soit si proche de nous ne rend finalement son appréhension que plus immédiate.
*Sources :
Beville, Maria. The Unnameable Monster in Literature and Film. Routledge, 2013.
Stableford, Brian. « The Cosmic Horror » in Icons of Horror and the Supernatural (dir. S.T. Joshi). Greenwood Press, 2007.