Get Out : mémoire en fuite
Ne fuyez pas Get Out, incursion (et réussite) de Jordan Peele sur le terrain de l’épouvante à résonances historiques et sociologiques. Fut un temps où Anne Hathaway était considérée comme […]
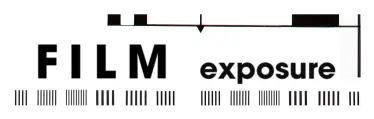 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Ne fuyez pas Get Out, incursion (et réussite) de Jordan Peele sur le terrain de l’épouvante à résonances historiques et sociologiques. Fut un temps où Anne Hathaway était considérée comme […]
 Ne fuyez pas Get Out, incursion (et réussite) de Jordan Peele sur le terrain de l’épouvante à résonances historiques et sociologiques.
Ne fuyez pas Get Out, incursion (et réussite) de Jordan Peele sur le terrain de l’épouvante à résonances historiques et sociologiques.
Fut un temps où Anne Hathaway était considérée comme une fille cool. L’ère Obama s’ouvre avec elle, dans Rachel Getting Married, en sœur turbulente de la mariée. Il y est (ou plutôt n’est même pas) question d’un mariage mixte, accepté comme une évidence par les deux familles invitées. En saris et musique du monde, Jonathan Demme célèbre un melting-pot. Au milieu d’une histoire familiale fracturée, où l’impardonnable génère culpabilité, rapports conflictuels ou fragilisés, l’union filmée apparaît comme un havre réconfortant, préservé. Quelques années ont passé. L’Internet, du haut de la sagesse infinie de sa masse de haters poussant souvent le courage jusqu’à l’anonymat, a décrété Hathaway un objet approprié de calomnie gratuite. Rayon ligne vestimentaire il est moins question de costumes traditionnels que de la nécessité ressentie par de nombreux afro-américains de s’habiller comme pour se rendre à un entretien d’embauche au moment de mettre les pieds dans une gare ou un aéroport. Les moins chagrins des esprits n’oseraient parler d’un pays « post-racial » en prenant en compte un contexte (ou leur meilleure conscience le concernant) où il compte parmi les possibilités quotidiennes pour une personne noire de se prendre une balle de dos dans la rue du simple fait de sa couleur de peau. Période coïncidant par ailleurs avec une montée du fascisme, des autocrates aux doux relents de suprématie blanche. Get Out, carton comme Jason Blum sait si bien les flairer (le prendre comme un compliment), film au postulat digne d’une fiction d’arrière-garde à la Devine qui vient dîner ?, traitant sur un mode emphatique des horreurs contenues dès les micro-agressions, dont la réplique la plus drôle serait probablement « they [my parents] are not racists », arrive à point nommé. Le film de Jordan Peele est aussi « daté » que celui de Demme ne l’est, ce qui est à leur honneur respectif. Ils incarnent tous deux un moment symétrique de l’Amérique. Le problème étant l’ordre dans lequel ils apparaissent.
Chris Washington (Daniel Kaluuya) est un jeune photographe. Son talent et le développement de son œil s’avèreront essentiels pour l’intrigue. Ce qui amorce son départ vers le Sud, à la rencontre de sa belle-famille, est une anxiété ressentie par Jordan Peele avant une rencontre de ce type : savent-ils qu’il est noir ? Rose (Allison Williams), son amie de quatre ou cinq mois, n’estime pas important de les « prévenir » (ils ont voté deux fois pour Obama !), Chris préfèrerait qu’ils le sachent par avance. Le film jouera à plusieurs reprises d’incompréhensions pas si mineures : face à un interrogatoire policier tendancieux à l’égard de son homme, son réflexe est de faire une scène, le sien de faire à tout prix profil bas. Arrivé sur place, il rencontre les parents (Bradley Whitford / Catherine Keener), le père n’attendant pas cinq minutes pour lui expliquer pour qui il a voté deux fois et son goût des « cultures étrangères » en lui exhibant des statuts ramenées de Bali. Durant une journée faite de commentaires incongrus dont il lui revient de décider de la charge de naïveté ou d’insulte, il remarque leurs deux domestiques, un jardinier et une bonne. Ce qui le surprend n’est pas leur ethnicité, mais leur attitude : mécanique, exsangue, dévitalisée, porteuse, à moins qu’il ne soit paranoïaque, d’une profonde hostilité derrière les sourires plaqués (celui grimacier, en plus d’un regard écarquillé, du premier forment une allusion inconfortable à l’imagerie des minstrel shows). Psychiatre pratiquant l’hypnose, la mère de Rose l’enjoint, pour l’aider à arrêter la cigarette, à se laisser hypnotiser par elle. Chris, très mal à l’aise avec cette idée, finit par accepter. La réaction au téléphone de son meilleur ami Rod (LilRel Howery), à la mention de cet incident atteste que ce malaise est partagé, une peur commune de laisser « quelqu’un d’autre », sans mentionner une belle-mère wasp, entrer dans sa tête à sa guise. Le lendemain, une étrange réunion est donnée par les Armitage. Chris voit le piège se refermer sur lui.
Le cœur thématique de Get Out est la mémoire de l’esclavage. Comment ce qui paraîtra innocent à des non-concernés peut être vécu comme la réminiscence d’un avilissement, comment le sens d’une oppression non seulement physique mais spirituelle, passant par la négation de l’esprit d’une autre personne, l’usage de sa stricte force physique, est nié, refoulé, par la culture américaine. Un film fantastique où les bourgeois caucasiens empressés de se montrer bien-intentionnés – et de s’en auto-congratuler – paraissent, sous un certain angle, plus inquiétants encore que les flics racistes. Ce dont il est question est une acculturation : pour accéder à une certaine place dans la société, un jeune homme noir doit faire la preuve que rien ou presque ne le relie à une communauté. Ce n’est pas qu’un film sur le racisme, mais sur les classes sociales, la perpétuation, de générations en générations, d’une inégalité foncière. Sur un jeu de dupes où à l’obligation de nier son milieu d’origine pour une partie, répond le droit de toujours le rappeler à cette même personne pour l’autre. Dans une métaphore audacieuse, le personnage le plus trompeur du film est celui qui est, littéralement, aveugle à la couleur. L’intégration, en réalité la mise au service, passe ici par l’oubli d’un héritage, le consentement à taire la douleur, partagée avec une communauté, que la classe possédante d’un pays refuse d’accepter comme intelligible – elle a fait, fait encore, sa fortune sur celle-ci.
Chris se fait avoir, pas son ami Rod, pourtant initialement présenté comme un personnage plus stéréotypé… De fait, lui a un meilleur instinct de ce qui est en train de se passer, ses sarcasmes bourrus révèlent un bon sens qui fera finalement ses preuves. Il a une mémoire consciente à disposition, la même que Chris subit du tréfonds de lui-même sans la comprendre. Un autre succès Blumhouse récent opère sur ce renversement – un personnage communément admis comme le moins adapté se montre le plus à même de se tirer, lui et les autres, d’affaires. Split envisage la possibilité (séduisante mais douteuse) que face à un mal radical, une personne ayant fait dès l’enfance l’expérience de l’abus et de l’exclusion, sache mieux comment réagir que des personnes choyées, éduquées avec une estime d’elle-même. Shyamalan développe une hypothèse à la fois droitière, confuse, et vivement sensible au climat public présent, où les agents libéraux ayant intégré le respect de soi et la communication non-violente se révèlent parfaitement dépassés par la Bête. Les deux films, quoiqu’à des spectres politiques opposés, traitent d’une même faillite de l’establishment (inepte chez Shyamalan, complice chez Peele). Leur succès, proche aux États-Unis dans les deux cas du phénomène de société, puise à la même source rageuse et angoissée.
Il peut paraître surprenant qu’il incombe à un membre du duo d’humoristes Key & Peele, apparus ensemble au cinéma dans une aimable pochade à base de chaton égaré, de s’imposer en un premier long-métrage, à la fois comme un maître du fantastique que Blum (redoutable chasseur de talents) a déjà signé pour quatre ou cinq films d’horreur à base de postulats sociaux, et comme nouveau chouchou de la critique. Keanu traitait cependant déjà d’un malaise identitaire, tandis que les sketchs de Peele et Keegan-Michael Key révèlent un regard de satiristes tendant à l’inquiétante étrangeté ici continuée. Get Out fait souvent rire, sa scène la plus réussie (sans trop en révéler : le meilleur ami se rend à la police expliquer, à peu de choses près, ce qui se trame) est une pure plaisanterie. Le modèle avéré de Peele, Rosemary’s Baby, œuvre séminale de l’horreur avec protagoniste en état de minorité, situation d’aliénation où le moindre sourire paraît couver une menace, la politesse même vernir une entreprise carnassière, est de même un film où la peur le dispute à l’amusement, en un précipité instable, se ravivant mutuellement. On pense aussi, forcément, aux Femmes de Stepford, tandis que le final convoque celui de La Nuit des Morts-Vivants, pour lui préférer une issue plus libératrice.
Il mérite éventuellement d’être mentionné que le film s’est vu pris à parti pour une pratique courante dans le cinéma américain de ces dernières années : Samuel L. Jackson, pointant le cas de Daniel Kaluuya, regrettait l’habitude, dans des films de studios, d’engager des acteurs britanniques pour jouer des afro-américains. (D’un côté, le souci de voir des comédiens d’un autre pays pris pour ces rôles peut se comprendre, dans un contexte où les acteurs appartenant à la catégorie concernée sont souvent sous-employés. D’un autre, il est très envisageable que l’expérience d’être noir en Angleterre ne diffère pas suffisamment de celle américaine pour barrer l’accès à une interprétation convaincante. En l’occurrence, Kaluuya ne paraît nullement maniéré… plutôt d’une neutralité servant parfaitement la vision du film.) Tous ces points ayant déjà été discutés (pour qui lit la critique US, rien de ce qui n’est mentionné ci-dessus ne sera nouveau sous le soleil), autant finir par ce qui compte : Get Out augmente encore d’un cran l’excellence Blumhouse, maison de production où se logent les cinéastes désireux, alors qu’ils font du divertissement visant un public adolescent, de conserver leur liberté de mouvement. Que la critique ou le public lâchent Peele, ou le suivent, par la suite, gageons qu’il ne saura que trop bien quoi faire de cette possibilité créative. De même qu’Anne Hathaway n’a jamais cessé d’être cool, que l’horreur et la comédie réapparaissent comme les phares dans l’obscurité qu’ils ont toujours été.
1 commentaire »