Wonder Woman : quand les merveilles deviennent banales
La volonté de bien faire n’est pas forcément synonyme de réussite artistique. Wonder Woman le prouve en se révélant être un échec presque total.
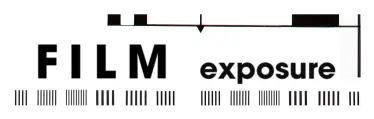 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
La volonté de bien faire n’est pas forcément synonyme de réussite artistique. Wonder Woman le prouve en se révélant être un échec presque total.
 Sur Themyscira, une île peuplée d’Amazones coupées du monde depuis des millénaires, la jeune Diana, fille de la reine Hippolyta, rêve de devenir une grande guerrière. Le destin lui tend la main lorsqu’au crépuscule de la Première Guerre mondiale, l’espion américain Steve Trevor s’écrase dans les eaux immaculées de leur nation insulaire. Repartant avec le militaire pour l’Europe, Diana, découvre les vices habitant le monde des hommes, et tente de mettre un terme à la guerre la plus destructrice ayant jamais ravagé la planète. Elle soupçonne cependant qu’une force maléfique tire en secret les ficelles des généraux…
Sur Themyscira, une île peuplée d’Amazones coupées du monde depuis des millénaires, la jeune Diana, fille de la reine Hippolyta, rêve de devenir une grande guerrière. Le destin lui tend la main lorsqu’au crépuscule de la Première Guerre mondiale, l’espion américain Steve Trevor s’écrase dans les eaux immaculées de leur nation insulaire. Repartant avec le militaire pour l’Europe, Diana, découvre les vices habitant le monde des hommes, et tente de mettre un terme à la guerre la plus destructrice ayant jamais ravagé la planète. Elle soupçonne cependant qu’une force maléfique tire en secret les ficelles des généraux…
Soixante-seize ans après ses débuts dans les pages de Sensation Comics, la super-héroïne Wonder Woman, devenue la plus célèbre dans son genre, occupe la tête d’affiche d’un film de cinéma qui lui est entièrement consacré. L’Amazone était bien sûr apparue dans le précédent film de la Warner inspiré des comics DC, Batman v Superman: Dawn of Justice, mais s’était surtout inscrite dans la culture populaire grâce à la célèbre série télévisée menée par Lynda Carter, qui a vu le jour suite à l’échec cuisant d’une ridicule sitcom inspirée du personnage et d’un téléfilm à mi-chemin entre l’enquête policière de pacotille et la comédie. Elle est également apparue dans nombre de séries et films d’animation (dont un, plutôt réussi, lui étant consacré) depuis les années 1970 jusqu’à nos jours.
L’adaptation d’un tel personnage n’est pas chose aisée, et ce pour plusieurs raisons. En effet, le matériau d’origine ayant très mal vieilli (les dessins de l’illustrateur H.G. Peter sont statiques et manquent de détails, tandis que les histoires se présentent invariablement sous la forme de sermons), il convient de se tourner vers les comics subséquents pour trouver des traitements véritablement efficaces. Nouveau problème : le personnage ne bénéficie d’aucune œuvre incontournable ou définitive, comme c’est le cas de ses homologues masculins (voir For All Seasons, All Star, Kingdom Come, Birthright ou Secret Identity pour Superman, et Year One, The Dark Knight Returns, Year 100, Killing Joke ou Ego chez Batman).
Certes, quelques auteurs ont signé des runs honorables avec Wonder Woman, notamment George Pérez, Greg Rucka et Gail Simone, mais aucun d’entre eux n’atteint les paroxysmes de mythologisation dont ont bénéficié d’autres héros, ce qui est d’autant plus étonnant que son univers est directement lié au panthéon grec, et surtout aucun n’a été vécu par l’industrie des comics comme un véritable événement redessinant les frontières formelles, substantielles ou commerciales du personnage. La plupart du temps, l’héroïne a même souffert sous la plume d’auteurs qui ne savaient pas quoi faire d’elle, à l’instar de Robert Kanigher, éditeur du titre de 1946 à 1968 (!), puis à nouveau au début des années 1970, qui en fait la secrétaire de la Justice League, ou du tandem Dennis O’Neil/Mike Sekowsky, responsable de sa réinterprétation à la sauce Chapeau Melon et Bottes de cuir. À vrai dire, même les scénaristes les plus doués, comme Simone, n’échappent parfois pas au piège des symbolismes grossiers et grotesques (on se remémore avec douleur le subtile personnage de Genocide).
Quant aux histoires de William Moulton Marston, celles-ci étaient pensées, de son propre aveu, comme « de la propagande psychologique en faveur de la femme de demain qui, j’en suis convaincu, dirigera le monde ». Ce proto-féministe, déjà connu pour avoir contribué à l’invention du détecteur de mensonges, injectera donc à toutes ses bandes dessinées des sous-textes ayant trait au viol et à la soumission féminine, dont son héroïne se libère sans cesse, mois après mois.
Avec un tel historique, l’équipe du film se devait donc de trouver un équilibre n’aliénant ni ceux qui voient en Wonder Woman un emblème féministe immuable, ni les autres. Il s’agissait de créer un personnage plus fort que celui du Golden Age sous Kanigher, sans tomber dans la caricature à la Frank Miller dans All Star Batman and Robin (où Diana entre en scène en lançant « Out of my way, sperm bank » à un passant). L’actrice Gal Gadot abondait récemment dans ce sens, déclarant qu’il était « important pour moi que mon personnage ne vienne pas sermonner le public sur la façon qu’ont les hommes de traiter les femmes, ni sur la manière dont les femmes se perçoivent elles-mêmes ». De ce point de vue, le film s’en sort honorablement, octroyant un fort pouvoir décisionnel à sa protagoniste et faisant d’elle un leader indéniable, mais jamais au détriment des autres personnages. Guidée par Steve Trevor dans un monde qu’elle ne connait pas, elle défie ses directives à de multiples reprises (dans la ruelle londonienne, dans la tranchée, avant le gala allemand, puis lors du climax), sans toutefois faire passer ses acolytes pour des incapables.
Malgré cette approche tonale équilibrée dans ses relations interpersonnelles, le film souffre d’une écriture terne et conventionnelle qui transforme le récit en exercice mécanique et laborieux, passant d’un poncif imposé par le genre à l’autre sans le moindre panache. Il s’agit exactement du même film que Marvel a déjà confectionné une demi-dizaine de fois, et que d’autres auteurs avaient exploré de fond en comble au début des années 2000. L’exposition, toute teintée de mythologie grecque soit-elle, se révèle anecdotique, passant en quelques secondes sur le fait que le monde et les humains auraient été créés par un dieu étant depuis décédé (reformulons : « Dieu » est donc mort mais ce n’est plus qu’une arrière-pensée… s’il ne s’agit pas là d’un détail cosmogonique de premier ordre, alors rien ne peut avoir d’importance dans ce monde) ; l’intrigue, lente et inutilement sinueuse, perd son temps à Londres au profit de quelques blagues alors que la définition d’un personnage dans l’action appelait à l’envoyer directement sur le front ; les antagonistes, enfin, relèvent de clichés embarrassants figés dans un traitement manichéen honteux, à tel point que c’est tout juste si l’affrontement final ne se fait pas à grands coups de roulements de moustache. Il faut dire que le personnage souffre d’un cruel manque d’adversaires iconiques dans les comics. Le film finit par mettre en avant le moins ridicule, hélas desservi par un acteur en roue libre totale.
Cependant, le plus grand mal dont souffre le film est sa réalisation. Patty Jenkins, à l’aise derrière la caméra d’un drame indé tel que Monster, perd ici tous ses moyens ou cède le pas à la seconde équipe de yes-men placés par le studio et chargés d’inscrire le film dans la continuité formelle des travaux de Zack Snyder. Ainsi dès que l’action s’emballe quelque peu, les plans se raccourcissent inexplicablement, ne laissant jamais les acteurs s’imposer comme des combattants convaincants. La caméra, portée, tente de donner un sens d’immédiateté naturaliste aux affrontements, brouillant un peu plus les scènes concernées. Les ralentis, enfin, sont omniprésents. Pas que le procédé en lui-même soit injustifiable, mais sa surutilisation revient à insister sur toutes les scènes, retirant ainsi sa valeur exceptionnelle à la figure de style. En résulte un visionnage pénible, similaire à la lecture d’un roman où une phrase sur trois serait écrite en majuscules.
Au-delà de ces choix de mise en scène discutables, la musique de Rupert Gregson-Williams devient vite redondate et banale dans son respect du style imposé par Hans Zimmer, alors que Christopher Drake avait justement réussi à réunir super-héroïsme et mythologie dans son thème pour la version animée. Le long-métrage présente en outre des effets visuels à la qualité fluctuante, passant de la norme hollywoodienne au ratage incompréhensible (quelques plans à cheval sur Themyscira, les accélérés du combat final, etc.). La direction artistique, quant à elle, s’avère séduisante en début de métrage, lorsque la terre des Amazones est dépeinte de façon luxuriante, habitée d’animaux fantastiques. Sa schizophrénie se révèle cependant au grand jour lorsque le film entame son dernier virage, rejoignant la palette visuelle lugubre de Man of Steel et de ses suites. On regrettera que l’équipe du film ne se soit pas plus inspirée des divers artistes de qualité ayant officié sur la série au cours des décennies : la densité graphique des compositions de George Pérez est totalement absente, l’énergie brute et épurée de David Chiang ignorée, le style imposant et pourtant iconique de Yanick Paquette oublié, et ainsi de suite. Reste cette photographique morne qui sied sans doute à Batman mais surement pas à Wonder Woman, en tout cas pas à celle que les scénaristes tentent de nous faire accepter.
Attention : le texte qui suit révèle des éléments clés de l’intrigue. Il est fortement conseillé d’avoir vu le film avant d’en continuer la lecture.
Cette Wonder Woman, c’est l’héroïne solaire, naïve et bienfaisante qui a presque toujours habité les comics. La question ne se réduit absolument pas à la question de la force létale, Diana ayant tué de très nombreuses fois dans sa version papier lorsque la situation le justifiait, mais va au-delà : dans son rapport au monde, sa vision de celui-ci et l’espoir qu’elle porte en lui. Si le Superman de Zack Snyder avait tant causé polémique chez les amateurs de super-héros, c’est parce que le réalisateur travaille dans un cadre ouvertement randien (il a d’ailleurs affirmé plancher sur une adaptation de The Fountainhead), qui repositionne un personnage né et développé dans une idéologie socialo-populiste vers des considérations tantôt objectivistes, tantôt nietzschéennes. Le problème ne se pose pas en termes de légitimité (les artistes font bien ce qu’ils veulent), mais se comprend aisément en termes de perception idéologique. Opérer un glissement similaire avec Wonder Woman aurait probablement semblé encore plus décalé, elle qui incarne la foi en l’amour absolu comme solution aux maux rongeant l’humanité. Si cette notion de l’amour salvateur est conservée dans le film (Brian Azzarello en avait articulé un exemple parlant dans son run), elle vient malheureusement s’écraser contre la forme même de l’œuvre, qui n’épouse jamais son propos, enfermée dans un carcan esthétique dicté par une continuité inter-films abstraite et pour laquelle on ne se passionne guère.

Une autre caractéristique essentielle du personnage est toutefois contournée. Probablement réticent à aborder l’un des aspects les plus notoires des comics, à savoir le thème du bondage, le scénario ne montrera jamais Diana subjuguée par les chaînes d’un pouvoir supérieur, position dans laquelle elle se retrouvait dans quasiment tous les numéros écrits par son créateur, et reprise depuis par nombre d’auteurs. L’héroïne se retrouve bien cloisonnée entre des plaques de métal lors du dénouement, mais la situation ne recèle alors plus aucun sous-texte symbolique. Les scénaristes préfèrent donc inverser les rôles, soumettant le pilote américain Steve Trevor au lasso de la vérité des Amazones. Interrogé, l’homme tente d’y résister mais succombe à son pouvoir en gémissant à plusieurs reprises comme s’il ressentait une vive jouissance physique, avant de leur révéler les informations convoitées. Si la scène fonctionne bien sur un ton humoristique, cette interprétation laisse penser que l’équipe créative ne comprend pas la force pourtant considérable associée à l’image d’une femme puissante enchaînée, qui se défait ensuite de ses liens. Comme l’explique Noah Berlatsky dans son livre consacré aux comics de Wonder Woman :
« La lutte n’est pas nécessairement synonyme de liberté, du moins pas immédiatement. Avant d’être libre, on ne l’est pas. En d’autres termes, la femme ne peut se libérer de ses liens sans être d’abord subjuguée, avec toutes les connotations que cela peut avoir. Wonder Woman ne peut pas briser ses chaînes si elle n’est pas d’abord enchaînée. »
Que conclure alors de cette inversion des rôles ? Wonder Woman, unique chez les siens et étrangère en dehors de son île, n’a-t-elle pas besoin de se défaire de liens quelconques ? Les hommes, incarnés par Steve Trevor, sont-ils des victimes, subjugués au pouvoir des femmes ? La réponse, bien sûr, est non. Mais ce clin d’œil mal habile aux comics du Golden Age démontre bien que la métaphore en question a échappé aux scénaristes. Pour un film Wonder Woman souhaitant muter en événement sinon féministe, au moins égalitariste, il s’agit là d’une omission impardonnable.
Il convient enfin de revenir une dernière fois sur la question de l’antagoniste, qui se révèle donc être le dieu de la guerre Arès en fin de métrage. En plus du problème d’interprétation mentionné précédemment, l’écriture n’arrive jamais à rendre ce dernier menaçant ou intriguant. Il semble que les adaptations de comics Marvel et DC commencent à s’enfermer dans un stéréotype bien précis, ayant trait au nihilisme : dans Wonder Woman, comme dans Guardians of the Galaxy vol. 2, Avengers: Age of Ultron, Suicide Squad ou Man of Steel, l’objectif de l’antagoniste revient tout simplement à éradiquer les êtres humains de la surface de la Terre, souhaitant restaurer la planète/l’univers à sa grandeur passée ou en améliorer le sort. Non seulement le poncif commence à être usé, mais il est en plus trop impersonnel pour avoir un véritable impact dramaturgique. Pérez l’avait bien compris, et avait par conséquent fait d’Arès un dieu ayant besoin de la soumission des hommes par la peur pour survivre. Son oubli par les êtres humains entrainerait sa disparition, et toutes ses machinations visant à encourager les guerres se justifient alors dans sa volonté fondamentale de survie, ce qui ne peut pas lui être reproché. Aucune nuance n’existe dans le nouveau film : l’héroïne affirme ne jamais pouvoir abonder dans le sens de la déité, avant d’engager un combat ennuyeux à mourir.

Wonder Woman n’est donc ni le premier film de super-héroïne à sortir au cinéma, ni le premier film de super-héros réalisé par une femme. Il s’agit bien, certes, du premier blockbuster américain de super-héroïne réalisé par une femme. Cela aura-t-il un impact sur l’industrie ou une importance dans la mouvance féministe ? On laissera les gens intéressés en débattre (par exemple, ici ou là). Reste que le film est un échec artistique presque total, un produit obtenu en suivant à la lettre une équation narrative usée, sans doute parsemé de bonne volonté et d’idées pertinentes, mais handicapé par une écriture laborieuse et une réalisation incapable d’accompagner organiquement son propos. À trop vouloir normaliser les merveilles, celles-ci deviennent ordinaires. Si c’est ça, la formule gagnante des héros DC au cinéma, alors ces derniers peuvent rejoindre leurs rivaux dans notre indifférence.
*Sources :
Berlatsky, Noah. Wonder Woman: Bondage and Feminism in the Marston/Peter Comics, 1941-1948. Rutgers University Press (2015).
3 commentaires »