Locarno 2018 — First Reformed : le grand dans le petit
Quel drôle de chemin il aura fallu parcourir à Paul Schrader pour arriver à une œuvre au minimalisme grandiose, traitant d’espérance et de désespérance sur fond de désastre écologique.
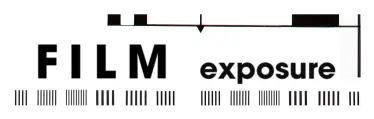 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Quel drôle de chemin il aura fallu parcourir à Paul Schrader pour arriver à une œuvre au minimalisme grandiose, traitant d’espérance et de désespérance sur fond de désastre écologique.
Invité de l’édition 2018 du Festival de Locarno, Ethan Hawke (lire notre interview ici) y présentait dans sa rétrospective personnelle l’un de ses rôles récents : celui d’un pasteur contradictoire dans First Reformed (2017), dernier film de Paul Schrader qui lui tenait de toute évidence à cœur. Grand bien lui prenne, tant le film mérite cette chaleureuse estime. À 76 ans ans, Paul Schrader réalise ce qui en un sens aurait dû, mais en un autre n’aurait pu, être son premier film : un petit budget constituant une contribution à ce qu’il appelle le cinéma « transcendantal », celui questionnant, de Bresson et Dreyer à Alonso, la manière dominante de voir et de faire du cinéma, préférant une position active, serait-ce dans la contemplation, à la passivité de schémas spectaculaires. Avec comme idéal une capacité de la mise en scène à donner à ressentir une aspiration spirituelle. Quel drôle de chemin il lui aura fallu parcourir pour arriver à une oeuvre au minimalisme grandiose, traitant d’espérance et de désespérance sur fond de désastre écologique. Un « petit film » où le cinéaste, aussi peu farouche devant le sublime qu’il peut se le montrer face à ce qui l’indigne, n’esquive ni une grande forme, ni de grands thèmes.
Une petite ville neigeuse moins isolée, mais pas moins apathique, que celle froide d’Affliction. Ernst Toller (Ethan Hawke) est le révérend d’une modeste communauté calviniste dans les hauts de l’état de New York. L’Eglise de First Reformed a essentiellement valeur de halte historico-touristique, ayant été un lieu de passage des chemins de fers clandestins, qui menaient les fuyards du Sud vers leur libération au Nord. En des termes différents, la question de la justice sociale viendra à se poser pour ce pasteur, ainsi que celle de la désobéissance civile. Mary (Amanda Seyfried), nouvelle membre occasionnelle de sa congrégation intercède en la faveur de son compagnon Michael (Philip Etinger), un activiste vert récemment libéré d’une peine de prison. La jeune femme, enceinte, se heurte à la volonté de sa moitié incroyante de ne pas garder l’enfant. En plus de s’inquiéter de son moral, elle souhaite que le pasteur plaide auprès de lui en la défaveur d’un avortement. Le religieux fait la connaissance d’un homme affable, rationnel, quoique montrant des signes visibles de dépression. Celui-ci, ayant dévolu sa vie à la lutte contre le réchauffement climatique, lui présente un argumentaire simple : l’humanité avait selon les estimations jusqu’à 2015 pour, sinon arrêter, du moins freiner dans des mesures impérieuses le processus de réchauffement de la planète et ses conséquences prédictibles. Nous sommes alors en 2017 (année où les États-Unis se retirent des accords de Paris) et rien ou presque n’a été fait. La montée de la température du globe dans des proportions graves pour l’humanité fait le consensus scientifique. Elle est irréversible. Michael énumère les désastres qui peuvent être attendus d’ici 2050 et en conclut qu’il ne veut pas accompagner l’apparition d’une vie humaine dans cet environnement. Que se sentant, au même titre que tout un chacun, indirectement responsable de l’état des choses, il n’ose s’en présenter comme responsable devant le juge que représenterait une nouvelle génération (cette question de la responsabilité pourrait valoir, sur un plan citoyen, dans un temps partagé : le Bangladesh paye désormais pour des décisions prises pour la plupart au Nord). Il formule pour Ernst se qui deviendra sa propre question théologique : Dieu nous pardonnera-t-Il d’avoir détruit notre planète ? Contre la désespérance, appuyée sur des faits, de ce réfractaire, le pasteur répond avec une passion, une véhémence émotive, qui trahissent que cette désespérance est, dans le fond, aussi la sienne. L’homme a perdu un fils en Iraq, après l’avoir en sa qualité d’aumônier militaire encouragé à accomplir un service, ce qui lui a coûté son mariage. Déniaisé d’un patriotisme nourri à l’assurance de compter parmi les élus, il boit plus que de raison quand laissé à lui-même. Il se prend de l’immédiate obsession de sauver ce cadet de son absence d’espoir, quand bien même elle serait un écho inconscient de la sienne… de sa propre rage impuissante face au culte auto-destructeur de la prospérité qu’ont accepté d’autres fidèles, face à ses propres manquements idéologiques passés. Mais, après avoir découvert le matériel explosif que le radical cachait pour un éventuel attentat suicide et n’en avoir rien dénoncé à des autorités supérieures, il est celui qui dénichera bientôt son corps de suicidé, échouant à ce sauvetage.
La crise que cet accident provoque en lui, le trauma qu’il lui faut dès lors dépasser, se redouble d’échos socio-économiques. First Reformed appartient à une plus large communauté d’églises, la bien-nommée Abundant Life, gérée par le révérend Jeffers (Cedric the Entertainer), dont le siège clinquant compte cinq mille places et un intérieur digne de la Philarmonie de Berlin. Or ce faste abondant, comme le salaire du petit pasteur et le budget de sa propre aile, sont en grandes parties financés par un grand groupe pollueur installé dans la région, cible principale du disparu (c’est devant un site saccagé par les activités de cette multinationale qu’il a demandé une cérémonie mortuaire). L’Église protestante, avec cet accent sur la prospérité comme bénédiction divine que le pasteur constate un échange sur deux avec d’autres croyants, ne s’est pas exactement beaucoup souciée d’écologie. Le désagrément du révérend se heurte bien vite aux allégeances objectives de son, du reste empathique et bien intentionné, conseilleur supérieur. À partir de cette trame, Paul Schrader tresse un film métaphysique, politique, qui, tout en creusant le sillon des hommes obsessionnels qu’il explore depuis le scénario de Taxi Driver (voir comment il a perfectionné depuis la méthode consistant à faire se contredire une voix-off et son illustration visuelle), s’autorise une incursion vers le cinéma « transcendantal » que, bien qu’admirateur des tenants du style depuis ses débuts, il n’avait pas encore abordé de front. Tel était pourtant à bien des égards le programme de son cinéma, œuvre entamée -comme celle de son ami Scorsese- en lieu et place d’endosser une soutane (Schrader, d’éducation calviniste, se destinant jusqu’alors à une vocation de pasteur). Cette manière de boucler la boucle en fait à la fois le film d’un vieil homme, cinéaste aguerri qu’il est, et du jeune homme qu’il a été, quand il n’aurait osé réaliser ce film (préférant au cinéma contemplatif les rives du film noir). De l’extrême étirement jusqu’au point de rencontre de ces deux pôles, il tire une œuvre dialectique, dont le recueillement prépare l’aberration finale (mieux vaut ne rien révéler de l’intrigue concernant sa deuxième moitié), qui de sa propre rétention, une admirable mais dangereuse manie de la maîtrise blanche, se protège soi-même par une paradoxale fragilité. Le cheap (Schrader assume d’être revenu à des budgets très serrés), la proximité du kitsch, tant le sublime qu’il vise est indissociable du risque du ridicule, nécessairement sur la corde raide, alliés à un regard sûr, un propos implacable, un métier au sens le plus noble du terme, aboutissent à une émotion authentique. C’est ce qui fait l’étoffe d’un vieux maître : se permettre ce qu’il ne se serait pas même permis au temps d’être un jeune homme énervé. First Reformed est un film plein de sagesse et de colère, un cri raisonné du cœur face à une époque désespérée.
La sensibilité apocalyptique d’un artiste calviniste trouve un écho en quelque sorte trop beau pour être vrai dans l’inéluctabilité terrifiante du réchauffement climatique. Bien que Schrader n’invente rien à l’égard de cette catastrophe en marche, il aurait pu trouver une autre cause pour donner voix à son pessimisme dépressif si cette dernière avait été évitée ou amenuisée à temps. Son film traite, dans ce contexte lugubre pour l’espèce humaine, de la notion même d’espérance, ou de son absence. Ce faisant, il éclaire d’un jour mythologique (ce qui ne signifie pas faux) une désespérance collective, celle qui touche tant des environnementalistes résignés à ce que la lutte ne consiste plus qu’à sauver les meubles (chaque demi-degré altéré compte pour des centaines de milliers de vie autour du globe) qu’au déni quotidien consistant à préférer ne pas y penser. Son film entérine un moment historique : celui où le « ça finira par arriver » se voit remplacé par un « c’est déjà en train de se passer ». Le contexte est nouveau, fondamentalement contemporain, la question de l’espérance est, elle, aussi vieille que l’humanité confrontée à diverses formes d’hostilité. Autant dire que le cinéaste ne fuit pas la notion de grand thème, fonce au contraire tête baissée, avec une grande forme, se coltiner un grand sujet. Et il le fait avec un « petit » film. Cinéphile de première catégorie, Schrader sait où il se situe par rapport à d’autres influences. First Reformed, avec ses quelques stars, ses logos d’ouverture, une distribution viable en salles (pas en Suisse : il ne faudrait pas non plus espérer au-delà du raisonnable), demeure un film commercial. C’est pourtant ici à la limite de ce créneau que le cinéaste se situe et vers son dehors qu’il regarde. Lui qui a depuis toujours fait des films « d’homme dans une pièce » (de femme, dans le cas de Patty Hearst), reprenant sa description du Journal d’un Curé de Campagne de Bresson pour expliciter son propre programme : explorer sans relâche des formes de solitude reflétant la sienne. À l’influence très nette du film de Bresson sur le sien, s’ajoutent celles des Communiants de Bergman, du Dreyer tardif, de Tarkovski (hommage par une scène de lévitation ne cessant, une fois commencée un envol étonnamment sensuel, de rebondir vers d’autres horizons, des visions qui en deviendraient risibles si l’urgence de l’abandon de deux personnes l’une à l’autre, ne les rendaient terribles dans leur pauvreté même, ce précaire et humain besoin de contact devant l’abysse, d’évasion de soi en l’autre). Il est également au fait de ce que le cinéma contemplatif accomplit aujourd’hui, de comment peut se regarder la nature, de l’intransigeance esthétique consistant à désamorcer la direction du spectateur en le livrant à l’écoulement du temps, dans les extensions modernistes de Lisandro Alonso ou James Benning. Tout comme il crédite l’Ida de Pawel Pawlikowski pour lui avoir donné la foi de faire son propre film religieux (First Reformed étant du reste tout à fait supérieur à cette inspiration heureuse). Seule dévotion de ce représentant du doute, qui a fait du cinéma le lieu où se recueillir, recevoir ses épiphanies, retrouver une espérance, même vacillante, en l’avenir de l’humanité. La simplicité des derniers instants tutoie une folle ambition, une volonté féroce, nullement apaisée, de se confronter au besoin de transcendance, à la condition humaine dans ce qu’elle a de plus clivé. Ici Schrader ne lâche rien, en fanatique que se doit d’être un ascète cinéphile. Plus d’excuses à fournir à cette recherche fictionnelle d’un absolu, plus d’ornements de genre venant atténuer sa rigueur formelle et intellectuelle : sa sécheresse entend déboucher sur le cosmique. La teneur de sa conclusion pourrait pourtant être murmurée : nous n’avons plus que l’un l’autre.
FIRST REFORMED
Réalisé par Paul Schrader
Avec Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric the Entertainer, Michael Gaston, Victoria Hill, Philip Ettinger
Sortie francophone annoncée en DTV pour le 25 septembre 2018
1 commentaire »