 Retenu à Séoul par la post-production de son prochain film, Parasite, le génial Bong Joon-ho n’a malheureusement pas pu faire le trajet jusqu’à Fribourg, comme cela était initialement prévu. Soucieux d’honorer malgré tout son invitation, le réalisateur a tenu à maintenir la discussion avec le public du FIFF, qui se tiendra le 19 mars par vidéo-conférence. Plutôt que de le rencontrer en chair et en os, nous avons de notre côté eu l’occasion d’échanger un long téléphone avec lui. De quoi évoquer les films qu’il a retenus dans sa carte blanche, son regard sur le cinéma coréen actuel, de revenir sur certains aspects de sa filmographie et d’évoquer son prochain film. Au bout du fil, une voix douce témoigne de la fascinante passion calme et de l’humilité du personnage.
Retenu à Séoul par la post-production de son prochain film, Parasite, le génial Bong Joon-ho n’a malheureusement pas pu faire le trajet jusqu’à Fribourg, comme cela était initialement prévu. Soucieux d’honorer malgré tout son invitation, le réalisateur a tenu à maintenir la discussion avec le public du FIFF, qui se tiendra le 19 mars par vidéo-conférence. Plutôt que de le rencontrer en chair et en os, nous avons de notre côté eu l’occasion d’échanger un long téléphone avec lui. De quoi évoquer les films qu’il a retenus dans sa carte blanche, son regard sur le cinéma coréen actuel, de revenir sur certains aspects de sa filmographie et d’évoquer son prochain film. Au bout du fil, une voix douce témoigne de la fascinante passion calme et de l’humilité du personnage.
Dix ans après votre venue en Suisse au Festival du Film Fantastique de Neuchâtel, où vous aviez choisi de montrer La Servante de Kim Ki-young, vous choisissez de montrer Transgression ici à Fribourg. Quel rapport entretenez-vous avec Kim Ki-young ?
Oh, vous savez donc que j’étais à Neuchâtel ! La Servante est certainement le film le plus célèbre de Kim Ki-young, alors que Transgression est nettement moins connu, surtout en dehors de la Corée. C’est pour cette raison que j’ai décidé de le montrer. La Servante est certainement le film le plus représentatif du travail de Kim Ki-young. Transgression est quant à lui un film très vif, dans son traitement presque grotesque des couleurs par exemple.
Mais j’ai toujours envie de montrer tous ses films parce que je le considère vraiment comme un grand maître. J’ai beaucoup appris de lui, de ses histoires singulières explorant le thème du désir et de son style unique, c’est un mentor.
Parmi les films que vous avez sélectionnés dans votre carte blanche, plusieurs traitent de questions liées à la sexualité et notamment à l’homosexualité, des thèmes pratiquement absents de vos propres films. Était-ce un choix conscient ?
Je n’ai pas volontairement choisi des films qui traitent de sexualité ou d’homosexualité. Je les ai choisis car c’est des films que j’ai beaucoup aimé regarder quand j’étais enfant, sur des petits écrans. Mais bien plus tard, je me suis rendu compte qu’à l’époque, sous le régime dictatorial, beaucoup de ces films avaient été censurés et que de nombreuses scènes avaient été coupées. Par exemple, je ne savais même pas que le personnage incarné par Al Pacino dans L’épouvantail de Jerry Schatzberg était en réalité homosexuel. C’est que plus tard, quand j’ai redécouvert le film, que j’ai pris conscience de la nature du personnage qui avait été censurée. Ce régime conservateur nous a fait manquer beaucoup de scènes et de subtilités qui déplaisaient…
La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont été marquées par une véritable explosion du cinéma sud-coréen, à laquelle on a donné le nom de « nouvelle vague » avec des réalisateurs comme Park Chan-wook, Kim Jee-woon, Ryoo Seung-wan, Kang Je-gyu et vous-même. Pourtant, peu d’autres grands noms se sont ensuite imposés sur la scène internationale, à l’exception peut-être de Na Hong-jin et de Shim Sung-bo avec qui vous avez d’ailleurs travaillé. Que pensez-vous de l’état actuel du jeune cinéma coréen ?
Le monde de l’industrie du cinéma coréen a effectivement beaucoup changé, notamment parce que les grandes compagnies de production font davantage de contrôles. Ce qui fait qu’au final, effectivement il n’y a plus beaucoup de grandes révélations singulières dans les films à grand budget. Contrairement à Park Chan-wook et moi-même qui ne subissons pas de pression, la situation est difficile pour les jeunes réalisateurs, ce qui explique la diminution d’originalité. Mais la conséquence de ce contrôle exercé au sein des grandes majors c’est qu’on voit aussi plus de films vraiment uniques et aventureux dans le secteur du cinéma indépendant.
Pensez-vous que la fameuse « liste noire » des artistes dressée par l’ex-ministre de la Culture Cho Yoon-sun a freiné la créativité ?
Je figurais aussi sur cette liste noire ! Mais comme je finançais mes projets via des entreprises privées, je n’ai pas eu de problème pour produire mes films. Mais c’est sûr que cela a eu un grand impact pour les petites compagnies ou encore des petits théâtres qui ont vraiment besoin de l’aide de l’État. C’est surtout eux qui ont été touchés, jusqu’à parfois disparaître… C’est vraiment regrettable.
En termes de box-office, le cinéma coréen parvient toujours à assurer d’énormes succès à domicile, et ce malgré l’ouverture des quotas d’importation. Presque chaque année est marquée par un nouveau record. Comment expliquez-vous cela ? Y a-t-il des éléments particuliers qui permettent de rassembler le public coréen autour de la production nationale ?
C’est vrai que presque la moitié des films à l’affiche en Corée sont coréens. Nous n’avons donc plus vraiment besoin de quotas qui protégeraient la production nationale. Mais je pense que c’est justement grâce aux quotas que nous avons réussi à gagner cette part de marché. Je pense aussi que les Coréens aiment beaucoup aller au cinéma, surtout dans les multiplexes qu’on trouve maintenant partout et qui proposent un grand confort. Ils vivent la sortie au cinéma comme une prolongation de leur quotidien.
De plus en plus de réalisateurs sud-coréens ont réalisé « leur film » sur les relations avec la Corée du Nord : Park Chan-wood avec JSA, Na Hong-jin avec The Murderer, Ryoo Seung-wan avec The Agent, ou plus récemment Yoon Jong-bin avec The Spy Gone North ou Kang Hyeong-cheol avec Swing Kids qui est d’ailleurs sélectionné en compétition ici à Fribourg. Est-ce un sujet qui pourrait vous intéresser un jour ?
Même si dans l’immédiat je n’ai pas de projet précis sur ce sujet, j’aimerais bien le traiter oui. Ma famille, du côté maternel, a été directement touchée par la séparation des deux Corées. Même si ça ne se voit pas vraiment, cette situation extrême touche chaque famille coréenne… Absolument personne n’est épargné. Donc oui, j’ai l’intention d’en parler un jour.
Depuis Barking Dog, les animaux occupent régulièrement une place très importante dans vos films : que ce soit un chien, la créature de The Host, ou encore Okja. À l’image d’Okja, ils sont souvent les figures les plus positives dans vos films.
C’est vrai, il y a beaucoup d’animaux dans mes films. Finalement, ce qui importe pour moi c’est de poser une question sur l’humanité : qu’est-ce que l’humain ? L’homme et l’animal sont à la fois très similaires et très différents et les interactions entre les deux révèlent ces différences. Je pense que ce contraste me permet de mieux approcher la vérité de l’humanité.
Même Snowpiercer se terminait sur l’image d’un ours polaire, ce qui a d’ailleurs souvent été interprété comme étant l’annonce de la mort imminente des personnages alors qu’il me semble qu’il s’agissait plutôt d’un signe d’espoir, annonçant que la vie était à nouveau possible à l’extérieur… À nouveau un symbole positif.
Rires ! C’est absolument juste ! Quand les deux enfants sortent du train, ils sont confrontés à un ours polaire. C’est vrai que des personnes ont pensé : « Ils vont se faire manger donc c’en est fini de l’humanité ! ». Bien sûr ce n’est pas vrai, cela illustre la régénération et la survie de l’humanité. Quelqu’un m’avait alors demandé : « Mais, dans ce cas, pourquoi avez-vous choisi un ours polaire et pas un cerf qui a l’air gentil ? ». Rires. Mais oui, l’animal est clairement un signe positif ici.
À l’inverse, dans presque tous vos films les personnages humains présentent des failles, une psychologie complexe ou sont parfois même complétement dégénérés. Votre cinéma paraît peu optimiste au sujet de la nature humaine…
En réalité, je ne trouve pas que l’humain soit dégénéré par essence. Cependant, je pense que c’est en montrant la complexité de la nature humaine qu’on approche au maximum la vérité et qu’on révèle au mieux la « face cachée » de l’humanité. En regardant les côtés négatifs ou la part dissimulée de chaque individu on peut aboutir à une grande vision d’ensemble, comme une fresque de la société ou de l’humanité.

En termes de noirceur, le monologue de Chris Evans qui raconte ce qu’il a fait à un nouveau-né dans Snowpiercer est effrayant. Comment a réagi la production américaine à ce passage presque nihiliste ?
Snowpiercer a en réalité été vendu à Miramax, la compagnie d’Harvey Weinstein, après sa réalisation. Ils ont effectivement voulu couper cette scène qui décrit quelque chose d’horrible. Je ne sais pas si Harvey Weinstein est en prison ou non aujourd’hui mais il a proposé de couper cette scène… Sauf que pour moi cette scène était très très importante, donc j’ai insisté. Heureusement, le film est sorti avec mon montage. Ils voulaient couper presque 25 minutes mais j’ai gagné ! Rires !
Parasite est le premier projet intégralement coréen depuis dix ans. Comment s’est passé ce retour en Corée ?
J’ai effectivement travaillé à l’étranger pour mes deux précédents films. Mais comme la production de Snowpiercer était en partie financée par la compagnie coréenne CJ Entertainment et que Okja était aussi un mélange entre le monde coréen et américain, je n’ai pas vraiment eu l’impression d’être « retourné » en Corée pour Parasite. J’ai juste continué à travailler comme à mon habitude, sans observer de grandes différences.
Ce prochain film semble annoncer un retour d’un thème très important dans vos films coréens : la famille. Qu’est-ce qui vous intéresse dans le traitement de la cellule familiale ?
C’est vrai que je parle souvent de la famille, et ce sera aussi le cas dans Parasite. Mais il s’agira d’une famille anormale, dégénérée, dans laquelle il y a beaucoup de problèmes… Ce sera donc très différent des représentations de la famille que j’ai déjà proposées. J’ai beaucoup aimé introduire des problèmes dans cette famille et tout détruire. C’est comme si je racontais une histoire de famille dans le but de la détruire. Rires !

Memories of Murder a marqué toute une génération de réalisateurs et a eu une très grande influence sur le genre. Des films comme La Isla Minima en Espagne ou Une pluie sans fin en Chine peuvent presque être considérés comme de remakes. Les avez-vous vus ?
J’ai entendu parler de La Isla Minima mais je ne l’ai pas vu. Je n’ai pas vu non plus Une pluie sans fin. Mais vous savez, j’ai 50 ans et je me sens très jeune ; je cherche toujours ma voie. J’ai toujours l’impression d’encore être à la recherche de quelque chose. Donc quand j’entends ce que vous me dites ou quand on me demande si j’ai influencé tel ou tel autre réalisateur ça me fait très bizarre. C’est vraiment difficile à y croire pour moi, puisque je n’ai pas encore cessé de me chercher moi-même.
Un grand merci à Charlotte Frossard, à Thierry Jobin et à toute l’équipe du FIFF pour avoir rendu cette interview possible.
Entretien conduit par Thomas Gerber, traduction assurée par Jisung Hyun.
Photos ©FIFF
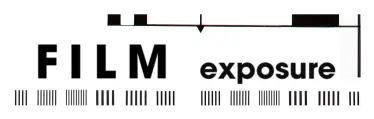

1 commentaire »