Titane : Va Va Voom
Nous inaugurons notre nouvelle rubrique : le Programme Ludovico. Le concept est simple : un rédacteur soumet un titre (d’actualité ou non) à un autre rédacteur qui doit (re)voir le […]
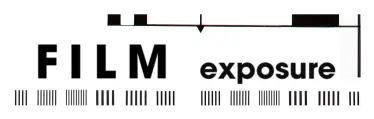 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Nous inaugurons notre nouvelle rubrique : le Programme Ludovico. Le concept est simple : un rédacteur soumet un titre (d’actualité ou non) à un autre rédacteur qui doit (re)voir le […]
Nous inaugurons notre nouvelle rubrique : le Programme Ludovico. Le concept est simple : un rédacteur soumet un titre (d’actualité ou non) à un autre rédacteur qui doit (re)voir le film et en proposer une critique libre. Afin de limiter le sadisme, l’exercice est par définition réciproque. Joueurs, nous nous soumettons donc aux ordres recommandations d’un autre membre de l’équipe de Film Exposure et nous commençons avec la critique de Titane rédigée par Jean, à la demande de Thomas. Et croyez-nous, ce seul texte justifie l’existence de cette rubrique.
 À sa découverte je n’avais ni énormément aimé ni terriblement détesté Titane (réaction décevante à un film qui supplie à pratiquement tous les plans d’être adoré ou honni). Je l’avais vu vers 22 heures dans une salle presque vide d’un multiplexe. D’après ce que j’ai cru y avoir constaté, aucune mamie à sac Chanel et carré Hermès n’en était sortie au bord de l’évanouissement (vous savez, de celles qui peuplent à peu près toutes les vidéos de réactions prises sur le vif lors des « scandales » cannois). Le lendemain, l’attribution de la Palme d’Or à Julia Ducournau était annoncée et (sans avoir alors de points de comparaisons particuliers) celle-ci m’a paru une bonne surprise. Je n’ai pas prêté grande importance à son discours du jour : peut-être idiot sur les bords, difficile de toute façon de faire autrement dans ce genre de situation, mais surtout convenu (comme peuvent l’être les propos de beaucoup de sortants de la FEMIS). J’ai suivi très lointainement l’accueil critique du film, clivé pile comme il se devait. N’étant plus capable d’étonnement pour grand-chose en ce qui concerne le traitement médiatique de tout ce qui touche de près ou de loin à la dysphorie de genre (sujet dont je m’étais promis de me tenir aussi éloigné que possible, mais si nous y voilà c’est la faute à Thomas Gerber), je n’ai pas gaspillé trop de temps à me demander à quel degré l’ironie d’interpréter un récit de déni et de monstruosité comme une apologie LGBTQ+ échappait aux commentateurs enclins à s’engager sur cette pente glissante. (Ce n’est qu’un mec cis sur le Net de plus qui parle, mais serais-je plus personnellement concerné que je ne sais pas si j’aurais très envie d’être accueilli sous le label « monstre », comme si la seule place encore à prendre était celle de bête de foire.) Ironie de toute façon éclipsée par une autre plus éclatante encore : le film n’aborde même pas vraiment ça, dans les faits. Par quoi j’entends que c’est l’histoire d’une femme qui se déguise pour échapper à des recherches, pas d’une personne qui éprouve et assume une autre identité genrée que celle qui lui a été assignée à la naissance sur la base de son sexe biologique. Il est vrai que deux filles s’y roulent des galoches et qu’un homme d’âge mûr y éprouve du désir pour une trentenaire en cloque aux cheveux courts qu’il a pris aussi longtemps qu’il y parvenait pour son fils (si quoi que ce soit là-dedans brisait encore un tabou ou l’autre), mais cela revient à dire que le film traite tout au plus de fluidité sexuelle. Heureusement, d’ailleurs, sans quoi les jours de Ducournau seraient vraisemblablement comptés avant que quelqu’un appelle la police pour ne pas avoir choisi un interprète directement concerné (jurisprudence Boy’s Don’t Cry). Bref, ce sont deux thématiques distinctes, et une seule détient une pertinence (réelle quoique limitée) ici.
À sa découverte je n’avais ni énormément aimé ni terriblement détesté Titane (réaction décevante à un film qui supplie à pratiquement tous les plans d’être adoré ou honni). Je l’avais vu vers 22 heures dans une salle presque vide d’un multiplexe. D’après ce que j’ai cru y avoir constaté, aucune mamie à sac Chanel et carré Hermès n’en était sortie au bord de l’évanouissement (vous savez, de celles qui peuplent à peu près toutes les vidéos de réactions prises sur le vif lors des « scandales » cannois). Le lendemain, l’attribution de la Palme d’Or à Julia Ducournau était annoncée et (sans avoir alors de points de comparaisons particuliers) celle-ci m’a paru une bonne surprise. Je n’ai pas prêté grande importance à son discours du jour : peut-être idiot sur les bords, difficile de toute façon de faire autrement dans ce genre de situation, mais surtout convenu (comme peuvent l’être les propos de beaucoup de sortants de la FEMIS). J’ai suivi très lointainement l’accueil critique du film, clivé pile comme il se devait. N’étant plus capable d’étonnement pour grand-chose en ce qui concerne le traitement médiatique de tout ce qui touche de près ou de loin à la dysphorie de genre (sujet dont je m’étais promis de me tenir aussi éloigné que possible, mais si nous y voilà c’est la faute à Thomas Gerber), je n’ai pas gaspillé trop de temps à me demander à quel degré l’ironie d’interpréter un récit de déni et de monstruosité comme une apologie LGBTQ+ échappait aux commentateurs enclins à s’engager sur cette pente glissante. (Ce n’est qu’un mec cis sur le Net de plus qui parle, mais serais-je plus personnellement concerné que je ne sais pas si j’aurais très envie d’être accueilli sous le label « monstre », comme si la seule place encore à prendre était celle de bête de foire.) Ironie de toute façon éclipsée par une autre plus éclatante encore : le film n’aborde même pas vraiment ça, dans les faits. Par quoi j’entends que c’est l’histoire d’une femme qui se déguise pour échapper à des recherches, pas d’une personne qui éprouve et assume une autre identité genrée que celle qui lui a été assignée à la naissance sur la base de son sexe biologique. Il est vrai que deux filles s’y roulent des galoches et qu’un homme d’âge mûr y éprouve du désir pour une trentenaire en cloque aux cheveux courts qu’il a pris aussi longtemps qu’il y parvenait pour son fils (si quoi que ce soit là-dedans brisait encore un tabou ou l’autre), mais cela revient à dire que le film traite tout au plus de fluidité sexuelle. Heureusement, d’ailleurs, sans quoi les jours de Ducournau seraient vraisemblablement comptés avant que quelqu’un appelle la police pour ne pas avoir choisi un interprète directement concerné (jurisprudence Boy’s Don’t Cry). Bref, ce sont deux thématiques distinctes, et une seule détient une pertinence (réelle quoique limitée) ici.
L’ironie étant la grande ennemie de ce cinéma-là, pourquoi ne pas accepter qu’elle soit aussi celle de certains de ses admirateurs ? Puis tout cela tient du discours, pour un film qui demande à être traité sur le plan de la sensation. Or, c’est là qu’il est parfois réussi (bel usage du Doing it to death de The Kills) et parfois beaucoup moins (cra-crac pin-pon, entre autres joyeusetés). Et reste la question de ce qu’on en pense, d’avoir éprouvé ceci ou cela, chaud ou froid, salé ou sucré, plaisir ou déplaisir, etc. Quelques mois plus tard, quand j’ai été cueilli de me retrouver aussi troublé et ému par Tre Piani de Nanni Moretti, que je n’arrêtais pas par la suite d’y repenser, je me suis souvenu de la boutade laconiquement désabusée du cinéaste, dans un registre trop-vieux-pour-ces-conneries, suite à cette Palme pas très, très intello. Lui a constaté ce qu’il en coûte de réaliser un film intellectuel dans une ère anti-intellectuelle : au mieux, si on s’est déjà fait un nom, l’indifférence polie. Ce qui me laisse perplexe avec Titane, ce n’est pas seulement que je ne sache pas trop quoi en penser, c’est que je suspecte la cinéaste de ne pas toujours trop le savoir non plus. Comme je m’y attendais (sans particulièrement m’en inquiéter) le film ne tient pas très bien la révision. Je doute que cette Palme vieillisse excellemment, ce qui est, il faut dire, le lot d’un nombre conséquent d’entre elles. Parce qu’en fin de compte, quand on en vient à la carcasse, c’en est une comme les autres.
Ce qui peut rendre déplaisant d’écrire, en particulier négativement, sur ce film est qu’il paraît anticiper trop complaisamment les reproches qu’on pourrait lui faire. Comme si quoi qu’on puisse en dire ne saurait être qu’une variation (en plus pompeux et moins drôle) du micro-trottoir savamment orchestré à la sortie de sa première salle de projection. Il y aura les blaireaux terminaux pour trouver ça « choquant » et les blaireaux qui s’ignorent pour trouver ça « vain ». Quant à qui se contentera de glousser, ne pas oublier que le vrai courage en cinéphilie, et la vraie sophistication, c’est de ne pas rire même quand c’est risible. Bien essayé, blaireau quand même. À la décharge de Ducournau, son film recèle par moments un humour sciemment bas du front pas désagréable, mais qui n’aide pas (si c’était, comme on peut le soupçonner, partiellement le but) à faire mieux passer les moments où, de fait, ça casse plus que ça passe (si Cronenberg filmait dans Crash des gens baisant dans leur voiture et non pas des gens baisant leur voiture, il y avait peut-être une motivation à sonder dans ce choix inattendu). Ce qui lubrifie mieux est paradoxalement une faiblesse : le fait d’avoir tenté (sûrement tant c’est la croix et la bannière d’arriver au bout d’un seul) de caser trois/quatre films, voire plus, en un seul long-métrage. Sa première hybridité est budgétaire : il aurait dû coûter plus pour ses ambitions et paraît à certains moments cheap. Conséquence imprévue et bienvenue, ça évite à Ducournau de trop s’installer dans ses situations. On ne s’attarde pas trop sur les dérapages et sorties de route. Il y a beaucoup d’idées, ce n’est pas très homogène, comme c’est bigarré rien ne fait trop tache non plus. Bon côté des impatients, ils ne traînent pas trop là quand eux-mêmes pressentent qu’il ne vaut mieux pas. C’est aussi une limite de l’exercice, son côté « circulez y a rien à voir ». Ça et le risque qu’à pousser cette logique à l’extrême, on finisse par basculer dans son inverse : la redondance. Le nombre de scènes de danse se retrouve donc arrêté juste avant le minimum pour un jeu à boire (ça ou conduire, il faut quand même choisir). De déviations en déviations, on finit tôt ou tard par voir où tout ça conduit plutôt autoritairement. Un récit, somme toute gentiment benêt, ni spécialement douteux ni spécialement profond, d’adoption et d’acceptation de soi, où l’idiotie (subie ou revendiquée) cède fatalement le pas à un certain sentimentalisme. La famille qu’on se choisit contre celle qui nous a blessée, tournoyer sur les épaules de sa crew, mes cicatrices sont mes parures, on m’a jamais brisée moi, deviens qui tu es… Va Va Voom par l’impasse Nicki Minaj du bon mauvais goût jusqu’à se prendre le mur de l’édifiant, un propos normé qui a la vraie ou fausse naïveté de ne pas réaliser l’être (laisser entrer les monstres, le freak c’est chic, ce genre de considérations hautement subversives). Au-delà de se raser les cheveux ou de changer de teinture, horizon existentiel : faut faire avec.
C’est ici que la question de l’humour (volontaire ou non et jusqu’à quel point ?) gagne une signification pas si anecdotique : il faut beaucoup d’esprit de sérieux à des membres de ce Rotary Club qu’est l’internationale festivalière (et encore, il est plus commode d’entrer au Rotary) pour poser sans ciller aux outsiders et se donner le change de bout en bout. Le secret de Polichinelle de ce cinéma est qu’il fait pleinement partie de l’establishment. C’est en partie ce qui explique qu’il tienne aussi peu à s’attarder sur quoi que ce soit et qu’il s’efforce avec l’énergie du désespoir d’en mettre plein la vue. On n’a pas eu besoin de le faire entrer, il a toujours été là. Le moteur est le même, il n’y a que la finition qui varie, au gré des saisons esthétiques et sociétales (parce que si quelque chose n’était pas récupérable par une machine narrative dévouée au statu quo, ça se serait peut-être déjà remarqué). C’est une stratégie (les bourges posant aux blousons noirs) qui n’aurait de chance d’être opérante que si vraiment, vraiment tout le monde jouait le jeu. Spoiler : ça ne sera jamais le cas. D’où l’armature en titane contre le ridicule, que relever consiste en, plus qu’un crime de lèse-majesté, contre le Saint-Esprit (ce cinéma-là voue un culte à la Sincérité avec un S majuscule, il vous le fait bien savoir). Et d’où l’esthétique débraillée/hystérisée, moins décadentiste que néo-primitive, assez caractéristique d’une caste en décompensation (en période de naufrage elle a tendance à oublier sa grammaire correcte et ses manières à table) que plus personne ou presque ne prend au sérieux. (Tout à l’opposé de cette posture-là, c’est ce que je peux estimer chez Sofia Coppola : le refus d’occulter sa position sociale. Le noblesse oblige a du bon.) Pour être honnête, Ducournau a ce faisant au moins le mérite de regarder son altérité effective (une France populaire avec une diversité de couleurs) là où la majorité de ses collègues ne tentent même pas ce safari dans des contrées où des camés de 47 ans vivent chez leur mère, mais elle se retrouve alors confrontée à une réalité sur laquelle elle n’a plus vraiment prise. Ce cinéma, au mieux de fugitive, au pire de touriste, se met à croiser de vrais parias et ce n’est pas toujours joli à voir.
Tout cela engendre une surcompensation, aboutit à de la révolte pour rire. Se révolter contre quoi, du reste ? Les actualités télévisées dans le film esquissent le portrait d’une France où rapts d’enfants, incendies de campings et meurtres en série semblent être les premiers problèmes de la population. Entre lieux de transit saturés de plus d’avis de recherches et de disparations que d’affiches de la SNCF ou de compagnies de bus et salons de l’auto où d’autres danseuses comme elle sont priées de secouer leurs boules devant des « fans » sortis d’une saison des Marseillais sur W9, Alexia (Agathe Rousselle), fille d’un médecin bien sûr lui, traverse, jusqu’à intégrer un régiment de pompiers (qui pourrait du reste tout aussi bien se situer en périphérie d’Île-de-France), un Sud prolo dont le niveau d’ancrage dans une réalité quelconque est souvent malaisé à jauger (des Méridionaux seraient demandés à l’accueil). Le fait est que partout où elle est passe, elle est là par choix, les autres par absence d’options alternatives. Quant à la véracité du portrait, après tout, qui sait ? Peut-être que la Macarena se chante bel et bien pour accompagner un massage cardiaque (le genre d’élément qui paraît trop idiosyncrasique pour avoir été inventé : réponse bienvenue si quelqu’un la possède). L’esthétique dite réaliste n’est pas moins conventionnelle qu’une autre ostensiblement empruntée au cinéma de genre. Mais pour jouer la carte du sensoriel comme le film entend le faire (dans la lignée de Beau Travail ou de Gaspar Noé dont les influences planent par moments voulus aériens), il lui faudrait une concrétude qui lui fait souvent défaut et que sa bizarrerie affichée (serait-elle glanée ici ou là dans des faits avérés) ne saurait remplacer. C’était déjà le problème de Noé (autre adepte des France à la réalité flottante sur lesquelles pontifier) et ça ne s’améliore pas ici. Sans la volonté affichée de dire quelque chose du pays (sortez les guirlandes de drapeaux bleus-blancs-rouges), ce sens on ne peut plus sélectif de l’observation ne serait pas sujet à des reproches trop décisifs. Combiné avec celle-ci, il révèle une faiblesse de vision. La grandeur supposée du mythe sert principalement de cache-misère à une difficulté à se confronter au réel, au sein d’une mise en scène qui se voudrait allégorique mais est plus naturellement portée sur le dissertatif. C’est peut-être pour cela qu’il faut une « autre » grossesse, une « autre » espèce de nouveau-né : difficile d’admettre que cette approche est, plus simplement, stérile.
Ce sont des détails incongrus qui brillent de temps à autre d’un beau caractère concret : les cheveux teints qui se coincent dans le piercing au téton que porte Garance Marillier, les seringues que Vincent Lindon s’injecte dans les fesses (image qui a dû résonner chez Spike Lee au sein du Jury, au vu de sa drôle de préoccupation sérieuse pour les fake-butts dans la version série de She’s Gotta Have It), un corps contre un autre dans un câlin qui précède une agression, l’absurdité d’un père qui commet un accident en se retournant de son volant pour rattacher la ceinture de sa fille… Bertrand Bonello, venu tirer grise mine en géniteur coupable de négligence et vaguement incestueux, doit apprécier chez Ducournau ce qu’il goûtait déjà chez HPG (quand il apparaissait dans On ne devrait pas exister). À savoir la première qualité de la cinéaste : son premier degré. Elle l’applique rarement mieux qu’à des situations apriori dérisoires, qui précisément ne paraissent pas raconter grand-chose. Parce que dans cet univers, « raconter » revient très vite à rédiger une dissertation : dureté du monde des danseuses à l’apparence féminine vs douceur de celui des sapeurs aux atours virilistes, ce type de thèses/antithèses qui marche avec tous les couples d’oppositions possibles et qui facilite probablement un peu le travail quand il faut expliquer trente fois la même chose à l’avance sur recettes.
Un moment joint cette concrétude (une expérience palpable plutôt que de la rhétorique illustrée) à un paysage social paraissant plus largement ancré : juste avant qu’Alexia quitte le bus nocturne où une passagère seule commençait à être harcelée par un groupe de turbulents en chien. Il y a dans ce bus une Française et des Français très réels, eux. Il n’est pas innocent que le film, n’ayant pas toujours beaucoup plus d’envergure que celle nécessaire à s’encanailler, se voit contraint de les abandonner à leur situation. Non pas qu’une bande d’adolescents lançant des propos obscènes à une jeune femme mortifiée mérite nécessairement une mort fictionnelle collective, mais l’héroïne qui les plante tous là est tout de même celle qui auparavant a trucidé à coups de pics à cheveux gratuitement, en tout cas pour moins, une colocation entière (et qui montrait moins de scrupules à bander les muscles quand elle était elle-même la cible d’un loulou). À croire qu’en matière de colonne vertébrale, même une ossature en titane montre ses limites quand ça se met vraiment à chauffer. Il y a bien sûr beaucoup de tristesse dans ce constat d’impuissance, mais, étrangement, c’est une émotion que le film peine à endosser. Se ressaisir (on est en titane, que diable !) et regarder ailleurs – toujours ce problème d’ancrage. La véritable « fluidité » de Titane, en tout cas la plus souterraine et déplaisante, n’est pas tant le passage d’Alexia à Alex pour revenir à Alexia que le fait que sous n’importe quel alias, n’importe quelle enveloppe, il s’agisse de ne faire que passer, sans jamais s’attarder, là où d’autres sont en captivité. C’est leur vie, ce n’est pas pour « faire genre ». Pas très Va Va Voom. Circulez y a rien à voir. Mais n’oubliez pas de lâcher vos coms à la sortie.
TITANE
Réalisé par Julia Ducournau
Avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Bertrand Bonello
Sorti en Suisse romande le 14 juillet 2021
Images © Allocine