 Olivier Assayas est sans conteste une figure importante pour la majorité de notre équipe. Premièrement parce que sa filmographie nous fascine, de par son caractère expérimental, sa liberté qui paraît comme une anomalie dans le paysage français ou encore pour sa vertigineuse exploration de schèmes récurrents ; le temps, l’invisibilité, la jeunesse et la musique en tête. Aussi parce qu’il est celui qui a initié la curiosité et le goût d’un cinéma – qui compte beaucoup pour nous – pendant ses quelques années de journalisme aux Cahiers du cinéma. Le double numéro spécial Made in Hong-Kong de la revue qu’il a piloté avec Charles Tesson en 1984 fait, aujourd’hui encore, office de pierre fondatrice de toute une cinéphilie. En clair, Olivier Assayas a ouvert une voie, celle d’une passion sincère, vivante et érudite d’un cinéma jusqu’alors méconnu.
Olivier Assayas est sans conteste une figure importante pour la majorité de notre équipe. Premièrement parce que sa filmographie nous fascine, de par son caractère expérimental, sa liberté qui paraît comme une anomalie dans le paysage français ou encore pour sa vertigineuse exploration de schèmes récurrents ; le temps, l’invisibilité, la jeunesse et la musique en tête. Aussi parce qu’il est celui qui a initié la curiosité et le goût d’un cinéma – qui compte beaucoup pour nous – pendant ses quelques années de journalisme aux Cahiers du cinéma. Le double numéro spécial Made in Hong-Kong de la revue qu’il a piloté avec Charles Tesson en 1984 fait, aujourd’hui encore, office de pierre fondatrice de toute une cinéphilie. En clair, Olivier Assayas a ouvert une voie, celle d’une passion sincère, vivante et érudite d’un cinéma jusqu’alors méconnu.
Alors qu’il était venu présenter Personal Shopper (notre critique à lire ici) et recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière au dernier Festival du Film de Zurich, nous avons eu la chance de nous entretenir avec lui. Or, rencontrer une personne qui a véritablement compté dans la construction de sa cinéphilie personnelle est toujours un exercice délicat. Se pose forcément la question de la stratégie à adopter pour faire passer son admiration tout en gardant le travail du principal intéressé au centre de la discussion. Parce qu’il s’agit également d’en venir à l’essentiel en peu de temps. Raison pour laquelle, après lui avoir timidement glissé à quel point son travail nous est cher, nous avons souhaité directement aborder l’essence et l’origine de son cinéma.
Avec Personal Shopper, vous êtes au plus proche de thématiques qui vous sont très chères, notamment l’invisible et la tentative de le capter. En ça, le film renoue avec votre goût pour Gustave Le Rouge et ce que vous appelez « l’histoire ésotérique du cinéma ».
Oui. Ça me fait plaisir que vous citiez Gustave Le Rouge parce que, au fond, dans ce qui a nourri mon inspiration – au cinéma ou ailleurs – il y a beaucoup de choses qui se sont structurées quand j’ai fait un travail de maîtrise sur lui et c’est vrai que je n’en parle pas souvent. Dans le sens où ce travail m’a rendu conscient des liens profonds qu’il y a dans une sorte de triangulation entre le roman populaire – le roman fantastique français mais pas seulement –, la poésie symboliste et l’ésotérisme. C’est vraiment ce qui est à l’œuvre pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle où les poètes sont fascinés par l’ésotérisme, par les pratiques de la magie noire, etc. Tout ça est évidemment inscrit dans un imaginaire qui est un imaginaire scientifique et qui est celui des découvertes qui ont bouleversé notre perception du monde. C’est l’époque où, tout d’un coup, on s’est rendu compte que l’invisible était incroyablement habité, par des ondes, l’infiniment petit, les ondes hertziennes et que d’une certaine façon c’est notre connaissance et notre compréhension de ce qui n’est pas visible qui nous permet de faire de la photographie, de communiquer par téléphone ou télégraphe et ainsi de suite. Et évidemment, dans la foulée de ces inventions et découvertes qui transforment le monde s’engouffrent les rêves archaïques, très anciens, des alchimistes et en règle générale de l’ésotérisme qui nourrit l’œuvre de tous les grands poètes de cette époque. C’est ce qu’on a appelé le symbolisme. Cet espèce de « chaudron » produit quelque chose qui imprègne tellement l’imaginaire de la société de l’époque que la totalité du cinéma des origines y prend ses racines. D’une certaine façon, c’est aussi les racines de l’art moderne.
C’est vrai que c’est quelque chose qui m’a passionné, que je finis par assez bien connaître parce que le travail de recherche que j’ai fait à l’époque était assez important. Et c’est vrai que la personnalité de Gustave Le Rouge a été à la fois une sorte de groupie de Paul Verlaine, l’auteur de toute une flopée de romans populaires ayant à voir avec le fantastique très inspiré, entre autres, par Edgar Rice Burroughs et en même temps un vulgarisateur de l’ésotérisme à travers des ouvrages de magie. Il est vraiment au croisement de tout ça. Alors oui, d’une certaine façon, ce sont des choses qui, j’ai l’impression, m’ont permis de mieux comprendre le cinéma muet, de construire pour ces raisons qui me touchent particulièrement un rapport très fort avec ce cinéma ou encore plus tard avec l’œuvre de Kenneth Anger qui est évidemment en plein là-dedans. Pour moi, Anger est littéralement l’incarnation de ça, dans une sorte de versant maléfique. Donc d’une manière ou d’une autre, c’est quelque chose qui est présent, sinon dans mes films, en moi. C’est vrai que ça transparaît dans certains de mes films. Quand je fais Personal Shopper et que je pense à son côté fantastique, au fond ce qui m’inspire ce n’est pas le XXIe siècle, c’est le XIXe. Quand je me pose la question de comment représenter un fantôme, qui n’existe pas par ailleurs, je trouve une sorte de réponse dans la photographie spirite, avec la naïveté que ça implique, je ne vais pas la chercher dans le cinéma de genre d’aujourd’hui.
Jusqu’ici vous filmiez l’invisible en ayant fréquemment recours à l’ellipse – que vous définissez comme étant l’invisible par définition dans sa manière de joindre deux choses en en cachant une troisième – mais dans Personal Shopper vous allez encore plus loin en filmant littéralement l’invisible et en lui donnant un caractère plus incarné.
Oui ! Ce dont j’avais envie dans le film c’était justement de parler de façon incarnée de choses désincarnées. C’est-à-dire que j’avais envie d’inscrire cette problématique de l’invisible et de la magie d’une certaine façon dans un monde complètement incarné, hyper matériel. C’est pour ça que j’avais besoin d’un personnage qui soit là, avec son scooter, son casque, dans les rues de Paris, qui trimballe des sacs, à droite, à gauche, qui fait un boulot idiot et qui en plus n’y croit pas. Elle a une sorte de don [le personnage de Maureen est un médium, ndlr.] parce qu’elle y a accès mais le problème c’est qu’elle finisse par admettre que ça marche quand même alors qu’en réalité elle y est extrêmement réticente. Tout ça se passe contre elle d’une certaine façon. Donc oui, j’avais surtout envie d’inscrire le film dans un cercle où le fantastique n’est pas un enjeu, où ça va de soi et où il y a la possibilité. Ça marche, ça ne marche pas mais il y a quand même la possibilité éventuellement de communiquer avec l’au-delà. Disons que, au fond, ça peut marcher chez des gens qui ont une forme de foi. C’est un film qui tourne aussi, un peu, autour de la question de la foi, c’est sûr.
En parlant de foi, le rapport à la nature est très présent dans votre cinéma, ne serait-ce que dans les titres de beaucoup de vos films qui évoquent des éléments ou des saisons. Dans votre autobiographie vous parlez d’ailleurs de l’importance que vous accordez à la nature. J’ai l’impression que c’est votre manière d’exprimer une forme de spiritualité mais qui n’est pas forcément religieuse. Le personnage de Maureen dit d’ailleurs dans le film que tout ça « n’a rien à voir avec la religion » et il y a une hésitation sur la connotation du terme d’« esprit »…
Oui, dans le sens où je crois comme tout le monde… Disons je mentirais si je disais que j’avais la foi au sens religieux du terme mais par contre je pense que… (silence) qu’il y a plus à gagner en croyant à l’invisible qu’en y croyant pas (rires). Ce que je veux dire c’est que l’idée que le monde matériel n’est pas la totalité du monde est juste ou fausse – elle est peut-être complètement fausse – mais le fait de, au moins, la considérer et de la prendre au sérieux, ça ouvre des portes.
Ce serait une sorte de pari pascalien…
(Rires) Oui mais à une toute petite échelle.
Et sans théologie.
Et sans théologie oui (rires). Et j’ai envie de dire que, à l’inverse, le fait d’absolument ne pas y croire ferme des portes et disons que je préfère la circulation en laissant ça ouvert. Et j’y accorde beaucoup d’importance, je pense que c’est une question qui est importante pour tout le monde.
Même dans le milieu ultra matérialiste de la mode ?
Mais bien sûr. Par effet de balancier justement. Plus on est immergé dans le matérialisme et le monde des apparences ou du travail aliéné, enfin quelle que soit la façon dont on l’appelle, plus le besoin d’autre chose est écrasant, étouffant même quelques fois.

D’où vous est venue cette idée d’implanter une intrigue propre au cinéma de genre dans le milieu de la mode ?
J’aime le genre. J’ai toujours été influencé par les films de genre même quand je ne faisais qu’écrire. Parce que devant un film de genre, le public réagit avec son corps. J’ai toujours aimé les bons réalisateurs de films de genre : David Cronenberg, John Carpenter, Wes Craven… Ensuite, le monde de la mode est intéressant parce qu’il permet de développer une tension entre le visible et l’invisible. Il y a le côté du visible : notre travail, les impératifs avec lesquels on doit composer. À cet égard, le personnage de Maureen a le travail le plus superficiel qui soit dans un domaine où tout n’est que surface. Mais ce monde lui permet aussi de découvrir sa féminité donc une part de son identité, c’est là le côté invisible, renforcé par les rêveries, la fantaisie, le fantastique donc.
Parlons un peu de votre représentation du temps et de l’évolution de celle-ci dans votre filmographie. Dans vos premiers films (Désordre, L’enfant d’hiver) j’ai l’impression qu’il y une urgence du présent, de même qu’on trouve un certain mal-être lié à un état présent dans L’eau froide. On trouve ensuite un temps dont on accuse le passage d’une manière proustienne dans Fin août, début septembre et dans L’heure d’été. Et depuis Sils Maria et aussi dans Personal Shopper je dirais que vous êtes dans une représentation plus globale du temps, presque absolue, cosmogonique voire éternaliste avec notamment la représentation de l’éternel retour dans Sils Maria.
Oui, oui, oui, (rires) ! C’est une manière juste d’en parler ce que vous dites. C’est une question qui m’a toujours obsédé, animé, etc. Et d’ailleurs y compris ma fixation – je ne sais pas comme appeler ça – sur l’œuvre de Debord passe aussi par là parce que c’est une œuvre qui est hantée par le temps, son passage, son écoulement et c’est quelque chose qui résonne profondément en moi et qui se manifeste d’une façon ou d’une autre dans mes films. Et la façon dont vous le décrivez est assez juste au fond. En effet, dans le sens où… (silence) où dans les films les plus récents que j’ai faits il y a une forme de réconciliation (rires) avec cette question. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose où je me détache d’une forme de représentation destructrice du temps et où je soulève la possibilité (rires), y compris pour moi-même, d’une dimension bienfaitrice du temps. C’est un peu de ça d’ailleurs que parle Sils Maria, on est en plein dedans, c’est presque la meilleure manière de le résumer.
Donc il y aurait une forme d’acceptation apaisée du temps, d’acceptation de l’éternel retour ? « Recommençons encore une fois ! », disait Nietzsche évacuant toute aigreur par rapport au temps…
Oui… Enfin, je n’ai jamais eu d’aigreur mais disons que si on se penche sur le gouffre du temps, ça produit un certain vertige (rires). Donc il y a fatalement quelque chose de l’ordre de la mélancolie là-dedans et celle-ci n’est pas absente dans mes films les plus récents. Elle n’était pas absente non plus d’un film comme Fin août, début septembre mais disons qu’en tout cas il y a une problématique de la réconciliation avec le temps. J’ai l’impression en effet que ça me détermine plus qu’avant et… c’est peut-être un peu bête de le dire comme ça mais ça a peut-être à voir avec la paternité tardive. Je veux dire j’ai une fille qui a six ans et, je ne saurais pas bien en parler, mais ce n’est pas imaginable de penser que ça n’a pas de répercussion sur ce que je fais tellement ce sont des choses importantes dans la vie.
Du point de vue du traitement de la temporalité, il y a cette scène très marquante dans Personal Shopper où plusieurs messages envoyés dans un certain laps de temps sont tous reçus simultanément. Cette représentation du temps m’a fait penser à l’épisode que vous décrivez dans votre autobiographie : vous êtes au musée national de Tapei et vous regardez un rouleau dont vous ne voyez qu’une partie, « puisqu’il n’était pas entièrement déployé ». Vous voyez alors une représentation de la vie au palais d’Été montrée par la juxtaposition d’une multiplicité d’instantanés, sans chronologie. « Le temps s’est arrêté et toutes les scènes ont lieu simultanément » écrivez-vous en précisant qu’il s’agit là du cœur de l’esthétique chinoise. J’en viens à ma question : en quoi la représentation du temps dans Personal Shopper est inspirée par cette manière typiquement asiatique de concevoir le temps ?
Cette question est très importante pour moi en termes de rapport à la dramaturgie, à la narration… C’est cette problématique de la simultanéité donc moi je m’en sers en la transposant dans un rapport entre le visible et l’invisible. C’est comme s’il y avait simultanément un scénario visible et un scénario invisible et qu’ils étaient synchrones. Il faut donc comprendre les deux à la fois et je dirais que le film se révèle dans le dialogue entre le scénario visible et le scénario invisible. Mais pas tant que ça dans cette scène du texto (rires) qui m’a plutôt intéressé pour cet effet de décompression du temps, en dehors de l’effet qui n’a pas été facile à régler mais qui marche. C’est une rupture, comme si tout d’un coup un concentré de temps se dilatait, comme une sorte d’airbag (rires), et nous sautait à la figure.
Même dans la cohabitation des vivants et des fantômes, le traitement rappelle par exemple ce qu’a pu proposer Kiyoshi Kurosawa… J’ai l’impression qu’il y a une empreinte typiquement asiatique là…
Bien sûr. Dès qu’on commence de parler de la question des fantômes, de leur représentation… disons que la culture asiatique prend beaucoup plus au sérieux les fantômes que nous. Je ne sais pas si les gens croient réellement aux fantômes mais néanmoins, dans leur métaphysique c’est extrêmement présent et c’est très littéral. Donc à partir du moment où je place le fantôme en disant que « voilà ça fait partie du monde » et où je demande ce qui se passe si on dit que ça fait partie du monde plutôt que pas, ça renvoie à des choses qui ont à voir avec la culture asiatique, c’est complétement sûr. Aussi bien au Japon qu’en Chine, les lieux sont habités… il n’y a aucun doute là-dessus. Mais, encore une fois, moi je partage complétement cette vision du monde. D’ailleurs c’est une vision qui est tout autant à l’œuvre dans L’heure d’été dans le sens où on y trouve cette idée que les lieux et les objets sont habités, que les gens qui ont vécu dans une maison sont toujours là, que la présence des disparus continue à hanter le monde… Tout simplement parce que c’est quelque chose de vrai. Ça se passe dans notre imagination mais ce n’est pas moins vrai du fait que ça se passe dans l’imagination, au contraire…

C’est la deuxième fois que vous dirigez Kristen Stewart, est-ce elle qui vous a donner l’envie d’écrire Personal Shopper ?
Je voulais faire un film avec des éléments fantastiques depuis longtemps. Je ne me sentais pas prêt. Mais dans Sils Maria c’est déjà un peu présent, il y a une onde spéciale… J’ai effectivement écrit Personal Shopper en étant inspiré par Kristen, sans même savoir si elle allait accepter le rôle. Peut-être allait-elle trouver ça trop bizarre. Sur Sils je ne la connaissais pas encore, c’est là que je l’ai découverte et je me suis dit que si je l’avais connue avant, j’aurais pu adapter son rôle.
Une troisième collaboration en vue ?
Psychologiquement, je suis prêt à tourner avec elle demain. Mais je n’ai pas encore de projet pour le moment.
Avant d’entamer Personal Shopper vous étiez sur le point de tourner un film de criminels à Toronto. Le tournage a finalement été annulé à la dernière minute par la société Benaroya, faute de financement. Comment s’est passé votre collaboration avec Robert De Niro qui devait tenir le premier rôle ?
Il y avait effectivement un rôle pour De Niro dans ce film prévu au Canada. Il travaillait vraiment à l’opposé de mes habitudes : il est obsédé par le contrôle et je déteste le contrôle. J’adore De Niro, je l’admire, mais on a eu des discussions sur la texture de ses pantalons, il réécrivait ses répliques… Il devait jouer un mafieux à Chicago et ce qu’il proposait ressemblait à une caricature de la mafia. Il a donc fallu tout réécrire, revoir chaque scène, chaque plan, chaque pantalon (rires) ! Au final, c’est comme si on avait fait le film. Tout ça m’ennuyait mais je m’adaptais.
Le film va-t-il quand même se faire ?
Oui, le film va se faire, mais peut-être avec un autre acteur (rires) ! [Depuis notre entretien, le tournage du film a été confirmé avec Sylvester Stallone dans le rôle initialement prévu pour Robert De Niro, le titre annoncé pour le film est Idol’s Eye ndlr.]
Propos recueillis le 2 octobre 2016 par Thomas Gerber, à Zurich dans le cadre du 12e Zurich Film Festival. Un grand merci à Jean-Yves Gloor et à Kaja Eggenschwiler.
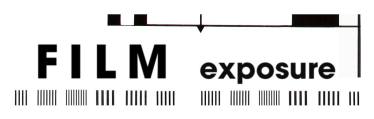



4 commentaires »