Locarno 2017 – rencontre avec Olivier Assayas
Il y a quelques mois, nous avions eu l’occasion de rencontrer Olivier Assayas au Zurich Film Festival, où il était venu présenter son dernier film, Personal Shopper. Comme l’entretien était […]
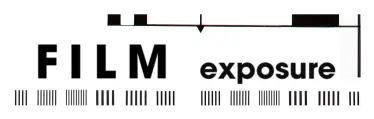 Film Exposure
Film Exposure
Site consacré au cinéma proposant des articles de fond et documentés.
Il y a quelques mois, nous avions eu l’occasion de rencontrer Olivier Assayas au Zurich Film Festival, où il était venu présenter son dernier film, Personal Shopper. Comme l’entretien était […]
 Il y a quelques mois, nous avions eu l’occasion de rencontrer Olivier Assayas au Zurich Film Festival, où il était venu présenter son dernier film, Personal Shopper. Comme l’entretien était passionnant et que le temps avait filé trop vite, nous avons profité de la présence du réalisateur et ancien critique des Cahiers du cinéma au Festival de Locarno pour prolonger notre discussion. S’affranchissant un instant de ses tâches de président du jury, il est revenu sur son expérience en tant que juré, son lien avec le cinéma expérimental, son expertise des filmographies asiatiques, tout en abordant quelques éléments de son cinéma.
Il y a quelques mois, nous avions eu l’occasion de rencontrer Olivier Assayas au Zurich Film Festival, où il était venu présenter son dernier film, Personal Shopper. Comme l’entretien était passionnant et que le temps avait filé trop vite, nous avons profité de la présence du réalisateur et ancien critique des Cahiers du cinéma au Festival de Locarno pour prolonger notre discussion. S’affranchissant un instant de ses tâches de président du jury, il est revenu sur son expérience en tant que juré, son lien avec le cinéma expérimental, son expertise des filmographies asiatiques, tout en abordant quelques éléments de son cinéma.
Que représente le Festival de Locarno à vos yeux ?
Je viens à Locarno depuis longtemps et j’ai toujours aimé cette expérience. Je pense qu’il s’agit d’un des festivals les plus ouverts aux nouvelles expressions cinématographiques et qui tend vers l’expérimental. C’est un endroit où vous avez également une place pour le futur du cinéma et les directions qu’il prend.
Vous avez également été juré à Cannes, quelles différences voyez-vous entre ces deux expériences ?
Vous savez, quand j’étais juré à Cannes le président du jury était Robert De Niro donc vous pouvez voir la différence (rire). Non mais c’est très différent parce qu’à Cannes c’est une autre sorte de films, avec d’autres enjeux et c’est plus formel tout en étant fascinant à sa manière. Mais ce n’est pas la même chose de regarder des films réalisés par des gens dont vous n’avez jamais entendu parler et qui en sont à leur premier long-métrage ou regarder des films de réalisateurs qui ont eu longue histoire. C’est vraiment deux expériences très différentes.
L’expérience juré s’apparente-t-elle à celle de critique de cinéma ? Quelles sont les principales différences ?
(Un long silence) Honnêtement, j’ai oublié ce que c’était d’être critique de cinéma (rire). Je pense que ce qui est similaire, c’est qu’il arrive parfois que vous voyiez des films sans le buzz. Je veux dire que les films viennent à vous en sortant de nulle part : vous n’en avez pas entendu parler, vous n’avez pas lu ce que d’autres personnes ont écrit dessus… Donc parfois quand vous découvrez un film en tant que critique, surtout dans les festivals, vous avez cette même expérience vierge des films. Dans ce sens c’est comparable. Par exemple, je n’ai rien lu sur les films qui sont ici en compétition.
Locarno est peut-être particulièrement stimulant de par la nature d’une bonne partie des films qui y sont présentés. On y voit du cinéma expérimental, des documentaires, ou même des films qui ont été en partie réalisés il y a plus de 20 ans comme La telenovela errante de Raúl Ruiz…
Oui, je pense que c’est très difficile de trouver la bonne manière d’évaluer les films dans une telle sélection. Ils proviennent de strates tellement différentes de ce qu’est le cinéma aujourd’hui. Certains sont à la limite des installations artistiques, beaucoup proviennent du monde artistique, ne serait-ce que dans leur financement, vous avez des films plus classiques et vous avez encore des réalisations post-modernes… La difficulté consiste vraiment à trouver la bonne manière pour les évaluer.

Vous avez eu l’occasion de remettre le Léopard d’honneur à Todd Haynes, avec qui vous partagez quelques points communs…
J’adore le travail de Todd Haynes ! J’étais très content parce que je ne l’avais jamais rencontré et là nous avons pu manger ensemble et établir un vrai lien. Nous venons de milieux très similaires : nous sommes les deux intéressés par le cinéma expérimental, moderne et par le même glamour mélodramatique hollywoodien. Je suis sensible au glamour des films, lui aussi. Je pense que ça fait partie de l’expérience de spectateur de cinéma et que c’est ce qui rend certains films si puissants.
Le cinéma expérimental ne vous est justement pas étranger, vous avez beaucoup écrit dessus. De quelle manière est-ce que ce cinéma a influencé votre travail de metteur en scène ?
Je pense que, souvent, le cinéma expérimental est considéré comme un monde à part. Ce n’est absolument pas comme ça que je le vois. Pour moi il appartient à l’histoire du cinéma et je pense même que vous ne pouvez pas vraiment comprendre l’histoire du cinéma dominant si vous n’y intégrez pas l’influence qu’a eu le cinéma expérimental. Je le vois comme la branche « recherche et développement » de la mise en scène. John Cassavetes était considéré comme un cinéaste expérimental, c’est le monde d’où il vient parce qu’il a réinventé la manière de travailler avec les acteurs, la manière de raconter une histoire, d’écrire un film… Et regardez l’influence de son travail ! Prenez aussi quelqu’un comme Jonas Mekas qui a inventé une forme de cinéma qui s’apparente à du journal à la première personne et qui a aussi un écho dans l’histoire moderne du cinéma. Je ne pense pas qu’il y aurait eu Fassbinder ou Almodóvar s’il n’y avait pas eu Warhol avant, et ainsi de suite. Pour moi, une bonne partie du cinéma dit « expérimental » est centrale pour comprendre ce qu’est le médium à un moment donné.
Faut-il aujourd’hui considérer la télévision comme un champ d’expérimentations ? Quand on voit ce que proposent David Lynch et Jane Campion, qui sont par ailleurs sélectionnés à Cannes.
La télévision est une sorte d’expérimentation oui, absolument. Mais le fait est que c’est difficile pour moi de vous répondre parce que le cinéma auquel je suis lié est fait pour être vu sur grand écran, ce qui pose problème. Je peux être intéressé par beaucoup de choses qui viennent de la télévision, pourquoi pas, mais l’essentiel de mon expérience sensorielle est d’être assis dans une salle de cinéma avec un public qui regarde un film. Je m’en fiche de savoir qu’un million de personnes regardent le même film à la TV, les deux-cents personnes qui sont avec moi dans la salle représentent davantage une vraie foule, et sont donc plus engagés dans l’expérience cinématographique qui m’intéresse.
Vous déclarez ne pas vous souvenir de votre expérience de critique mais vous avez débuté aux Cahiers du cinéma avec une série d’articles consacrés au effets spéciaux et cela fait maintenant plusieurs films que vous semblez intéressé par les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication et vous venez d’annoncer un film intitulé E-book. Qu’est-ce qui vous attire dans ces sujets technologiques ?
Vous savez, pendant la période où j’ai écrit sur le cinéma [c’est-à-dire la première moitié des années 1980, pendant cinq ans], deux évènements majeurs sont survenus. L’un a été la découverte de la cinématographie asiatique, qui était complètement inconnue à ce moment, j’ai donc été attiré par ce sujet de par sa nouveauté. L’autre a été la manière avec laquelle les effets spéciaux ont transformé la texture du cinéma. C’était quelque chose dont les gens n’étaient pas conscients. J’ai donc écrit sur les effets spéciaux à un moment où Serge Daney [qui était le rédacteur en chef du magazine] m’a dit : « Olivier, tu as l’air intéressé par tous ces films américains qu’on voit arriver et Les Cahiers n’ont jamais fait quelque chose sur la science-fiction. Pourquoi n’écrirais-tu pas sur la science-fiction ? » J’y ai réfléchi et je suis retourné vers Serge et je lui ai dit : « Tu sais Serge, l’enjeu n’est pas la science-fiction mais les effets-spéciaux. L’enjeu est que la texture du cinéma est en train de changer à travers ces films qui se démènent pour représenter des choses qui appartiennent davantage au monde de l’imaginaire qu’à la réalité. » J’ai commencé à creuser dans cette direction et j’ai pris conscience que quelque chose d’essentiel était en train de se passer. Je n’étais donc pas tant intéressé par les effets spéciaux en tant qu’effets spéciaux mais plutôt pour prendre la mesure de la transformation de la pratique du cinéma qu’ils ont engagée.
Maintenant, en tant que cinéaste, je n’ai jamais vraiment fait d’effets spéciaux. J’aurais pu, à un certain moment j’étais considéré comme « le cinéphile français ancien expert en la matière » (rire) mais je n’ai pas continué dans cette direction qui m’intéressait peu. J’ai par contre toujours été intéressé par la manière avec laquelle le monde change. Et aujourd’hui la technologie, pour le formuler ainsi, est une composante essentielle des changements du monde. J’ai toujours aimé la dimension « documentaire » du cinéma donc j’aime l’idée de capturer le présent et pour moi, cela consiste à saisir comment les moyens de communications modernes, comment Internet nous transforment. Je ne suis pas tant intéressé par les smartphones ou par Internet mais plutôt par la manière avec laquelle ils transforment notre expérience humaine. C’est ça que j’essaie de capter.
En 1981, dans un texte intitulé « La grâce perdue des aventuriers », vous parliez de la manière avec laquelle George Lucas venait de transformer l’écriture de scénario en quelque chose de feuilletonesque, privilégiant ainsi la narration sur la fiction. Que diriez-vous de l’obsession commerciale pour les univers étendus aujourd’hui ?
Je suis content d’avoir écrit ça à cette époque parce que je pense que c’est particulièrement pertinent, merci pour la citation ! (Rire général) Je pense bien sûr toujours la même chose. Je pense qu’il y a eu une dégradation du niveau d’écriture à Hollywood, du moins pour les films à grand public. Beaucoup de gros films visent un public qui a une mémoire d’environ 5 minutes, tout ce qui s’est passé au-delà des 5 minutes précédentes est donc considéré comme oublié. C’est vraiment étrange de voir tous ces films Marvel aux budgets absurdes qui sont si sophistiqués en termes de technologie et qui sont misérables en termes d’écriture. Ils ne sont d’ailleurs pas à la hauteur des comics de Marvel, qui possèdent une certaine complexité fascinante. J’avais l’habitude de les lire, je lisais X-Men et autres, justement parce que j’étais fasciné par leur manière de raconter leur histoire, par la manière avec laquelle les choses basculent d’un monde imaginaire à la réalité, comment le passé, le futur, le présent se combinent… Je ne retrouve rien de cette complexité dans la plupart des films Marvel, mais c’est certainement dû au fait qu’ils doivent aussi s’adresser à un public plus jeune, composé d’enfants. Du coup, des choses dépassent les limites ; il y a toujours eu une sorte de dimension sexuelle dans ces histoires et chez ces personnages et on ne la retrouve pas vraiment dans les adaptations. Le réalisateur qui a fait ce genre de films que je respecte totalement est Christopher Nolan. Je trouve qu’il est bon pour raconter une histoire, contrairement aux autres.
Je vous ai aperçu plusieurs fois devant le GranRex [la salle du festival essentiellement dédiée aux rétrospectives] avant des films de Jacques Tourneur. Quel lien entretenez-vous avec ses films et plus globalement avec l’histoire du cinéma, car vous avez l’habitude de déclarer que vous n’êtes pas un cinéaste cinéphile.
J’aime Tourneur oui. Je pense que sa filmographie est inégale mais certains de ses films sont remarquables. Je ne me définis effectivement pas comme un cinéphile, je n’aime pas l’idée. Je suis quelqu’un qui fait des films et mes influences sont plus composées de la réalité et du monde qui m’entourent que des films. Je ne suis jamais allé studieusement à la cinémathèque pour voir toute la filmographie de tel ou tel réalisateur du passé. En ce qui me concerne, il est plutôt question d’être connecté à des films qui sont importants pour moi et qui sont plus souvent récents. Mais, quand j’ai commencé à approcher la réalisation, j’étais très curieux du cinéma classique. J’ai grandi à la campagne, ce qui veut dire que beaucoup de classiques que j’ai vus, je les ai vus à la télévision, parce que je n’avais pas les moyens d’aller dans les grandes villes pour voir des films dans les cinémathèques. J’ai ensuite comblé les lacunes et j’ai fini par avoir de bonnes notions de l’histoire du cinéma mais mon angle d’approche n’a jamais été la cinéphilie. C’était plutôt une curiosité pour le médium, comment est-ce que c’est fait et qu’est-ce qui, dans le passé, me parle aujourd’hui. Donc oui, il y a quelques Jacques Tourneur qui ont eu un effet très fort sur moi. Sans être très original, j’adore Cat People, The Leopard Man, Walked With a Zombie, Anne of the Indies… Mais ce qui est génial cette année à Locarno c’est que beaucoup de films qui étaient complètement hors de portée sont maintenant accessibles. Les films de Tourneur ne sont pas tant disponibles en Blu-ray ou autres, donc si vous ne les rattrapez pas maintenant, il y a de bonnes chances de devoir attendre un long moment avant de pouvoir les voir.
Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans la programmation d’un festival ou d’une cinémathèque, c’est de proposer ce genre de rétrospective au bon moment, quand vous avez de nouveaux réalisateurs en devenir qui pourront entretenir un lien avec ce qu’ils vont découvrir. Pour moi, ça a été la découverte soudaine de Douglas Sirk à la fin de années 1980. Il était absolument absent des radars et tout à coup tous ses films étaient disponibles. Les films de Sirk m’ont fasciné parce que j’étais intéressé par les mélodrames et, d’une certaine manière, ils m’ont fait prendre conscience qu’il était possible de raconter ces histoires d’une manière moderne et excitante. C’est la même chose avec Michael Powell ; je me suis intéressé aux effets spéciaux quand le travail de Powell et d’Emeric Pressburger a été découvert et c’était une occasion de se reconnecter à un authentique travail de studio et l’utilisation de la transparence. C’est quelque chose que Scorsese a également fait à cette époque, avec des films comme New York, New York par exemple. Pour en revenir à Tourneur, ce qui m’intéresse, au-delà de la possibilité de combler certaines lacunes dans ma connaissance de son travail, c’est de voir comment ses films semblent soudainement se reconnecter à un public plus jeune.
Vous parlez de « rétrospectives au bon moment »… Vous qui, dans votre travail de critique, avez été en première ligne de nouveaux cinémas d’Asie (dont Hong Kong et Taïwan), si vous deviez choisir un réalisateur asiatique ou hongkongais pour une rétrospective dans un festival comme Locarno, duquel s’agirait-il?
C’est intéressant… (Rire) C’est intéressant… Je dirais Chu Yuan. Il est en marge des tous les grands réalisateurs hongkongais, c’est un peu le réalisateur des mélodrames. Mais il a fait des films sabre géniaux et Intimate Confessions of a Chinese Courtesan. Sa filmographie est passionnante et il mérite assurément une rétrospective. Je pense aussi que les meilleurs films de Liu Chia-liang devraient être montrés de temps en temps parce qu’il représente une partie essentielle de la cinématographie chinoise. Je serais content de voir une rétrospective des films de fantômes hongkongais des années 1950 et du début des années 1960 qui sont complètement introuvables depuis toujours. J’en ai d’ailleurs vu peu mais ils passaient parfois à la télévision hongkongaise dans les années 1980, quand j’y étais. Et… Je recommanderais aussi… (Rire général) Je recommanderais aussi une rétrospective du cinéma taïwanais d’avant la nouvelle vague, parce que notre connaissance du cinéma taïwanais commence avec Hou Hsiao-hsien et Edward Yang mais il y a vingt ans de cinéma intéressant avant. Historiquement, Taïwan a une cinématographie plutôt sérieuse, donc vous avez surtout des réalisateurs tournés vers les adultes, Li Hsing – qui est un très bon cinéaste – en particulier et Sung Tsun-shou. Tous ces réalisateurs n’ont jamais eu une rétrospective appropriée… Et on pourrait aussi aller en Chine continentale, avec des réalisateurs comme Xie Jin qui a fait Two Stage Sisters, Woman Basketball Player No. 5… C’était le réalisateur officiel de l’ère Mao donc il est facilement négligé, parce qu’il était politique vil. (Rire). Mais il a fait de bons films !

Avec Les Cahiers du cinéma vous avez permis à un nouveau cinéma d’exister, ou en tout cas d’avoir une belle visibilité, est-ce que vous pensez qu’un tel rôle d’éclaireur peut encore exister aujourd’hui ?
Non, dans le sens où, encore une fois, c’était un peu le dernier continent de cinéma inexploré. Ça a été une sorte de hasard ; il se trouve que j’ai été là au bon moment et que j’ai eu cette chance de débarquer à Hong Kong, à Taïwan qui étaient des territoires complètement inexplorés… Il y a avait un monde ! J’ai fait ça avec Charles Tesson à Hong Kong et c’était passionnant parce que, au fond, il n’y avait pas la carte, il fallait l’établir. Et donc, quand on a fait ce numéro spécial des Cahiers, ça a servi à établir cette carte et à établir des liens, des contacts, avec des cinéastes dont l’œuvre a marqué et compté : Tsui Hark, Hou-Hsiao-hsien…
Pensez-vous qu’il soit encore possible, à l’heure d’Internet, avec l’accès aux informations actuel, de faire ce genre de découvertes, de faire exister des cinématographies, par exemple africaines…
Honnêtement je ne me rends pas compte parce que l’Afrique, par exemple, je connais très mal. Donc je ne me rends pas compte s’il y a des cultures de cinéma négligées. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il y a eu au contraire, depuis 20 ou 30 ans, un travail qui a été fait par les festivals (le Festival des 3 Continents à Nantes fait un travail incroyable) pour explorer. Pour les choses à découvrir, comme des jeunes cinéastes, je trouve que les festivals font assez bien leur travail. Ils sont très ouverts à des expériences de cinéma nouvelles, d’autant plus que celles-ci peuvent aussi bien passer par le cinéma narratif que par l’expérimental et l’art contemporain. Après, c’est constamment une réévaluation, une réinvention… Il y a toujours un travail de réexploration de l’histoire du cinéma qui doit être aussi ouverte que possible ; moi je suis sûr que, si on se pose la question, il y a des choses passionnantes dans les cinématographies des anciennes républiques soviétiques. Je ne sais plus avec qui j’en parlais mais il me semble que même ça, ça a été fait, il y a des festivals qui l’ont fait. Donc au jour d’aujourd’hui, beaucoup est accessible.
En 1984, lorsque vous étiez à Hong Kong, le cinéma émergent qu’on a ensuite appelé la « nouvelle vague » était très politisé. Est-ce que vous suivez encore le cinéma hongkongais contemporain ? Pensez-vous qu’on y retrouve une charge politique ?
« Très politisé »… Disons que l’un des premiers films de Tsui Hark avait été interdit, ou en tout cas censuré, parce qu’il présentait des G.I. qui trafiquaient de la drogue. Aujourd’hui, la censure chinoise est tellement contraignante qu’on a un peu tendance à idéaliser ce qu’il se passait avant. Mais enfin avant, la censure anglaise était assez rigide et il y avait vraiment le désir de ne pas fâcher la Chine, disons que les uns et les autres étaient très attentifs à ce qu’ils pouvaient dire et ne pas dire. Donc, est-ce que c’était très politique ? Oui, c’était politique dans le sens où Anne Hui avait fait Boat People, etc. qui parlait librement de gens qui fuyaient les communisme. De ce point de vue-là, elle mettait le doigt sur quelque chose d’assez douloureux de la Chine post-révolution culturelle. Allen Fong était un cinéaste social, plus marqué par le néo-réalisme, les trucs comme ça, et il représentaient une forme de réalité sociale. Aujourd’hui, il y a assez peu… ou je ne vois pas venir en tout cas de cinéma hongkongais qui soit partisan ou déterminé par les mouvements démocratiques qui sont présents, ou alors je ne les ai pas vus.
Ten Years, ça vous dit quelque chose ?
Non je n’ai pas vu. Je n’ai pas vu mais disons que je suis très coupé de ce qui se fait dans le cinéma de Hong Kong aujourd’hui. J’y suis allé il y a quelques mois, ça faisait des années que je n’avais pas mis les pieds là-bas.
Est-ce que vous voyez quand même un lien entre ce qui s’y faisait dans les années 1980 et maintenant ?
Disons que… oui… non… peut-être… Enfin disons que ce qui s’est passé depuis l’intégration de Hong Kong par la Chine. Il y a d’abord eu une sorte de Far West qui consistait en la construction de l’économie du cinéma chinois, avec un public immense, des moyens illimités, la constitution de cinéma de blockbusters chinois, etc., ça a été l’œuvre de ceux qui ont fait le cinéma de Hong Kong. Tous ont vu ça comme la ruée vers l’or, aussi bien pour ces gens que pour les acteurs, les techniciens. Ça a été le cas également pour le cinéma taïwanais : tout d’un coup il y a eu la différence entre faire des films à petits budgets – qui n’avaient littéralement plus de public parce que le public historique du cinéma hongkongais et taïwanais à plus forte raison s’est dissout –, et la possibilité de faire des films avec des budgets illimités en Chine populaire. C’est ce qu’ils ont tous fait les uns et les autres, à mon avis avec des résultats extrêmement inégaux. Et aujourd’hui, ça m’a frappé en allant justement à Hong Kong il n’y a pas longtemps, en revoyant des gens que je n’avais pas revus depuis longtemps, je me suis rendu compte à quel point il y avait quelque chose à avoir avec cette énergie du cinéma, avec le côté ludique et un peu déconnant du cinéma de Hong Kong qui me parle peut-être plus que des choses un peu plus sérieuses qui se font dans le cinéma chinois d’aujourd’hui. Je me dis donc qu’aujourd’hui, le peu de liberté qu’il y a à prendre à Hong Kong, même si elle est extrêmement contrainte, elle vaut quand même peut-être mieux que le rapport massif à la censure qu’il y a en Chine populaire, ou ex-populaire, enfin je ne sais pas comment on l’appelle maintenant.
Pour revenir à Tsui Hark, lorsque vous l’avez rencontré en 1983 ou 1984, il était en train de faire Zu ou il l’avait fait…
Il était encore en train de faire Zu.
Entre temps il s’est passé beaucoup de choses : il a fondé sa boîte de production, il a fait un passage aux États-Unis, il est revenu au wuxia, maintenant il travaille beaucoup en Chine…
Oui oui oui !
Que pensez-vous de sa carrière ?
Un des derniers textes que j’ai écrits sur le cinéma chinois, c’était un texte sur Tsui Hark qui était la préface il y a trois-quatre ans pour un livre italien sur le cinéma hongkongais post-1997. Et je dois dire que moi j’ai beaucoup de sympathie pour Tsui Hark, qui a été un des grands inventeurs de forme du cinéma chinois et qui garde une espèce d’énergie ludique dans le cinéma. J’ai été très frappé par le deuxième « Juge Ti », je ne sais plus comment ça s’appelle… en 3D…
Detective Dee ?
Oui Detective Dee, c’est pas le Juge Dee c’est juste. Mais c’est la même chose en réalité, c’est du personnage de Robert van Gulik dont on parle… Enfin, c’est le modèle du personnage de Robert van Gulik, enfin bref ! Quoi qu’il en soit, ce film de deux heures et demi, en 3D, avec des trucs complètement… Je retrouvais chez lui cette espèce de puissance de cinéma d’invention ; c’est complètement bordélique, c’est incohérent, ça ne fonctionne pas et en même temps il y a quelque chose d’assez fascinant dans ce qu’il fait parce que ce n’est pas commercialisable quoi ! Je ne sais pas comment il se débrouille. Et oui, c’est vrai qu’il a fait un ou deux Jean-Claude Van Damme qui n’étaient pas très bons, parce que son écriture cinématographique est tellement libre qu’elle est impossible à synchroniser avec le cinéma hollywoodien, ça ne marche pas. Et au fond, je continue à beaucoup l’estimer.

Les personnages féminins de vos films présentent souvent une double nature. Que ce soit Virginie Ledoyen dans L’eau froide, Maggie Cheung dans Irma Vep, Juliette Binoche dans Sils Maria ou encore Kristen Stewart dans Personal Shopper (les tatouages du personnage de Maureen étant ceux de l’actrice), il y a toujours ce jeu entre deux facettes : l’une réelle et l’autre symbolique.
Oui, je suis simultanément intéressé par la fiction et la réalité. Je pense que la fiction est finalement une autre strate de la réalité et je suis toujours intéressé par la manière avec laquelle la fiction se faufile dans la réalité. Mes films traitent effectivement de ça. Je viens d’une approche « bazinienne » du cinéma, en ce sens je suis donc extrêmement attaché à la réalité de ce qui est filmé et à la sincérité de la démarche. Mais en même temps, je suis intéressé à l’inconscient et à son fonctionnement. Je pense que la psychanalyse est une dimension très importante du cinéma et elle fait défaut aujourd’hui. On ne parle plus du cinéma comme étant lié à l’inconscient mais, qu’ils le veuillent ou non, les films composent avec cette dimension. Sans qu’on puisse le contrôler, les films disent toujours quelque chose dont nous ne sommes pas entièrement conscients. J’ai donc toujours essayé d’être ouvert à ça et, d’une certaine manière, c’est exprimé littéralement dans mes films. Je suppose que c’est pour cette raison qu’on y trouve de figures qui sont à moitié réelles et à moitié définies par la relation inconsciente au média ou à ce qu’il se passe dans le film.
Vous avez d’ailleurs signé l’adaptation du livre D’après une histoire vraie de Delphine de Vigan pour Roman Polanski. Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Ça a été très difficile. Pour faire ça correctement, vous avez besoin d’avoir un contrôle total. J’ai aimé le livre, pour des raisons évidentes que nous venons d’évoquer puisque selon moi il y a deux personnages, l’un étant réel et l’autre sa propre projection fantasmée. Du coup, je ne suis pas sûr que ça fait encore sens avec le casting choisi par Polanski [Emmanuelle Seigner et Eva Green, ndlr]. Disons que ce n’est pas les actrices que j’aurais choisies, à cause de la différence d’âge et des différences flagrantes au niveau du physique. Ce que je veux dire c’est que j’ai écrit une adaptation et qu’ensuite j’ai adapté mon adaptation pour qu’elle corresponde à la vision de Roman. C’était mon travail, donc je l’ai fait, je suis heureux de l’avoir fait et j’ai fait du mieux que j’ai pu. Mais la balance entre la fiction et la réalité vient de Roman, ce n’est pas la mienne.
Vous auriez préféré plus d’ambiguïté ? Que le spectateur ne parvienne pas toujours à distinguer les deux personnages par exemple ?
Oui, quelque chose du genre. Et j’aurais donné plus de place aux conversations. Je pense qu’il se passait quelque chose de plus complexe entre elles… Roman aime quand les choses vont très vite et j’ai le sentiment que certaines subtilités du livre manquent. Mais encore une fois, c’est « l’auteur frustré » qui parle (rire). Ça faisait partie du contrat qu’il s’agirait d’un film de Roman et au final c’est un film de Roman. Je n’en dirai pas plus… (Rire)
Comment travaillez-vous la musique de vos films ? Vous n’aimez pas les bandes-originales, du coup, comment choisissez-vous les morceaux qui vont accompagner vos films et à quel moment ces choix sont-ils faits ? Avez-vous déjà des idées précises de morceaux au moment de l’écriture du scénario ?
Non non (rire) ils viennent extrêmement tard. D’habitude, je ne sais pas quel genre de musique je vais utiliser et si c’est possible je n’en utilise pas du tout et ensuite, graduellement, c’est en salle de montage que je finis pas essayer des choses. J’ai abandonné l’idée de travailler avec des compositeurs parce qu’avec eux je me sens mort : j’engage quelqu’un, il me donne la musique et même si on a discuté en amont je me retrouve avec une BO qui doit s’accorder avec le film, quoi qu’il arrive. Je l’ai fait, j’ai trouvé ça extrêmement frustrant donc j’ai décidé que j’allais être mon propre musicien pour essayer des ambiances et des interactions avec l’image. Le plus souvent, je finis par utiliser des musiques qui ne m’ont même pas traversé l’esprit quand j’écrivais mais soudainement, pour des raisons mystérieuses, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que l’image est plus belle et que la musique sonne mieux. Ça doit donc être bénéfique dans les deux sens.
C’est étonnant parce que l’alchimie entre la musique et les images ou les idées dans vos films est telle qu’on se dit vous avec dû y penser très tôt. À l’image du morceau Track of Time de Anna von Hausswolff qui clôt Personal Shopper, rien que le titre correspond parfaitement au film…
Oui oui oui, absolument ! Pour moi, chaque chanson dans le film doit apparaître comme un petit miracle (rire). Mais mon problème maintenant c’est que vous avez du rock indé dans tous les films. La plus idiote des comédies a du rock indé, vous avez du rock indé dans l’ascenseur, quand votre avion atterrit… vous avez du rock indé ! (Rire général)
Votre frère vous aide-t-il parfois pour les choix musicaux ? [Michka Assayas est programmateur musical pour France Radio]
Non… Non parce que vous savez comment c’est entre frères. (Rire) On a grandi ensemble, on a des relations similaires avec certains artistes mais mon frère est sensiblement plus cultivé musicalement que moi. Il aime des choses plus classiques et moi des choses plus expérimentales.
Vous avez souvent exprimé votre goût pour Bresson, Dreyer et Tarkovski, qui sont trois cinéastes très spirituels, est-ce que vous arrivez encore à trouver un tel cinéma aujourd’hui ? Je pose la question parce que vous ne mentionnez jamais Terrence Malick, à qui vous avez pourtant contribué à donner une Palme d’or en 2011…
Si si j’admire beaucoup Terrence Malick ! J’admire beaucoup Terrence Malick. C’est un très très grand cinéaste et il y a quelque chose chez lui de moins religieux que panthéiste. Enfin, moi ce qui m’a beaucoup touché dans The Tree of Life, c’est que c’est un film qui se bat avec l’idée de constituer une forme de métaphysique acceptable dans un monde sans religion d’une certaine façon. Et il se pose cette question d’une culture, aujourd’hui, qui a perdu son rapport au sens de la religion mais qui néanmoins a besoin de se situer dans le monde et dans l’histoire et dans le temps, etc. Et donc il prend à bras-le-corps cette question-là et il essaie d’en faire quelque chose. J’ai trouvé la tentative assez incroyable et assez unique dans le cinéma contemporain. Je trouve que c’est un film qui même dans l’œuvre de Terrence Malick est très à part parce que d’une ambition démente et, je trouve, avec un certain degré d’aboutissement, d’accomplissement… Mais ce n’est pas quelqu’un qui vous impose ses idées, c’est un film où il se bat avec les idées qui sont celles de chacun, et d’une certaine manière chacun peut s’y retrouver parce que… Enfin, c’est un très grand cinéaste pour moi.
Oui il y a quelque chose d’hégélien chez lui, avec sa quête de transcendance par l’art qui est perçu en tant que quête et qui doit vous parler…
Oui oui oui ! Il croit à ça mais, d’une certaine façon, il se pose la question de comment ça marche avec le cinéma. Moi je suis fondamentalement… enfin je vis dans un monde métaphysiquement hégélien (rire) – même si je suis très très autodidacte en termes de philosophie – et j’ai retrouvé ça chez Malick, bien sûr. Mais je suis sensible à ça parce que pour moi, le processus de la pensée doit être hégélien. Je crois à la dialectique en tant que force agissante quoi ! Et quand je retrouve ça au cinéma c’est vrai que j’y suis d’autant plus sensible.
Entretien conduit par Thomas Gerber et Loïc Valceschini, traduit et retranscrit par Thomas Gerber.
Remerciements à Ursula Pfander ainsi qu’à Richard Lormand pour avoir permis à cette interview d’avoir lieu.
Photo: Locarno Festival / Massimo Pedrazzini
2 commentaires »