À l’occasion du Black Movie, Festival International de Films Indépendants de Genève, se déroulant du 20 au 29 Janvier, retour sur un film de la programmation : Ta’ang de Wang Bing.

Il suffit d’un coup de pied dès le premier plan de Ta’ang, un peuple en exil entre Chine et Birmanie pour saisir de quoi il en retourne : un récit d’oppression. Les De’ang sont une minorité Birmane en proie depuis deux ans à la guerre civile, cette population se voyant prise entre les feux de la junte Birmane et de sa propre « Armée de Libération Nationale ». En fuite, poussés au nomadisme par la mouvance du conflit, certains de ses membres ont trouvé un refuge précaire en Chine voisine, qui ne voit pas cette vague de migration d’un œil spécialement charitable, pas plus que la frontière traversée n’intimide leurs poursuivants. Un trait frappant de ce groupe d’exilés tient chez ses adultes à la proportion féminine, en comparaison de celle d’hommes apparaissant à l’écran (bien que présents, autrement plus rares). Le film ne fournit pas d’explication au fait que les civils De’ang soient pour l’essentiel des femmes et des enfants (laissant par ce silence entendre que les pères et époux laissés hors-champs seraient, ou morts, ou impliqués dans le conflit, ce qui intrinsèquement revient au même). De fait, il ne fournit pratiquement pas d’explication tout court, le carton introductif s’en tenant à une mise en contexte minimale. Wang ne pense pas le cinéma comme une production de savoir, sa caméra tel un outil pédagogique, mais comme un prisme d’empathie, donnant à voir ceux qui sans sa présence demeureraient invisibles. Quelles que soient les raisons qui ont poussé ces personnes vers la frontière Chinoise, il ne ferait pas bon être à leur place.

D’une durée de 148 minutes (une longueur de moyen-métrage à l’échelle de sa filmographie), tourné sur quelques mois, début 2015, peu après l’explosion du conflit armé (en contraste avec les tournages étendus, en immersion prolongée, qu’il favorise d’ordinaire), le film frappe par une tonalité à laquelle le cinéaste, ses portraits hantés de territoires en déshérence, ne nous avaient pas habitués : un sentiment d’urgence. Ta’ang est ce qu’il a réalisé de plus proche du film d’intervention, sans modifier substantiellement sa méthode, une observation non-didactique et non-participante. Un tournage mobile, dans la dangerosité, rejoignant dans ces conditions délicates un paradoxe courant de son œuvre : des personnages se déplaçant pour n’arriver nulle part, soit qu’une institution, un état de l’économie, ou, plus prosaïquement, le paysage lui-même, ne les enferment, ne les condamnent au sur-place. Tout aussi agités, affairés, qu’ils puissent se montrer, les êtres humains chez Wang tendent à l’entropie, une inertie cinglante. Ils paraissent le plus eux-mêmes étendus, allongés le soir, reprenant des forces au coin du feu… avant de reprendre leurs jambes à leur cou, pour un nouveau tour de piste dont sens et valeur ne sont pas garantis.

L’intérêt d’un festival tient aussi aux juxtapositions qu’il produit. Ainsi voir Les Sauteurs (coréalisation de Moritz Siebert, Estephan Wagner, cinéastes européens chargés du montage, et Abou Bakar Sidé, réfugié muni d’une caméra) le même jour (samedi 21 janvier) dans la même salle du Cinéma du Grütli, créait-il un effet de résonance entre les collines de Chine voisines de la Birmanie et celle séparant le Maroc de Melilla, où des migrants (avec en différence notable l’omniprésence du chromosome Y), pour une part représentative Maliens (tel le filmeur) et Ivoiriens, tentent et retentent un passage par le grillage les séparant du Vieux Continent. Campements en plein air, nécessité et aléas de la téléphonie mobile pour les conversations longues distances, absurdité des frontières face à une crise humanitaire qu’on finira par découvrir être à peu près mondiale, morgue des autorités « du bon côté » – alliance de la violence et de l’indifférence, inégalité des destins selon le lieu de naissance. Wang, dont le regard sur la pauvreté s’intéresse de plus en plus aux enfants, pointe par leur présence dans la fuite l’arbitraire d’une situation dont ils ne portent à l’évidence aucune responsabilité, ballotés dans des conditions critiques pour la simple raison d’avoir été là, nés, au mauvais endroit, au mauvais moment. Filmer l’enfance, c’est en sens inverse interroger l’avenir. Dans les jeux qu’il approche, l’exploration curieuse que certains ne peuvent s’empêcher d’effectuer, au grand dam de leurs mères, se remarque tout à la fois une résilience et un âge dérobé, des stades de développement normaux qui leur sont déniés. Le feu prend vite, dans la plaine où campent les De’ang. Il n’est pas impossible d’imaginer dans des regards effarés, la nervosité qui prédomine, au-delà de la catastrophe instantanée le ferment de futurs conflits, des enjeux territoriaux compliqués qui se dessinent avec cette diaspora. Un baptême du feu auquel nul ne saurait être préparé.

Assister à une projection publique d’un nouveau Wang Bing s’avère à tous les coups une expérience sociologique en soi. Pas tant pour les signes habituels, et après tout de bonne guerre, de l’ennui (ronflements, sièges épars qui claquent) que pour ceux d’une hostilité revendiquée, de spectateurs comme outragés d’être bousculés dans un petit confort inviolable (soupirs excédés, bavardage incessant). Les multiplexes n’ont pas le monopole du babillage impatient. Cela ne cesse d’étonner, d’autant que ses films ne sont ni les plus abscons, ni les plus délibérément contemplatifs (peut-être est-ce justement ce qui leur est en partie reproché : ne pouvoir être placés dans une sous-catégorie qui garantirait d’être en de bonnes mains, de pouvoir rêvasser en paix en prétendant avoir été intéressé une fois le générique de fin déroulé, comme s’il n’y avait en fin de compte rien de plus intolérable que cela – le rythme naturel, ni accéléré, ni étiré, de la vie). Le fait est qu’ils sont spectaculairement efficaces à révéler le béotien qui sommeille parmi ceux supposément éduqués à l’image. Il y a bien plus grave sur cette planète que cette intolérance rampante à ce qui sort du formatage (un aperçu à l’écran). Ses manifestations, de plus en plus désinhibées, durant les projections des films du cinéaste, participent à leur manière, avec la bravoure des luttes aux moyens dérisoires, de la sensation d’apocalypse (personnelle et collective) que son œuvre souvent procure.
TA’ANG, un peu en exil entre Chine et Birmanie
Réalisé par Wang Bing
Sorti en France 26 octobre 2016, projeté au festival Black Movie

« Adieu, ami lecteur [amie lectrice] ; songez à ne pas passer votre vie à haïr et à avoir peur. » (Stendhal, Lucien Leuwen)
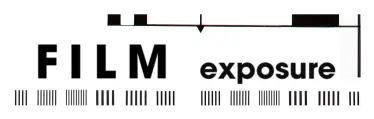




1 commentaire »