The Love Witch, second long-métrage, après dix ans d’attente, d’Anna Biller est-il à la hauteur des nombreuses dithyrambes déjà suscitées outre-Atlantiques? Réponse : définitivement, oui.
«Comment une femme peut-elle imposer son authenticité ? C’est très compliqué. Nombre de femmes qui semblent déjantées, sociopathes, ou même idiotes, essaient en réalité de s’affirmer sans forcément savoir comment s’y prendre. Et c’est ça qui les rend folles. C’est pourquoi j’ai voulu créer un tel personnage. Je voulais qu’il s’agisse de quelqu’un dont l’intelligence, la personnalité, ou toute qualité autre que la beauté, n’a jamais été appréciée à sa juste valeur. » ― Anna Biller [1]

À quoi reconnaît-on l’authenticité ? Un piège courant des arts est de finir par le circonvenir à une forme spécifique. Le diktat du naturalisme dans le cinéma d’auteur pousse à croire que la vérité ne saurait passer que d’une manière : l’épurée de tous fards, grise, réaliste. Chez les moins inspirés, la platitude devient gage d’authenticité. (Une impasse similaire serait observable dans l’histoire du rock où, en réaction à un faste déplacé, s’est imposé dans certaines de ses franges une attitude anti-spectacle en concerts, réponse d’abord saine virant avec les suiveurs à la simple recette – d’où l’épidémie de guitaristes en tongs et t-shirts faisant comme s’ils chantaient dans leur salon, ça fait plus « authentique »). Il n’y pas de recette pour être authentique et la fidélité à soi-même, à son style, ne peut par principe être reproduite. Fidèle à elle-même, Anna Biller l’est très certainement. Convoquant beaucoup, son cinéma ne ressemble cependant qu’à elle. Assumant l’artifice, il est de plus généreux pour son public, autant que porteur d’une vérité impitoyable sur la guerre des sexes.

Tranchant on ne peut plus avec le modèle de films indépendants « des amis se retrouvent en t-shirts dans une maison de vacances », Viva recréait en 2007 avec une minutie maniaque le Los Angeles des années 1970, tel que promu par les couvertures Playboy. D’une manière qui explique partiellement la lenteur de sa carrière, Biller s’y applique à une reconstitution artisanale, jusqu’au moindre détail du cadre, à partir de visites en brocantes et de confections personnelles (elle poussera le vice dans The Love Witch jusqu’à peindre elle-même les tableaux visibles dans le film). Dévotion au colorisme, au décoratisme, qui lui donne en deux œuvres le potentiel en la matière des Minnelli et Visconti. Ce n’est pourtant pas une démarche de maniérisme désintéressé (si tant est que cela existe). Esthète jusqu’au bout des ongles, elle pratique, dans le même geste, un cinéma violemment politique. Viva, en suivant, sur une durée volontairement trop étirée, les incartades de deux naïves bien vite déniaisées, produisait un commentaire acerbe sur la révolution sexuelle, accusée de ne profiter finalement qu’aux hommes de la période. S’échappant de leurs rôles d’épouses au foyer, ses deux femmes se retrouvaient tout autant exploitées (si ce n’est plus) dans la sous-culture échangiste californienne. Le génie de la reconstitution était déjà là, mais pratiqué à froid, l’esthétique Playboy reproduite étant observée avec une défiance distante, au mieux de l’amusement. Pour son deuxième opus, Biller puise en revanche à des sources aimées : Hitchcock, Dreyer, le Pré-Code, certains titres de la sexploitation. The Love Witch est sa contribution aux récits (dont Pas de Printemps pour Marnie serait la fine fleur) de femmes sociopathes au cinéma, qu’elle retourne en une dénonciation du patriarcat.

À son plus posé (ça ne dure pas) The Love Witch est une tragi-comédie de l’insatisfaction, à son plus excessif (ça vient vite) une bouffée d’horreur psychologique. Une scène en résumerait idéalement le ton, l’effondrement émotionnel, après un rapport sous hallucinogènes, du premier prétendant (un professeur, libertin auto-proclamé, spécialisé dans la littérature du XVIIIe Siècle – le film ne recule pas devant ce genre de clichés réjouissants) : horriblement drôle d’abord, peu à peu profondément dérangeante, au final simplement triste. Elaine (Samantha Robinson) sortant d’un mariage abusif, s’installe dans un appartement victorien qu’elle décore à sa façon baroque. La psyché endommagée, personnalité pathologiquement incomplète, elle part à la conquête amoureuse de « la bonne personne »… aventure où de déceptions en déceptions, elle blessera nombre de partenaires avant de se mettre elle-même en danger. L’atmosphère que Biller capture devrait être désagréablement familière pour quiconque aurait ne serait-ce qu’une vague idée de l’addiction à la neurochimie des débuts d’une relation – la volonté de retrouver cet enchantement, le ressentiment conséquent quand une personne de chair et de sang vient prendre la place qu’occupait un conte de fée sécrété mentalement. The Love Witch est le conte d’une incompréhension fondamentale. Les partenaires dont Elaine voudrait être aimée (sachant qu’elle n’a pas la capacité de les aimer elle-même) ne peuvent que la décevoir (s’ils s’attachent), ou la faire souffrir (si c’est eux qui s’ennuient). D’une certaine manière trop belle pour être vue d’eux, elle ne sait s’engager que dans des rapports inégalitaires, où il s’agirait de les rétribuer en accès à son entrejambe pour leur docilité acquise. Jouant, comme tous les personnages féminins de cet univers, un jeu qu’elle ne peut que perdre, elle se consume à perte, retourne cycliquement à son néant intérieur – en abîmant les autres sur son passage. La fascination qu’elle exerce, cela qu’elle le veuille ou non, sa simple présence, presque, déséquilibre l’ordre social. Obsédée par la mythologie amoureuse, elle révèle pourtant, une fois son cœur effeuillé, ce qui s’apparente plus à une haine des hommes.

Peut-être fallait-il préciser qu’elle se présente elle-même – le titre l’indique – comme une sorcière, spécialisée dans l’envoûtement magique (même ce motif énorme n’est pas sans produire son effet de vérité : la pratique de jeter des sorts étant un symptôme relativement courant chez les personnes souffrant de dépendance amoureuse), disciple d’un gourou à la Charles Manson ayant lavé le cerveau à une dizaine de nymphes confuses. Il valait mieux être féministe identifiée (ce qui dans le cas de Biller n’est pas un label hypocritement revendiqué) pour présenter un personnage féminin n’exerçant pas de métier connu, passant ses journées dans son intérieur gothique à concocter des potions, l’une impliquant d’infuser un tampon usagé dans un bocal de sa propre urine. La reconstitution s’inspire ici d’une pente risquée de la fin des années 1960, mêlée à des anachronismes délibérés. Si le film se passe au tournant des années 1970, quid des BMW, des iPhone et des Acer ? S’il se déroule de nos jours parmi des Californiens reproduisant un mode de vie passé, est-il envisageable de vivre autant en vase clos ? On apprend que le salon de thé, « réservé aux filles », où Elaine et une amie se rendent en chapeaux et froufrous colle à un genre d’établissement existant réellement aujourd’hui, attirail de princesses compris. Pour ce qui est des vases-clos… Internet semble avoir été créé pour générer bulles et niches par affinités sociales. Biller fait un usage cynique du passé en commentaire du présent. Il ne s’agit pas pour elle de contraster l’un par rapport à l’autre, mais au contraire, en brouillant les pistes, de rendre visible à quel point rien n’a fondamentalement changé. Le succès d’estime du film aux États-Unis peut d’ailleurs valoir à l’air du temps, une ère du Président Grab-Them-By-The-Pussy, où ce qui aurait paru outré en « temps normal » semble, de nouveau, étrangement plausible.

À qui aime dégainer le terme, dont on souhaite une mise à la retraite rapide, de misandrie, Viva et The Love Witch pourront sembler conçus à ce seul effet. Reproduisant les tics de jeu de l’ancien Hollywood, les interprétations datent immédiatement les acteurs, plus que les actrices pourtant astreintes au même régime interprétatif. On peut trouver limité le principe revanchard consistant à « retourner les tables », réaliser des films où ce seraient les personnages masculins qui apparaîtraient caricaturaux, objectivés, unidimensionnels. On peut aussi apprécier l’humour méchant et à ce petit jeu Biller sait se montrer redoutablement amusante (un peu mesquine mais l’univers qu’elle convoque ne se caractérise après tout pas exactement par sa grandeur d’âme). Autosatisfaction, fatuité, muflerie, rages de bébés, la satire produit une fois de plus un effet de vérité : quel garçon n’a pas déjà éprouvé en son for intérieur une sorte de droit de naissance à obtenir des partenaires très attirantes (et comme une trahison de la part de l’univers entier quand les choses ne se déroulent pas ainsi) ? Le narcissisme paraît ici la chose la mieux partagée du monde, la seule presque à dépasser le clivage de genres. Portée contestatrice de ces croche-pieds sardoniques : la détestation du privilège sous toutes ses formes, du sentiment d’être bien-né, de sa propre importance. Revanche des timides sur les mâles alphas.

Propos clair pour héroïne tordue, palette chatoyante, sexy, pour ce qui peut se lire obliquement comme un commentaire sur l’industrie du sexe (quand à la sensation de pouvoir, en utilisant son corps comme monnaie d’échange, succède l’annihilation de soi, le sentiment dépersonnalisant de n’exister que par le désir de l’autre), même si d’aucuns préféreront en rester aux séances d’effeuillage, refus de la moralisation sans balayer le bon sens (celle qui incarne en ouverture la voix de la raison paie chèrement sa volonté d’indépendance), The Love Witch condense tout cela par un style à la maîtrise confondante, les allers-retours virtuoses d’une réalité fantasmatique à un cauchemar domestique implacablement croqué. Cruel, désespéré, euphorisant de brillance formelle… Ne reste plus qu’à espérer ne pas avoir à attendre dix ans de plus pour un nouvel ensorcellement signé Anna Biller.
THE LOVE WITCH
Réalisé par Anna Biller
Avec Samantha Robinson, Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise
Pas de sortie prévue en francophonie, disponible en VOD
ici.
[1] « How do you negotiate an authentic self as a woman? It’s very difficult. A lot of girls who seem like they might be crazy, or sociopathic, or just stupid, they’re actually trying to negotiate all that and they may not know how. And that’s what drives them insane. So I wanted to make that kind of character: somebody who has never been valued for her brains, for her personality, for anything that she has to offer, but who only really gets valued for her beauty. »
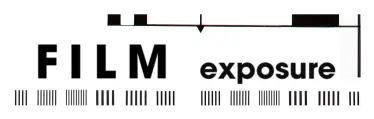






2 commentaires »